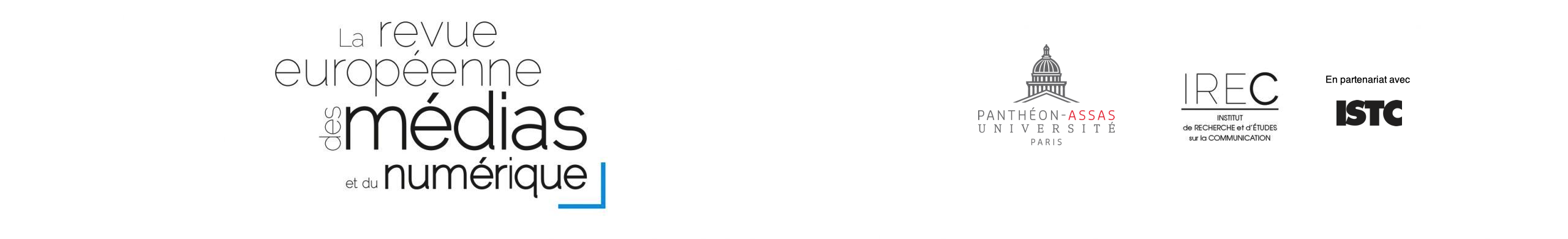Le temps est venu de tirer les enseignements de la publication, par cinq journaux occidentaux, de quelques-uns des nombreux télégrammes diplomatiques confiés par le site WikiLeaks. Triomphe de la démocratie, comme certains le prétendent ? Ou bien symptôme d’une démocratie obsédée par le fantasme de la transparence ? WikiLeaks est-il une sorte de Canard enchaîné planétaire, indispensable au fonctionnement normal d’une société qui, inlassablement, raconte ses faits et gestes en même temps qu’elle s’interroge sur elle-même ? Ou bien s’agit-il, comme on l’a prétendu dans certaines chancelleries, d’un complot ourdi contre les démocraties occidentales, une cyberattaque en règle, un véritable « 11 septembre diplomatique » ?
Revenons un instant sur un événement journalistique devenu l’affaire WikiLeaks. Le 28 novembre dernier, cinq journaux occidentaux – et non des moindres, publiaient quelques-uns seulement des 250 000 « câbles » ou télégrammes diplomatiques du Département d’Etat américain mis à leur disposition quatre mois plus tôt, par WikiLeaks, dans le plus grand secret. Fondé fin 2006, le site de Julian Assange, professionnel de l’informatique de 39 ans, s’était fait connaître en juillet 2010 pour avoir mis en ligne près de 80 000 War Logs, des documents secrets de l’armée américaine en Afghanistan, quelques semaines après avoir publié plusieurs milliers de documents fournis par des sources anonymes : parmi ces leaks (fuites), une vidéo montrait des soldats américains tirant sur des civils irakiens et sur un journaliste de Reuters. Fort de cette célébrité, le 14 août 2010, celui qui était devenu l’ennemi public n°1 du Pentagone donna à Stockholm une conférence intitulée : « La première victime de la guerre est la vérité ». En annonçant la parution prochaine de nouveaux War Logs, il se présentait lui-même comme un « militant, journaliste, programmeur de logiciels et expert en cryptographie ».
Avouons-le aujourd’hui, à la faveur d’un certain recul : comment pourrait-on reprocher aux représentants des quatre journaux – New York Times, Der Spiegel, The Guardian et Le Monde – bientôt rejoints par l’espagnol El Pais, d’avoir accepté la proposition du détenteur de pareils secrets d’Etat ? Un dirigeant d’un grand quotidien français que j’interrogeai à l’époque sur cette « affaire » me livra cette réponse édifiante : « Heureusement qu’ils ne sont pas venus vers nous ». Existe-t-il en effet un seul journal capable de résister devant la promesse de scoops et de coups médiatiques en série ? Certes, on pourra, comme certains observateurs l’ont fait, parler d’un hommage du vice rendu à la vertu. A quoi Sylvie Kauffmann, directrice du quotidien français ainsi mis en accusation, objectait qu’avant la publication des premiers mémos diplomatiques, près de 120 journalistes issus des cinq rédactions avaient échangé « beaucoup d’informations, d’analyses et d’expertises », écartant certains télégrammes dont le « sérieux » ne semblait pas garanti, et « rayant des noms ou des indications pour protéger la sécurité des personnes ».
« 11 septembre diplomatique » : la formule est du ministre italien des affaires étrangères, quelques heures après la publication des premières notes diplomatiques. De son côté, Hillary Clinton déclarait que ces révélations mettaient en péril la sécurité nationale des Etats-Unis. Le bruit médiatique fut pourtant très vite étouffé, victime de son propre succès, sur fond de commentaires révélateurs de l’air du temps. De leur propre aveu, les acteurs des relations internationales n’ont guère appris grand-chose qu’ils ne savaient déjà : sur le double langage de plusieurs capitales arabes vis-à-vis de l’Iran, sur les avertissements lancés en vain par Israël auprès de l’administration américaine. Les lecteurs européens, de leur côté, ne se sont pas amusés très longtemps en constatant que les notes diplomatiques américaines égratignaient leurs dirigeants respectifs. Il n’est même pas sûr que l’image de la diplomatie américaine, même avant la chute de Ben Ali, plutôt que ridicule pour s’attacher à des détails insignifiants, ne soit pas sortie grandie de ces révélations, le New York Times allant jusqu’à affirmer qu’elles soulignent au contraire la sagesse du gouvernement de Washington quand il résiste aux pressions de ceux qui voudraient mener des frappes préventives contre l’Iran.
Peu importe pourtant qu’il ne s’agisse que de « pseudo-révélations », de la confirmation de ce que tous les observateurs savent depuis longtemps, de l’irritation bien compréhensible des personnes dont on souligne les travers ou le double langage. L’important est ailleurs : WikiLeaks marque déjà, symboliquement, une étape nouvelle dans l’épopée du journalisme et de l’information modernes. Non pas, certes, que les enjeux de l’information aient changé. Pas davantage que le rôle et le statut des journalistes soient différents de ce qu’ils sont devenus, au fil des ans, au moins dans les démocraties dignes de ce nom. Mais parce que les règles du jeu ne seront plus jamais ce qu’elles ont été depuis la naissance des grands quotidiens, au milieu du XIXe siècle. Parce que leur façon de raconter « ce qui se passe », près de nous ou dans le vaste monde, de faire un tri parmi les événements de l’actualité, de prendre le recul nécessaire pour les analyses, les interpréter et, le cas échéant, les commenter, devra dorénavant tenir compte des outils nés avec Internet.
WikiLeaks concentre l’attention sur ces nouveaux outils, arrivés bien avant lui sur le terrain de l’information qui ressemble de moins en moins à un jardin à la française et de plus en plus à un jardin à l’anglaise : les SMS, les blogs, les agrégateurs de nouvelles, les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter ainsi que les sites d’information, natifs de la Toile ou compagnons des médias d’information devenus pareillement, semblablement, traditionnels, conventionnels ou historiques. C’est cette machinerie qu’il conviendra désormais de considérer et d’évaluer à sa juste valeur puisqu’elle modifie les conditions de la collecte des faits de l’actualité, la façon dont y accèdent, d’ores et déjà, les journalistes et tout un chacun.
Il est facile, assurément, de vanter les mérites de ces nouveaux outils, à la fois complémentaires et supplémentaires par rapport à leurs illustres aînés, d’autant plus facile que ces mérites semblent forgés pour servir une information de tous enfin objective et complète. Pour le droit à l’information, les nouveaux moyens dont WikiLeaks est devenu le chef de file sont comme une promesse trop longtemps attendue. Avec le numérique, c’est la floraison de sources nouvelles d’information ou d’expression, pour tous et pas seulement pour les journalistes : pour ceux que l’on condamne au silence, hier en Tunisie, aujourd’hui en Iran, pour alerter sur des faits que des médias trop prudents ou pusillanimes refusent de révéler. C’est également la rapidité avec laquelle certains témoignages peuvent être rapportés par des amateurs qui s’improvisent journalistes, depuis l’atterrissage d’un avion civil sur le fleuve Hudson jusqu’aux attentats du métro de Moscou. C’est enfin et surtout la spontanéité et la sincérité avec lesquelles n’importe quel internaute ou mobinaute peut désormais exprimer ses sentiments, ses opinions ou ses préoccupations.
WikiLeaks révèle pour la première fois le revers de la médaille : en ouvrant à nouveau le débat sur les responsabilités des médias d’information, en soulignant leurs véritables enjeux, il est devenu, sans le vouloir, le symptôme d’un malaise, voire d’un mal, qui frappe l’information et ses professionnels. Involontairement, mais d’une façon qui peut être salutaire, l’affaire WikiLeaks éclaire les dérives qui guettent aujourd’hui le journalisme, sous l’effet conjoint des technologies numériques et de l’air du temps.
WikiLeaks eut l’effet tout à la fois d’une mise en garde et d’une mise en demeure. La publication des câbles diplomatiques a mis en garde contre une certaine désacralisation des faits ou des événements qui font l’actualité. « Les faits sont sacrés, le commentaire est libre » : adressée aux journalistes français des débuts de la IIIe République, la recommandation n’a pas pris une ride. Des journalistes, nous attendons qu’ils relatent les faits de l’actualité dans leur exactitude ou leur véridicité, que les événements de cette histoire qu’ils écrivent « au présent », pour parler comme Albert Camus, ne soient pas occultés ou édulcorés, ni qu’ils soient déformés ou grossis, par négligence ou bien au gré d’un parti pris inavoué.
Les faits ne sont pas des fuites, ni des rumeurs postées sur la Toile par des internautes protégés par l’anonymat. En l’occurrence, on ne peut manquer de relever cette affirmation péremptoire de ce journaliste du Monde interrogé par l’AFP à propos des mémos de WikiLeaks : « Nous n’avons pas de raison particulière de douter de leur authenticité ou de penser qu’il puisse y avoir des faux ». La profusion, à l’évidence, peut conduire à une certaine confusion : les rumeurs les plus dévastatrices voisinent, sur Internet, avec les révélations plus ou moins aisément vérifiables. Raymond Queneau avait lancé un avertissement qu’il faut aujourd’hui méditer : « Il serait bien affreux que tout fait imbécile méritât commentaire, exégèse subtile ».
La mise en demeure suit naturellement la mise en garde : très opportunément, WikiLeaks rappelle que si les faits doivent être établis, avérés, vérifiés, rétablis avec véracité dans leur véridicité, ils valent seulement par l’interprétation qui en est donnée, par l’analyse qui en est faite, avec autant de rigueur que possible. C’est ce que les journalistes appellent la mise en perspective. A quoi s’ajoutent, le cas échéant, après qu’une signification a été donnée au fait ou à l’événement, un commentaire ou une appréciation, qui n’est jamais aussi aisé à séparer qu’on le voudrait de l’analyse ou de l’interprétation, ce qui requiert de la part du journaliste devenu éditorialiste ou chroniqueur, une absolue sincérité. La véracité, la rigueur et la sincérité ne sont-elles pas les vertus de la vérité ? Certes, le journaliste, comme l’historien, sait qu’il n’accède jamais qu’à des vérités partielles, imparfaites, approximatives, provisoires, mais au moins doivent-ils vouloir pareillement, l’un et l’autre, que ces vérités ne soient entachées d’aucun esprit partisan, qu’elles soient, en d’autres termes, aussi peu subjectives que possible. Toujours inaccessible, comme avec n’importe quel idéal, l’objectivité doit parfois s’accommoder de l’aveu d’une inévitable subjectivité. L’affaire WikiLeaks n’a pas seulement agi comme un rappel des règles les plus sacrées d’un journalisme indépendant : elle a également montré les limites, voire les dangers, de l’exigence de transparence. Le droit « de chercher, de recevoir et de répandre des informations », comme le souligne Emmanuel Derieux (voir infra), ne saurait être absolu : il se heurte à un autre droit, tout aussi fondamental, le droit au secret, même si les exceptions à la liberté d’expression appellent, selon le juriste, « une interprétation étroite », comme toujours, au demeurant, quand des limitations sont apportées à l’exercice d’une liberté tenue pour fondamentale. Reste la question, à proprement parler anthropologique, bien plus encore philosophique, de la nature du secret, de son objet, de son étendue et, ultimement, de sa signification pour les personnes ou les collectivités concernées. A tous les niveaux des relations entre les hommes ou entre les groupes, la nécessité de sauvegarder des secrets est impérieuse. L’exigence de transparence se heurte, à l’intérieur de nous-mêmes, au refus de tout dévoiler : chacun a droit à ce que Malraux appelait son « petit tas de secrets ». « La vérité d’un homme, c’est d’abord ce qu’il cache » disait-il encore. Existe-t-il une liberté plus fondamentale que celle consistant à ne pas forcer quelqu’un à dire ce qu’il pense ? Refuser de faire connaître aux autres ce que l’on sait soi-même est bien souvent une forme de respect. Toute vérité n’est pas « bonne à dire » : le médecin obéit à l’adage populaire vis-à-vis de son patient, comme le professeur à l’égard de son élève. L’un et l’autre savent bien que dans le « colloque singulier » qu’ils engagent, il ne faut jamais donner à leur vis-à-vis que la dose de vérité qu’il est capable de supporter. Déroger à cette règle, c’est prendre le risque, dans tous les cas, d’entamer, voire de perdre, cette confiance réciproque qui est la condition de tout dialogue, de toute volonté de « communiquer » avec autrui.
Pourquoi ce qui est vrai dans les relations interpersonnelles ne le serait pas tout autant, et pour les mêmes et ultimes raisons, dans les relations entre les collectivités humaines, qu’il s’agisse des entreprises ou des Etats ou des civilisations ? L’espionnage industriel existe depuis que l’industrie existe et la guerre économique est devenue une affaire d’Etat. Y aurait-il enfin une activité diplomatique, sur fond de guerre et de paix, sans négociations secrètes ? En 1926, Jules Cambon constatait : « Pour si peu que l’on ait été responsable des intérêts de son pays à l’étranger, on se rend compte que le jour où il n’y aurait plus de secrets dans la négociation, il n’y aurait plus de négociation du tout ». A propos de WikiLeaks, en décembre 2010, Dominique Moïsi, spécialiste des relations internationales, ne disait pas autre chose : « Cet excès de transparence ne peut que conduire au retour de la diplomatie secrète et à des formes actualisées de ce qu’on appelait hier « le secret du roi » ».
WikiLeaks, en quelques semaines, était devenu pour les relations internationales ce que Facebook avait fini par représenter pour la vie privée des personnes. L’un et l’autre sont victimes de leur propre succès. Au moins ont-ils eu le mérite de remettre au goût du jour la recommandation populaire : il n’y a pas de secrets mieux gardés que ceux que l’on garde soi-même. Ce que La Bruyère exprimait autrement : « Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a confié ». Nous éviterons de confondre la démocratie avec la transparence, l’information avec les ragots ou les rumeurs, le jour où sera moins répandu le sentiment qu’ « on ne nous dit pas tout », le jour où nous abandonnerons les théories du complot et du bouc-émissaire, le jour où nous admettrons enfin qu’il n’y a de transparence, en démocratie, que si l’on tient les secrets pour légitimes, entre les personnes, entre les entreprises, entre les nations, entre les Etats. Cette harmonie n’est pas une affaire de décrets ou de lois : elle est le fruit de ce qu’on appelle le civisme.