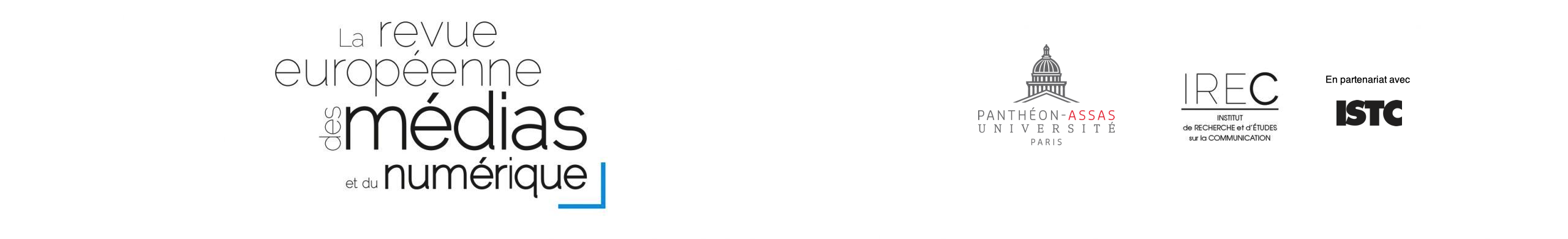Un réseau fragile
Un triomphe au goût amer
Une nébuleuse impressionnante
La seconde génération
Un retournement de situation irréversible
Le cinéma français, aujourd’hui comme hier : La revue européenne des médias et du numérique a souhaité s’associer à la célébration des 120 ans du Cinématographe, en invitant dans ses pages Pierre Lherminier, auteur des magistrales Annales du cinéma français (Nouveau Monde éditions, 2012). Contrefaçon, protectionnisme et mondialisation : de 1896 à 1914, les premières années du cinéma reflètent de façon édifiante ce que sera la destinée de cette invention, tout au long du XXe siècle et jusqu’à aujourd’hui. Le 7e art est bien né comme une industrie.
Alors qu’il rédige, à partir de 1937, son autobiographie professionnelle De Pathé frères à Pathé-Cinéma (publiée, à compte d’auteur, en avril 1940), Charles Pathé, en tête d’un chapitre qu’il intitule « Vers l’industrie intégrale » et qui se rapporte à la période 1907-1914, écrit : « Il ne faut pas oublier qu’avant la guerre, de toutes les industries mondiales, le cinéma était la seule dont le centre se trouvait en France. […] Le monde cinématographique entier avait les yeux fixés sur nos ateliers, nos procédés, nos appareils. […] Nous devions être dépassés et nous le fûmes. En attendant, la France donnait le ton ». Que Pathé ait eu pour s’exprimer ainsi de bonnes raisons, et pas seulement personnelles, il suffit de se remettre en mémoire les vingt premières années du cinéma pour s’en convaincre.
Un réseau fragile
Le cinéma est né conquérant. D’emblée, il tend à l’universalité, voire à l’impérialisme. Preuve en est que le premier soin de Louis Lumière, aux premiers jours de 1896 – aussitôt expédiée la formalité du 28 décembre 1895 au Grand Café qui a rendu publique la naissance de son Cinématographe – est de recruter et de former d’urgence, à Lyon, des opérateurs, pour les envoyer en mission dans les départements, et simultanément dans le monde entier. En dépit des précautions oratoires qu’il prend pour les engager à ne pas s’illusionner sur l’avenir qu’il leur offre, comme en témoignera l’un deux, Félix Mesguich, ils seront plusieurs dizaines, au fil des mois, à signer le contrat de six mois, avec tacite reconduction, qui leur est proposé. En même temps, les Lumière concluent des contrats avec des concessionnaires locaux, auxquels les opérateurs seront rattachés. Les premiers arrivés reçoivent aussitôt la mission d’ouvrir des postes de projection dans les départements, d’autres sont envoyés à l’étranger, les uns et les autres après avoir été rapidement initiés, aux usines de Monplaisir, au fonctionnement de ce qui deviendra leur outil de travail. Certains auront une double fonction : d’abord opérateurs de projection, ils seront aussi pourvoyeurs d’images, témoignant, là où ils iront, de ce qu’est la planète, et de la vie des hommes, en ce XIXe siècle finissant. Ce faisant, ils inventent, sans le savoir, le langage cinématographique.
[pullquote] « Le monde cinématographique entier avait les yeux fixés sur nos ateliers, nos procédés, nos appareils. » Charles Pathé[/pullquote]
A l’étranger comme en France, les Lumière doivent agir vite. Car la concurrence, d’entrée de jeu, est rude. En avance, pourtant, et mieux armé techniquement, mieux accompagné aussi par une organisation soigneusement et rapidement conçue, le Cinématographe Lumière sera souvent le premier à se faire connaître, mais cette avance est souvent très courte, parfois de quelques jours seulement. Sur le plan international, c’est à Londres, le 21 février 1896, que débute ce qui va connaître, en quelques mois, une expansion foudroyante. Une priorité qui n’est pas due au hasard, Londres étant depuis plusieurs mois la plaque tournante de la compétition mondiale déjà ouverte dans ce domaine, et un foyer d’intenses recherches où la contrefaçon a toute sa part. Ce jour-là, le prestigiditateur et ombromane Félicien Trewey, ami d’Antoine Lumière comme il l’est de Georges Méliès (il figure dans plusieurs films), nanti pour l’occasion d’un contrat de concessionnaire du Cinématographe pour l’Angleterre et l’Irlande, assure dans la capitale britannique une première séance de projection. D’autres suivront, tandis que la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche sont conquis à leur tour. Au total, quelque trente pays – en Europe, mais aussi en Amérique du Sud et en Extrême-Orient – auront pu, avant la fin de l’année, découvrir et admirer les déjà fameuses « projections animées » des frères Lumière. Dans le même temps, le catalogue Lumière s’enrichit au fil des mois des « vues » que les opérateurs capteurs d’images tournent au cours de leurs déplacements.
Félix Mesguich, pour sa part, parce qu’il pratique la langue anglaise, s’est vu confier par Louis Lumière la mission toute spéciale de « faire la conquête de l’Amérique ». Il s’est embarqué au Havre en mai, avec l’appareil qui lui a été confié et qu’il a ordre de ne laisser voir de près à personne, fût-ce au concessionnaire américain auquel il va être rattaché. Dès le 29 juin 1896, conformément aux instructions reçues, il organise à New York une grande « première » dont le succès est tel, amplifié par toute la presse, qu’en quelques jours, aux dires de l’opérateur, « la renommée du Cinématographe a gagné tous les États-Unis » et que bientôt « c’est le pays tout entier qui réclame l’invraisemblable machine ». A tel point qu’il faut lui envoyer du renfort. Six mois durant, Mesguich verra ainsi débarquer chaque semaine un nouvel arrivant ; avant la fin de l’année, ils seront vingt et un, hâtivement formés à Montplaisir, à venir ouvrir de nouveaux postes de projection itinérants sur l’ensemble du territoire américain.
Cependant ces succès répétés ne plaisent pas à tout le monde, et surtout pas à Thomas Edison. Celui-ci, qui aurait pu être le rival heureux de Louis Lumière en se décidant à adapter à temps pour la projection son Kinetoscope de salon de 1891 (lancé commercialement en avril 1894), et qui n’ignore pas que le Cinématographe Lumière est précisément un dérivé de ce même Kinetoscope (on l’a qualifié en France, en toute simplicité, de « kinétoscope projecteur »), voit d’un très mauvais œil les envoyés de ses compétiteurs français le défier en quelque sorte sous ses fenêtres. Informé en temps utile des premiers succès du Cinématographe à Paris, il essaie de faire barrage à sa progression, au moins sur le terrain qu’il est susceptible de contrôler, terrain où sa suprématie est du reste déjà contestée par ses rivaux de l’American Mutoscope Company. Bien qu’il ait pu en fait devancer de deux mois la séance du 29 juin 1896 avec son propre Vitascope, l’inventeur et industriel de West Orange n’entend pas en rester là : il lancera six mois plus tard un nouveau projecteur amélioré et réactivera d’urgence ses brevets originaux de 1891, dont l’antériorité va lui permettre, pense-t-il, de reprendre et de conserver l’avantage sur ses opposants, américains ou européens.
Ignorant tout des états d’âme et des manœuvres du « sorcier de West Orange », Mesguich, porté par l’accueil enthousiaste du public, poursuit d’une ville à l’autre son activité d’envoyé spécial à double casquette : dans la journée, il est opérateur de prise de vues ; le soir, démonstrateur-projectionniste. Mais un événement étrange va tout changer : en novembre 1896, le concessionnaire W.B. Hurd disparaît sans laisser aucune trace. Un certain Freeman le remplace aussitôt, doublé cette fois d’un directeur venu de France. Ce dernier, Maurice Lafont, débarque le 1er décembre avec de larges pouvoirs, mais sans rien connaître de la mentalité américaine ni même de la langue anglaise. Ce changement de titulaire va marquer, pour la présence des Lumière en Amérique, le commencement de la fin. Par coïncidence – à moins qu’il ne faille y voir quelque manœuvre occulte – la nouvelle administration américaine issue de l’élection à la présidence du républicain McKinley (dont le frère, autre coïncidence, est administrateur de l’American Mutoscope) va se doter d’une nouvelle réglementation douanière, protectionniste et rétroactive, qui va sérieusement compromettre les activités de la firme française. Dans les premiers mois de 1897, tous les appareils Lumière introduits sur le territoire américain depuis juin 1896, alors explicitement admis comme outils de travail exonérés comme tels de droits de douane, vont se trouver soudainement hors la loi. Du même coup, les dirigeants locaux de la firme, comme les opérateurs eux-mêmes, sont désormais passibles de poursuites. Menacé d’arrestation, Lafont choisit de se placer hors d’atteinte. Tandis qu’il regagne secrètement la France (dans des circonstances rocambolesques complaisamment racontées par Mesguich), tous les opérateurs font l’objet d’un rapatriement forcé, et leur matériel est mis sous séquestre. Seul Mesguich, porteur du seul appareil qui ait échappé à la saisie, a pu passer au Canada, où il poursuivra durant quelques mois son travail de chasseur d’images, avant de rentrer à Lyon. Il n’est pas interdit de voir dans cet épisode sans gloire une préfiguration symbolique de ce que seront les relations cinématographiques franco-américaines au cours des décennies à venir. Pour l’heure, on ne peut douter qu’Edison – en la circonstance allié objectif de l’American Mutoscope, qui a soutenu McKinley dans sa campagne –, sans qu’il ait eu forcément la volonté ou le pouvoir d’intervenir sur ce chapitre, n’a eu en tout cas qu’à se féliciter de cette opportune législation.
[pullquote]Tous les appareils Lumière introduits sur le territoire américain vont se trouver soudainement hors la loi.[/pullquote]
Cet échec final des Lumière aux États-Unis les conforte opportunément dans le changement de stratégie auquel ils ont dû se résoudre. Expérience faite, le vaste réseau qu’ils ont mis en place se révèle, en raison même de son étendue et de la rapidité de son extension, impossible à gérer durablement depuis Lyon. Au surplus, quinze mois après la première séance du Grand Café, ils sont débordés sur tous les plans, qu’il s’agisse de la production de films, où d’autres font mieux qu’eux, ou du commerce des appareils, où ils se sont d’eux-mêmes exclus du marché. C’est pourquoi dès le 1er mai 1897, le Cinématographe et les films qui vont avec seront proposés à la vente. Le réseau Lumière est alors condamné : les concessionnaires deviennent autonomes, avec la responsabilité directe des opérateurs, à moins que ces derniers ne choisissent de reprendre leur liberté. Seuls les plus chevronnés, tels Promio, Mesguich et Doublier, continueront d’alimenter la société Lumière en vues nouvelles. Dans le même temps, à Paris, à l’instigation d’Antoine Lumière, la production commence à se diversifier, avec la collaboration d’un transfuge du théâtre, Georges Hatot, lequel, après avoir tourné quelques saynètes dans le style du music-hall, se lance dans une Vie et Passion du Christ en treize tableaux qui – juste retour des choses – sera importée en fin d’année avec succès aux États-Unis. Mais cette reconversion tardive ne permettra pas aux Lumière de tenir leur rang dans l’industrie cinématographique au-delà de 1905.
Un triomphe au goût amer
La vraie compétition à laquelle ils doivent faire face, ce n’est plus seulement, en 1897, celle des de Bedts, Parnaland et autres Grimoin-Sanson, inventeurs pris de vitesse par le Cinématographe et qui rêvent encore d’apporter leur contribution à l’essor des images animées. Elle a pour noms désormais, avant tout, ceux de Georges Méliès, de Charles Pathé et de Léon Gaumont, conquis dès le premier jour par la nouvelle technique et attirés par le formidable domaine d’expérimentation qui s’ouvre devant eux. De la même génération que les frères Lumière (ils ont tous entre 31 et 35 ans), ils ont de l’ambition, de l’enthousiasme à revendre.
[pullquote]Voyage dans la Lune fait surtout la fortune de ses contrefacteurs américains[/pullquote]
Propriétaire et directeur depuis 1888 du théâtre Robert-Houdin, dont les fantasmagories et les séances d’illusion font les beaux soirs du boulevard des Italiens, Georges Méliès figurait parmi les invités qui, le 28 décembre 1895, ont assisté, à l’invitation d’Antoine Lumière, à la révélation du Cinématographe. Ne pouvant l’acquérir, il s’était procuré un exemplaire du Theatograph, à Londres auprès de l’inventeur et constructeur Robert William Paul, appareil de projection que celui-ci, avec son associé Birt Acres, avait mis au point à partir, comme Lumière, du Kinetoscope Edison. Ayant également acquis quelques films, il peut, dès avril 1896, présenter aux spectateurs du théâtre Robert-Houdin ses premiers programmes cinématographiques d’importation. Pour aller plus loin, il met au point à partir du même Theatrograph, avec ses collaborateurs Reulos et Korsten, un appareil de prise de vues – une caméra, qu’ils ont dénommée Kinetographe. Le 10 juin, il tourne ses premiers films personnels dans le grand jardin de la propriété familiale de Montreuil ; des vues dans le goût de Lumière, d’abord, puis des bandes documentaires (uniformément de 20 mètres), avant de se lancer à l’automne dans la réalisation de ses premiers films à scénario et à trucages. Au total, il aura tourné dans l’année quelque quatre-vingts films. Il n’en tournera que cinquante l’année suivante, mais sensiblement plus élaborés, grâce au « théâtre de pose » – le premier « studio » – qu’il a fait construire durant l’hiver. Il y aborde des genres nouveaux, du comique aux actualités reconstituées, sans oublier le fantastique, où il expérimente la surimpression. Sa production se maintiendra ensuite, et jusqu’en 1909, à un niveau annuel moyen de trente à quarante films, le plus souvent d’une bobine, parmi lesquels apparaîtront régulièrement des films plus ambitieux, à scénario plus complexe donnant lieu à de nombreux « tableaux », multipliant les innovations techniques et stylistiques, et qui pourront atteindre une durée de plus de vingt minutes. Le sommet artistique, mais aussi technique et commercial, sera atteint en 1902, avec Voyage dans la Lune, inspiré de Jules Verne, qui n’excède pas treize minutes, mais auquel le raffinement décoratif et l’imagination créatrice dont il témoigne, vaudront — en même temps qu’un prix de revient exorbitant — une célébrité universelle, amplifiant celle que son auteur s’était déjà acquise, en particulier en Amérique. Ce triomphe lui laisse pourtant un goût amer : tout compte fait, ainsi que Méliès l’attestera lui-même dans ses mémoires, l’exploitation du Voyage dans la Lune, en dépit des centaines de copies vendues partout aux forains et autres « exhibiteurs » de films, se solde par un déficit de 20 000 francs-or. Et cela parce que, diffusé et montré dans le monde entier, Voyage dans la Lune fait surtout la fortune de ses contrefacteurs américains, à commencer par la compagnie Edison et la Biograph, qui, à partir de copies acquises le plus normalement du monde à Paris par des hommes de paille, ont contretypé le film à outrance pour en inonder le marché, aux États-Unis et ailleurs, en dépit souvent des concessionnaires réguliers de la Star-Film. Fort de cette leçon, Méliès, moins d’un an plus tard, en 1903, installera à New York un bureau permanent, dont son frère Gaston prendra la responsabilité. 1902 est aussi chez Méliès l’année du Couronnement d’Edouard VII, film conçu et mené à bien avec son partenaire britannique Charles Urban. L’avènement du fils de la reine Victoria fait l’objet d’une actualité préconstituée, en quelque sorte, associant prises de vues réelles effectuées à Londres le jour même par les soins d’Urban, et scènes fictives jouées d’avance par des interprètes improvisés. Ce coup d’audace, coup de maître par ses résultats, consolidera un peu plus, malgré les polémiques qu’il a pu inspirer, l’intérêt porté en Angleterre à l’œuvre du magicien de Montreuil, en particulier depuis son magnifique Jeanne d’Arc, en douze tableaux avec un grand nombre de figurants, tourné en 1900 dans un « théâtre de pose » agrandi. Méliès, avec déjà la complicité de Charles Urban, a réussi à y traiter avec délicatesse et à faire mieux qu’accepter outre-Manche, un sujet qui n’y allait pas de soi.
Une nébuleuse impressionnante
Charles Pathé, de son côté, s’est intéressé à l’image animée à travers le Kinetoscope. Après une jeunesse hésitante et aventureuse, il découvre d’abord par hasard, en août 1894, le phonographe, invention d’Edison en 1878, commercialisé en France depuis 1888. Il s’installe comme importateur, en se fournissant, à Londres, en appareils de contrebande, avant de lancer, pour favoriser la vente des appareils, ses propres enregistrements. Il fera de même avec le Kinetoscope, dont Robert William Paul lui fournira, depuis Londres, de très convenables contrefaçons. Associé pour un temps à l’inventeur Henri Joly, il songe à lancer, avec lui, un kinétoscope amélioré, devenu, après leur rupture, le Kinétrographe Pathé. Mais la séance du 28 décembre 1895 au Grand Café le fait changer de voie, désormais convaincu que c’est au cinématographe qu’appartient l’avenir. Moins d’un an plus tard, en 1896, avec son frère Émile, il crée la société en nom collectif Pathé Frères, au capital de 40 000 francs, qui a pour objet la commercialisation des phonographes et des kinétographes. La société ouvre un magasin à Paris et un atelier à Vincennes, où Charles Pathé s’emploie sans retard à tourner des films, inspirés d’abord tout naturellement du modèle Lumière. Ainsi commence, modestement, l’histoire d’une entreprise appelée à connaître en peu d’années une expansion fulgurante. Consolidée en décembre 1897 par un apport en capital du groupe industriel et financier Neyret, devenue société anonyme au capital d’un million de francs, la désormais Compagnie générale des cinématographes, phonographes et pellicules (raison sociale qui variera à plusieurs reprises au cours des années) va s’imposer rapidement, dans ces deux domaines, au premier plan parmi les entreprises mondiales – évolution que traduira celle de son capital social, lequel, en plusieurs étapes, atteindra trente millions en 1912, bénéfices et dividendes suivant à très peu près la même marche ascendante. Longtemps prédominante, la branche phonographique qui, en 1900, assure 90 % du chiffre d’affaires de la compagnie, sera distancée à partir de 1907. C’est en 1900, à la suite de l’Exposition universelle de Paris et après l’engagement de Ferdinand Zecca, puis celui de metteurs en scène et d’acteurs, que la production cinématographique de Pathé prend véritablement son essor, dans des proportions qui, d’une année à l’autre, deviendront considérables.
[pullquote] « Le montant des recettes d’Amérique représentait (…) un bénéfice net. » Charles Pathé[/pullquote]
Peu active jusqu’alors, l’exportation s’organise à partir de 1902, avec l’ouverture d’agences à Londres et à Berlin. L’année suivante, la compagnie part à la conquête des marchés russe, autrichien, italien et espagnol. En 1904 s’ouvrent à New York un magasin de vente et une agence ; d’autres à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg. En 1906, ce sont de véritables succursales que la compagnie installe à Londres, Amsterdam, Barcelone, Milan et Odessa. Cette année-là, les agences et succursales de l’étranger lui assurent déjà 60 % de son chiffre d’affaires. A la fin de l’année suivante, elle pourra compter au total sur dix-huit succursales réparties dans neuf pays européens, en Amérique du Nord et en Asie (à Calcutta et Singapour). Charles Pathé écrit qu’à cette date « le marché américain amortissait à lui seul le prix de revient, alors modeste, des négatifs » fabriqués dans les usines de Pathé Frères, c’est-à-dire des nouveaux films produits ; au surplus, le chiffre d’affaires assuré par ce seul marché équivalant à celui de toutes les autres succursales, il ajoute que « le montant des recettes d’Amérique représentait, ou peu s’en faut, un bénéfice net ». Cette conviction acquise, l’industriel lance au début de l’été, en 1907, à Bound Brook (New Jersey), la construction d’une usine destinée à effectuer sur place les travaux de laboratoire nécessaires à l’approvisionnement direct du marché local. L’année 1909 voit apparaître sur le marché, à commencer par la France, les premiers films produits à l’étranger par les filiales Pathé : en Italie avec la Film d’Arte italiano, en Russie avec la Pathé Rouss. Il s’agit en l’espèce d’une nouvelle orientation de la production, en même temps que d’une forme nouvelle, pour la firme française, d’occupation du terrain, qui n’auront plus de fin : à compter de 1910, après ceux de la filiale japonaise The Japanese Film Art, ce seront des films Pathé produits en Amérique que pourront voir les spectateurs parisiens ainsi que leurs homologues du monde entier. Un studio a été construit spécialement à cet effet à Jersey City et confié à la direction de Louis Gasnier, qui a fait ses premières armes à Paris et à Rome. Trois ans plus tard, les premiers serials sortiront de ce même creuset. Dans le même temps, à Budapest, à Barcelone, à Amsterdam, à Bruxelles, d’autres filiales de production seront venues contribuer à cette entreprise considérable. Ce n’est pas encore l’empire Pathé, mais l’implantation mondiale que s’est donnée la Compagnie générale en fait déjà une nébuleuse impressionnante, d’une dynamique formidable.
La seconde génération
Léon Gaumont, quant à lui, a été l’un des tout premiers adeptes du Cinématographe, déjà installé comme professionnel de l’industrie photographique. Il a eu à ce titre le privilège d’assister, en mars 1895, à la toute première séance privée organisée par les frères Lumière. Dès lors, il n’a eu de cesse de jouer un rôle dans le développement de cette nouvelle technique. En relation avec l’inventeur Georges Demenÿ, dont il va exploiter les brevets, il se lance sans tarder dans la construction d’appareils de projection et de prise de vues. La production de films viendra plus tard, sous l’impulsion de sa secrétaire, Alice Guy, qui le convaincra d’associer cette activité à la construction mécanique. Très tôt, avec le concours de ses ingénieurs, il s’intéressera au problème du synchronisme de l’image et du son, puis à celui de la couleur, domaines où il poursuivra les recherches avec une persévérance dont l’insuccès ne le découragera jamais. Constituée en 1895 au capital de 200 000 francs, la société en commandite Léon Gaumont et Cie connaît son plein développement à partir de 1905, après l’entrée dans son capital de la Banque suisse et française. Elle devient alors la Société anonyme des établissements Gaumont (SEG), au capital de 2 500 000 francs, qui passera à quatre millions en 1913. La SEG entreprend aussitôt de se doter de l’instrument indispensable à son expansion, avec la construction aux Buttes-Chaumont d’un vaste théâtre de prises de vues jusqu’alors sans équivalent. Celui-ci deviendra, en 1907, après le départ d’Alice Guy, le champ d’action de Louis Feuillade, qui à la tête d’une remarquable troupe de metteurs en scène, de techniciens et de comédiens, mènera à bien jusqu’à la guerre une production éclectique où domineront, aux côtés de séries burlesques appelées à devenir classiques et des mélodrames de la série La Vie telle qu’elle est (1911-1913), les films policiers à épisodes du cycle mythique des Fantômas (1913-1914). Au sein de cette équipe, à partir de 1911, Suzanne Grandais deviendra en quelques mois une vedette populaire dans le monde entier, comme le sont, chez Pathé, dans le registre comique, Max Linder, Prince-Rigadin et André Deed. Moins bien implantée que la compagnie Pathé sur le plan international, la SEG n’en a pas moins installé au cours des années des agences et des succursales dans la plupart des pays d’Europe, ainsi que des comptoirs en Australie et en Extrême-Orient, aussi bien qu’à New York, souvent associés à des laboratoires dédiés au tirage des copies. En 1911, la SEG, déjà présente dans l’exploitation, distance tous ses rivaux en ouvrant le Gaumont-Palace, immense vaisseau qui, avec ses 3 400 places assises, ses équipements et sa décoration, sera alors le plus grand et le plus luxueux cinéma du monde.
[pullquote]L’industrie américaine semble dépassée par une offensive française qui ne paraît connaître ni répit ni limites.[/pullquote]
Pour exemplaires que soient ces entreprises par leur parcours et leur renom, elles ne furent pas longtemps seules, en France, à s’imposer dans l’industrie cinématographique. En 1906 apparaîtront successivement la compagnie L’Éclipse, antenne française de la société britannique Urban Trading, et la Lux, à la création de laquelle participe l’inventeur Henri Joly. Au cours des deux années suivantes entreront en activité la compagnie Radios, où se retrouvent des anciens de chez Lumière ; L’Éclair de Jourjon et Vandal ; et surtout, dans le sillage de Pathé, le Film d’Art et la Société cinématographique des auteurs et gens de lettres (SCAGL), qui prétendent l’une et l’autre rénover et « ennoblir » le cinéma par des œuvres d’inspiration littéraire et théâtrale. Ainsi se manifeste une seconde génération d’entrepreneurs, qui ne tarderont pas à montrer leurs capacités et leurs ambitions. L’Éclipse sera en 1912 à l’origine du film Elisabeth, reine d’Angleterre, avec Sarah Bernhardt, production franco-britannique dont l’exclusivité a été acquise pour l’Amérique par Adolf Zukor. Le succès de cette opération permettra à ce dernier de constituer la compagnie Famous Players Pictures, dont naîtra plus tard la Paramount. Quant à l’Éclair, elle affirme très vite ses ambitions en suivant de près le modèle Pathé-Gaumont, jusque dans sa politique d’expansion, favorisée par une production audacieuse et intelligente autant que populaire, caractérisée par les premiers films à épisodes de Victorin Jasset, d’inspiration américaine, de la série Nick Carter. Dès 1910, elle ouvre des bureaux à New York et y constitue une filiale de production, l’Eclair Film Company, pour laquelle une usine sera construite à Fort Lee (New Jersey). Sans doute trop rapide pour une entreprise au financement fragile, cette expansion se verra toutefois arrêtée brutalement, en mars 1914, par l’incendie qui dévastera ses installations de Fort Lee, et par l’approche de la guerre, événements qui pousseront alors ses dirigeants à se défaire hâtivement de ses actifs américains.
[pullquote]Hors de la MPPC, « il serait interdit de fabriquer ou de vendre un seul pied de film sur tout le territoire américain. » Georges Sadoul[/pullquote]
Un retournement de situation irréversible
On peut s’étonner que l’industrie américaine, pour sa part, semble dépassée par une offensive française qui ne paraît connaître ni répit ni limites. Cette situation, qui n’est pas qu’apparente, trouve son origine de part et d’autre de l’Atlantique. En France, le développement de l’exploitation, pour réel qu’il soit, notamment grâce à la création accélérée de salles urbaines à partir de 1906, ne lui permet pas, loin de là, d’absorber la production nationale, contraignant les entreprises productrices à compenser ailleurs les insuffisances du marché intérieur. Outre-Atlantique, inversement, le développement de l’exploitation est vertigineux, alors que la production peine à la satisfaire : selon une enquête parue en 1912 dans la presse corporative parisienne, les États-Unis disposent alors d’un écran pour moins de 6 500 habitants, la France pour 20 000 ; deux ans plus tard, l’écart se sera encore creusé. D’où la nécessité impérieuse, pour les exploitants américains, de répondre, par l’importation, à des besoins considérables en films. Sans être seule sur ce terrain, la France est la mieux placée pour tirer parti de cette situation paradoxale, qui n’est certes pas appelée à durer. La vérité est que depuis 1897 et sa victoire éclatante sur le Cinématographe Lumière, Edison, arc-bouté sur ses brevets et conforté par une jurisprudence favorable, a presque totalement verrouillé la production dans son pays, où seules les compagnies Biograph et Vitagraph parviennent malgré lui à survivre – et à exporter. Ce qui est resté dans l’histoire sous le nom de « Guerre des brevets » n’a pris fin qu’en novembre 1907, avec l’offre faite par Edison aux éditeurs de films agréés par lui sur le marché américain de signer une convention définissant leurs droits et le prix à payer pour les faire valoir…. Suivra, un an plus tard, en 1908, la constitution à New York, sous les auspices du même Edison, de la Motion Pictures Patents Company (MPPC), hors de laquelle, écrira Georges Sadoul, « il serait interdit de fabriquer ou de vendre un seul pied de film sur tout le territoire américain ». Seules firmes françaises agréées, la Star Film de Méliès et la compagnie Pathé pourront trouver dans cet accord (qui autorise à chacune d’elles un certain métrage hebdomadaire de négatif) une ouverture propice au développement de leurs affaires sur ce marché. Méliès, encouragé par son frère, tentera d’aligner sa production sur le métrage autorisé (300 m de négatif par semaine) et fera même construire un nouveau « théâtre de pose » pour en augmenter le rythme. Il n’y parviendra pas et prendra au surplus le risque, en favorisant la quantité, d’abaisser la qualité de ses films. Asphyxié financièrement, esthétiquement dépassé, et désabusé, il mettra un terme à sa production directe en mai 1909, pour tourner ses derniers films en 1911 et 1912 après être passé sous les fourches caudines de Pathé — et de Ferdinand Zecca. Désormais sous contrat elle aussi avec la MPPC, la compagnie Pathé, loin d’y voir une porte ouverte, n’aura de cesse que de se libérer de ce qui est en fait un carcan. Il en résultera en 1913 et 1914 une crise aiguë, qui ne se résoudra, à la veille de la guerre, que grâce à l’audace et à la clairvoyance de Charles Pathé, et aux appuis qu’il saura trouver sur place dans ce conflit.
[pullquote]« … Aucun doute ne pouvait subsister sur l’issue de la concurrence franco-américaine en matière de cinéma ». Charles Pathé [/pullquote]
Dans le même temps, la pénétration américaine sur le marché français sera devenue irrésistible. Charles Pathé lui-même le reconnaîtra explicitement dans le texte déjà cité, où, après avoir évoqué la prédominance française des années passées, il ajoute: « Sans doute, à partir de 1910, un mouvement inverse commençait à se dessiner en Amérique, et, pour un observateur averti, aucun doute ne pouvait subsister sur l’issue de la concurrence franco-américaine en matière de cinéma ». La guerre, à laquelle on attribuera trop aisément ce retournement de situation, ne fera en réalité qu’amplifier, en le rendant irréversible, une évolution déjà en cours. Dès lors, la cinématographie française, jusqu’ici si conquérante, devra entrer en résistance, en usant au besoin de la collaboration (entendez la participation active, entre 1915 et 1918, des grandes firmes françaises elles-mêmes à l’importation de films américains), avant d’imaginer plus tard la parade contestable du contingentement.
Du moins le cinéma français aura-t-il connu ces années d’une heureuse adolescence, bercée d’illusions, où ceux qui le servaient ont pu s’imaginer qu’il pouvait bénéficier d’une suprématie définitive, que seules des circonstances imprévisibles et tragiques pourraient lui faire perdre. Quelque chose en a subsisté dans la conscience collective, qui n’a jamais vraiment accepté une déchéance aussi évidemment imméritée. Il en est résulté, chez tous ceux qui à un moment ou un autre se sont préoccupés de ses destinées, un désir secret de revanche, une volonté d’être, qui éclaire aujourd’hui encore toute son histoire.
Sources :
- De Pathé Frères à Pathé-Cinéma. Monaco, Charles Pathé, chez l’auteur, 1940, réédition intégrale cumulative in Ecrits autobiographiques, établie et présentée par Pierre Lherminier, Ed. L’Harmattan, Paris, 2006.
- Tours de manivelle, Félix Mesguich, éd. Bernard Grasset, Paris, 1933.
- Histoire générale du cinématographe, T.2. Les Pionniers du cinéma, 1897-1909, Georges Sadoul, éd. Denoël, Paris, 1948, rééd., 1973.