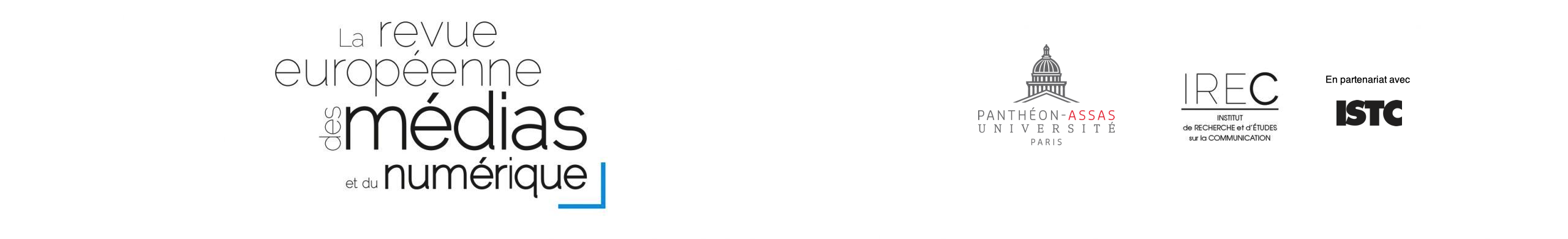Quand Pôle emploi collabore avec Kelly Cruz, jeune carreleuse dans le BTP et influenceuse au 1,5 million d’abonnés sur TikTok
En 2022, selon une étude citée par le Conseil d’État, 60 % de la population mondiale, soit 4,2 milliards de personnes passent en moyenne 145 minutes par jour sur des réseaux sociaux, essentiellement américains ou chinois. Tout en mesurant la retenue dont la puissance publique doit faire preuve dans « un écosystème essentiellement privé », mais dont les enjeux de souveraineté sont flagrants, le Conseil d’État propose une analyse des problématiques et des opportunités des réseaux sociaux à son endroit. Un réseau social est « une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter, de partager, de découvrir et de communiquer entre eux sur plusieurs appareils notamment via des chats, des publications, des vidéos et des recommandations ». C’est la définition utilisée par le règlement européen Digital Markets Act (DMA) du 14 septembre 2022 (publié au Journal officiel de l’Union européenne le 12 octobre 2022, avec entrée en vigueur le 1er novembre 2022, mais dont les mesures ne seront applicables que six mois plus tard, soit le 2 mai 2023) qui vise à encadrer les géants du web pour prévenir leurs éventuels abus de position dominante sur le marché européen. Avec le Digital Services Act du 19 octobre 2022 (publié au JOUE le 27 octobre 2022, avec entrée en vigueur le 16 novembre 2022, mais dont la plupart des règles seront applicables le 17 février 2024), ces deux règlements européens fixent un cadre général de régulation des marchés et des services des plateformes numériques en Europe (voir La rem n°61-62, p.100).
La deuxième partie du rapport s’attache à identifier les enjeux, notamment ceux liés à « l’autonomie et la préservation de la démocratie », aux transformations de l’espace public, tout en explorant la manière dont ils pourraient servir l’action publique. Le rapport se clôt sur une série de recommandations à destination de la puissance publique, organisées autour de trois axes visant à « rééquilibrer les forces au profit de l’utilisateur et du citoyen », « armer la puissance publique pour réguler et optimiser l’usage des réseaux sociaux », appelant ainsi à l’élaboration d’une charte des droits fondamentaux à l’ère du numérique, à l’échelle européenne.
Les réseaux sociaux ont un impact sur tout et tout le monde. Pour Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d’État, « en bouleversant nos manières de communiquer, ces lieux de rencontre et de dialogue numériques multiformes, qui ne cessent de se transformer, ont profondément remis en cause les cadres traditionnels de la vie en collectivité […]. Aucun domaine ni aucune institution ne semble ainsi épargné par l’émergence de ces outils, essentiellement privés, indifférents aux frontières nationales et qui reposent tous sur un modèle de relations horizontales et multicentriques, dénué d’autorité unique ».
Le rapport s’attache notamment à analyser la manière dont certaines administrations se sont emparées des réseaux sociaux, pour diffuser des informations, assurer la promotion d’actions d’intérêt public ou encore pour améliorer leurs propres performances. Des administrations utilisent les réseaux sociaux pour se rapprocher des publics les plus jeunes, des collectivités territoriales et engagent même des gestionnaires de communautés (community managers) pour suivre en temps réel les interactions qui en découlent et développer ainsi une communication adaptée à ces nouveaux canaux. Les ministères, le Service d’information du Gouvernement (SIG), le Conseil d’État sont quelques-unes de ces administrations publiques actives sur ces réseaux sociaux. La Police nationale y est présente depuis 2012, à travers des comptes Facebook et Twitter, avec pour objectif de promouvoir « le rapprochement entre la police et la population, et, en particulier, les publics juvéniles ; la valorisation de la police et de son action ; le recrutement ; la diffusion de campagnes de prévention ; et, de plus en plus, l’information du public dans les situations de crise » détaille le rapport.
Certaines administrations voient également dans l’usage des réseaux sociaux l’opportunité de promouvoir des politiques publiques, parce qu’ils présentent « l’intérêt de rassembler de nombreuses personnes et de faciliter des actions de consultation, autrefois lourdes et complexes ». Pôle emploi, établissement public à caractère administratif en charge de l’emploi en France, s’est aperçu en 2019 que « 75 % des demandeurs d’emploi inscrits étaient actifs sur les réseaux sociaux notamment pour y rechercher un travail ». Après avoir formé ses agents en interne, notamment aux obligations de réserve et de neutralité dont doit faire preuve l’administration publique, ainsi que sur le volet de la vie privée, Pôle emploi a développé, selon chaque réseau social, une ligne éditoriale afin de diffuser des informations de proximité sur le marché de l’emploi. En 2022, la page Facebook de Pôle emploi compte 150 000 abonnés et s’appuie sur un réseau de 1 500 collaborateurs, appelés « ambassadeurs », qui « valorisent l’action de Pôle emploi et font connaître ses services ». L’administration va même jusqu’à collaborer avec certains influenceurs, comme Kelly Cruz, une jeune carreleuse suivie par 1,5 million de personnes sur le réseau social TikTok, et dont la communication visait à dépasser certaines fausses idées sur les recrutements dans le secteur de la construction et du bâtiment et travaux publics.
Les réseaux sociaux : enjeux et opportunités pour la puissance publique, Conseil d’État, Étude annuelle, 13 juillet 2022.