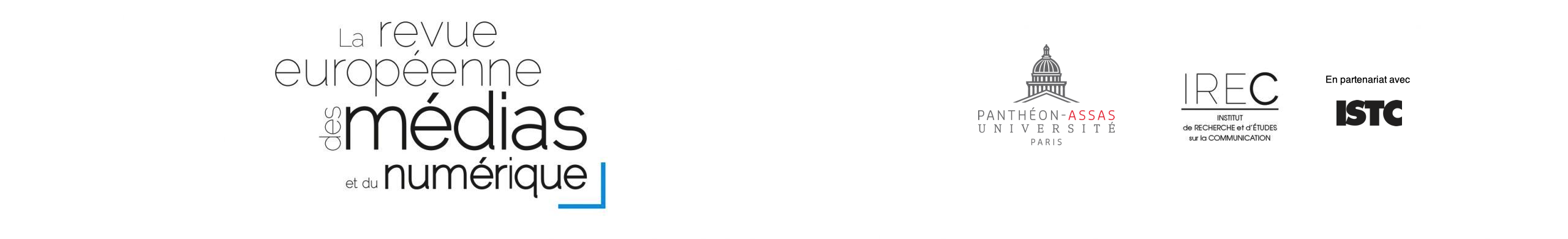Il y a deux côtés à une même pièce. Cette métaphore illustre bien ce que vivent les femmes en tant que journalistes au Brésil, en particulier depuis 2010. Elles sont de plus en plus nombreuses à être victimes de harcèlement, de menaces, de blocages divers dans l’exercice de leur métier, et les violences qu’elles subissent, en ligne ou non, dépassent l’objet de leur travail : c’est leur genre qui devient la cible.
Pourtant, ce sont des femmes que l’on trouve majoritairement à la tête de nouvelles organisations, innovantes et indépendantes, qui osent briser la concentration du secteur et apporter d’autres récits et d’autres façons de faire du journalisme au Brésil.
Le pays n’a jamais su protéger ses journalistes. Si les conditions se sont améliorées depuis la redémocratisation du Brésil à partir de 1985, leur travail reste difficile, surtout dans un pays où la concentration des richesses et les inégalités sont toujours plus dénoncées dans des reportages d’investigation. Avec l’élection d’un président d’extrême droite qui a occupé entre 2019 et 2022 la plus haute fonction de l’État au sein d’une démocratie encore fragile, la situation s’est rapidement et considérablement dégradée.
Selon l’Unesco, depuis 2010, près de cinquante journalistes ont été assassinés au Brésil, deuxième pays le plus meurtrier d’Amérique latine pour cette profession, après le Mexique. Le rapport 2022 de Reporters sans frontières (RSF) mentionne que le pays a encore reculé d’un rang selon les indicateurs de la liberté de la presse, se situant à la 110e place sur 180 pays – derrière la Hongrie (85e), la Tunisie (94e), l’Albanie (103e), le Burundi (107e) et seulement un rang devant le Mali (111e).
« Les relations entre le gouvernement et la presse se sont considérablement détériorées depuis l’arrivée au pouvoir du président Jair Bolsonaro, qui s’en prend régulièrement aux journalistes et aux médias dans ses discours. La violence structurelle à l’encontre des journalistes, un paysage médiatique marqué par une forte concentration privée et le poids de la désinformation posent des défis importants à la progression de la liberté de la presse dans le pays », indique le rapport 2022 de RSF.
Le gouvernement du président Bolsonaro a tout fait pour entraver le travail des journalistes : blocage de l’accès à son compte sur les réseaux sociaux ; politique systématique de non-réponse aux demandes d’informations publiques, un droit en théorie garanti par la loi au Brésil ; sans parler de la création et de l’entretien d’une machine de désinformation « à la Trump ». La sphère politico-médiatique a été inondée de fake news depuis sa première campagne, en 2018. En outre, avec un politicien qui a mis un point d’honneur à crier ses croyances et opinions racistes, homophobes et misogynes, les attaques personnelles contre les femmes journalistes sont devenues caractéristiques de cette période. Harcèlements et menaces venaient non seulement du président, mais aussi de ses partisans et de ses alliés, tous issus du sommet de la hiérarchie du pouvoir politique et économique du pays.
La victime la plus tristement célèbre de ce système est la journaliste Patrícia Campos Mello, grande reporter au quotidien Folha de S.Paulo, aujourd’hui installée à New York en tant que chercheuse invitée de la Columbia Journalism School. Dans le documentaire Endangered réalisé par Heidi Ewing et Rachel Grady en 2022, elle raconte son enquête sur les probables illégalités de financement et d’organisation de la première campagne présidentielle de Bolsonaro en 2018, qui a utilisé massivement la plateforme WhatsApp, ainsi que les persécutions et menaces qui se sont ensuivies. Sa série de reportages est devenue un livre A máquina do ódio : Notas de uma repórter sobre fake news e violência digital (La machine à haine : notes d’une journaliste sur les fake news et la violence numérique). Son travail a contribué à l’instauration d’une nouvelle législation limitant l’utilisation des applications de messagerie, en particulier WhatsApp, lors des campagnes électorales suivantes.
Patrícia Campos Mello a reçu le prix de la Liberté de la presse internationale du Comité pour la protection des journalistes en 2019 et le prix Maria-Moors-Cabot de l’université Columbia en 2020. De guerre lasse, cette journaliste qui s’est entendu dire par l’ancien président, en conférence de presse, qu’elle était prête à payer « n’importe quel prix » pour un scoop, insinuant ce que l’on peut imaginer, a dû se résoudre à quitter le pays fin 2021 face aux nombreux procès qu’elle a subis et qu’elle a elle-même intentés à ses agresseurs. Attaquer les journalistes brésiliennes non pas pour leur activité mais parce que ce sont des femmes est devenu une tendance adoptée principalement par les plus puissants et ce, généralement lorsqu’elles couvrent l’actualité politique.
En 2021, l’Association brésilienne de journalisme d’investigation (Abraji), la plus grande et la plus respectée des organisations de la profession au Brésil, créée il y a plus de vingt ans, a lancé un site de surveillance – violenciagenerojornalismo.org.br – afin de recenser les cas de violence de genre dans l’exercice de leur métier et de faire corps pour la défense des journalistes. Ainsi, pour le seul mois de janvier 2023, sur les 144 attaques de femmes journalistes déjà enregistrées sur la plateforme, plus de la moitié « contiennent des discours stigmatisants visant à diffamer et à embarrasser les victimes ». Parmi celles-ci, 67,6 % sont des discours prononcés par des autorités ou des personnalités et 45,9 % sont des campagnes de harcèlement, souligne le rapport. Et ce n’est pas un hasard si à la tête d’Abraji se trouvent trois femmes.
En conséquence, la bonne nouvelle est que les femmes journalistes ne se contentent plus de faire leur travail de reportage. Représentant près de la moitié (49,3 %) des journalistes de presse, nombreuses sont celles, comme à Abraji, qui occupent des postes à responsabilité dans les médias d’information du pays et, plus encore, ont créé des médias innovants, au risque de bousculer un secteur trop concentré, où, selon le rapport RSF 2022, les dix plus grands groupes de médias sont détenus par dix familles.
Dans un rapport publié en 2021 par Sembra Media, qui a interrogé plus de 200 médias d’information des pays du Sud, la tendance des femmes à prendre en charge non seulement le leadership, mais aussi l’innovation dans le domaine du journalisme au Brésil ne semble pas être un cas isolé : « L’une des conclusions les plus frappantes de notre premier rapport sur ce point d’inflexion est que les femmes représentent 38 % de tous les entrepreneurs de médias parmi les 100 natifs du numérique que nous avons interrogés en Argentine, au Brésil, en Colombie et au Mexique. Ce résultat est révolutionnaire car il montre que les femmes sont beaucoup plus nombreuses à posséder ces organisations médiatiques relativement nouvelles qu’à posséder des journaux ou des chaînes de télévision traditionnels, pour lesquels le pourcentage de femmes propriétaires n’est que de 1 %. »
La diversité des activités dans lesquelles les femmes se sont investies montre parfaitement l’importance décisive de leur engagement pour le respect de la liberté de l’information au Brésil. Ainsi, les deux plus grandes organisations de vérification des faits (fact-checking) au Brésil – Aos Fatos et Agência Lupa – ont été créées en 2015 par des femmes et sont encore aujourd’hui dirigées par des femmes. De même, l’unique organisation importante spécialisée dans la mise à disposition des données publiques (via la LAI – Loi sur l’accès à l’information), Fiquem Sabendo, est dirigée par une jeune femme journaliste qui en est cofondatrice.
Reconnu par le Bureau du contrôleur général (CGU), institution qui gère les comptes publics, Fiquem Sabendo a été convié à participer au groupe de travail qui guide l’élaboration de la nouvelle politique nationale d’ouverture des données du gouvernement fédéral du président Lula, récemment élu. Fiquem Sabendo a également agi auprès des institutions de contrôle et d’audit jusqu’à obtenir une décision historique de la Cour des comptes (TCU), laquelle contraint le ministère de l’économie à éditer, depuis 2021, l’ensemble des données relatives aux paiements des retraités de l’Union et ce, pour la première fois depuis plus de cent ans. En janvier 2023, Fiquem Sabendo a aussi publié les données des dépenses sur la carte bancaire publique de l’ex-président Bolsonaro. Désormais, les dépenses de tous les anciens présidents seront disponibles sur le site internet du gouvernement fédéral – ces données ayant fait l’objet de nombreux articles et analyses dans les médias.
Fondée en 2019 par deux femmes, l’Agencia Bori est la première agence d’information scientifique destinée aux journalistes. Inspiré par l’organisation américaine Eurekalert !, Bori valorise non seulement les connaissances produites dans le pays, mais contribue également à améliorer la qualité du journalisme scientifique national. L’Agencia Bori a remporté le premier prix du Hack for Positive Impact Executive Challenge 2022 de Microsoft. Ce prix s’inscrit dans le cadre du plus grand hackathon privé au monde, le Microsoft Global Hackathon for Social Impact, auquel ont participé plus de 10 000 projets du monde entier. Le projet primé de Bori consiste à optimiser le processus de cartographie et de conservation des études scientifiques brésiliennes par l’automatisation et l’application de la science des données et de l’intelligence artificielle.
Citons également AzMina, Gênero e Número, Paraiba Feminina, Catarinas, des organisations féministes ayant pour ambition de valoriser le point de vue des femmes dans leurs articles et leurs reportages. De plus en plus nombreuses ces dernières années, ces médias ont été créés par des femmes journalistes qui en ont eu assez de ne pas voir leur agenda traité avec la même pertinence que celui de leurs homologues masculins.
Né en 2014 à l’initiative de cinq jeunes journalistes habitant les banlieues de São Paulo, le collectif Nós, Mulheres da periferia raconte les histoires des femmes qui vivent dans ces quartiers. À Rio, se trouve également une femme à la tête de Maré de Notícias Online, média en ligne couvrant la plus grande zone de favelas de la ville. Et, à Salvador, ce sont quatre femmes journalistes qui viennent de lancer la lettre d’information Entre Becos, afin de rapporter l’actualité des quartiers populaires de la première capitale du Brésil.
Toujours dans la quête d’un journalisme indépendant, l’Agencia Mural (dont l’auteure de ces lignes est cofondatrice et directrice exécutive) a choisi, à son tour, d’incorporer d’autres voix au récit journalistique du Brésil. Lancée en 2010, Mural a pour vocation de couvrir les quartiers défavorisés (environ 80 % du total) des 39 villes formant la région métropolitaine de Grande São Paulo, la plus étendue en Amérique du Sud. L’Agence Mural instille ainsi d’autres histoires – les histoires des « autres » –, tout aussi pertinentes, dans le récit dominant produit par un journalisme des élites économiques concentré entre les mêmes mains depuis plus de cinq cents ans.
Au nord du Brésil, en Amazonie, épicentre des pires crises des années Bolsonaro, l’organisation Amazonia Real, cofondée par deux femmes en 2013 et récompensée par de nombreux prix depuis son lancement, a été la seule à couvrir la région pendant de nombreuses années. Fin janvier 2023, en partenariat avec un autre média indépendant, Repórter Brasil, Amazonia Real a publié une grande enquête « Ouro do Sangue Yanomami » (Or venu du sang Yanomami), série de sept reportages sur le fonctionnement illégal de la chaîne d’extraction de l’or. On a découvert ainsi que le système criminel basé sur la sous-rémunération des hommes dans les mines, est en fait une structure riche et complexe. Cette organisation englobe des exploitants miniers disposant d’un grand capital financier, des propriétaires d’avions, des fonctionnaires, des politiciens et des chefs de gouvernement, des populations autochtones, des marques internationales de bijoux et des trafiquants de drogue.
En 2022, le média Sumaúma s’est joint à cet important travail journalistique en fournissant une autre couverture de la forêt et de ses alentours. Sumauma, elle aussi, a été fondée et est dirigée par des femmes. Son premier grand reportage a montré au Brésil, ainsi qu’au monde entier, que les Yanomamis ont été victimes de ce qui s’apparente à un génocide opéré par le président du pays. Les données obtenues en exclusivité par Sumaúma montrent que sous le gouvernement de l’extrémiste de droite Jair Bolsonaro, le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans dus à des causes évitables a augmenté de 29 % en territoire Yanomami : 570 petits sont morts au cours des quatre dernières années de maladies pourtant curables.
Une des pionnières de ce nouvel écosystème de médias numériques, innovants et indépendants, a été l’Agência pública. Fondée et dirigée par deux femmes en 2011, l’agence a d’emblée eu l’ambition de réaliser des grands reportages d’investigation, pour les distribuer ensuite gratuitement à tous les médias souhaitant les publier. Au cours de son histoire, Agência pública a remporté 48 prix, notamment le prix du journalisme Gabriel-Garcia-Márquez, le plus important d’Amérique latine. En 2016, l’agence a été le premier média brésilien nominé pour le prix de la Liberté de la presse de Reporters sans frontières.
Être à but non lucratif et ne pas utiliser de barrières économiques pour l’accès à l’information est le choix de tous ces nouveaux médias, fondés en grande majorité par des femmes qui croient au journalisme comme outil indispensable au respect de la démocratie. Par conséquent, elles cherchent à financer leur travail de mille et une façons : subventions ou dons de particuliers, créations d’événements, abonnements de soutien, partenariats de production de contenus, projets divers. Elles partagent la même conception du libre accès à l’information. Elles ne vendent pas leurs productions, considérant qu’un paywall ou autre restriction d’accès aux informations serait un acte antidémocratique dans un pays aussi inégalitaire où il est de plus en plus difficile de connaître la vérité.
Tant d’initiatives de journalisme sur internet qui osent innover sur un marché de plus en plus fragilisé, où la viabilité financière est une gageure, ont fini par se rassembler pour former le premier collectif de médias digital native au Brésil. L’Ajor (Digital Journalism Association) a été fondée par 30 organisations, dont 18 créées ou dirigées par des femmes journalistes. Le 7 juin 2021 fut la date officielle de ce lancement, à l’occasion de la Journée nationale de la liberté de la presse au Brésil. Avec une présidente pour le premier mandat, ainsi qu’une secrétaire générale, l’association Ajor, engagée en faveur de la diversité (dans tous les sens du terme) dans le journalisme et de la démocratie, compte aujourd’hui 100 organisations membres. Je n’ai pas compté combien d’entre elles ont été créées ou sont dirigées par des femmes – un grand nombre, je crois !
Sources :
- « From a Fledgling Blog to a Vibrant News Group, Agencia Mural Reports on the Poorest in Brazil », International Center for Journalists, Patrick Butler, October 12, 2019, icfj.org
- « Classement mondial de la liberté de la presse 2022 : la nouvelle ère de la polarisation », rsf.org/fr
- « Ponto de Inflexão Internacional : Um estudo sobre impacto, inovação, ameaças e sustentabilidade dos empreendedores de mídia digital na América Latina, Sudeste Asiático e África », SembraMedia (eds. Janine Warner, Jessica Best, Mijal Iastrebner, Felicitas Carrique), novembre 2021, data2021.sembramedia.org/pt-br
- « Perfil do jornalista brasileiro 2021 : características sociodemográficas, políticas, de saúde e do trabalho », Samuel Pantoja Lima et al., Florianópolis : Quorum Comunicações, 2022.
- « New voices, new tools : how Brazil’s media are emerging from the Bolsonaro shadow », International Press Institute, Daniela Pinheiro, February 7, 2023, ipi.media