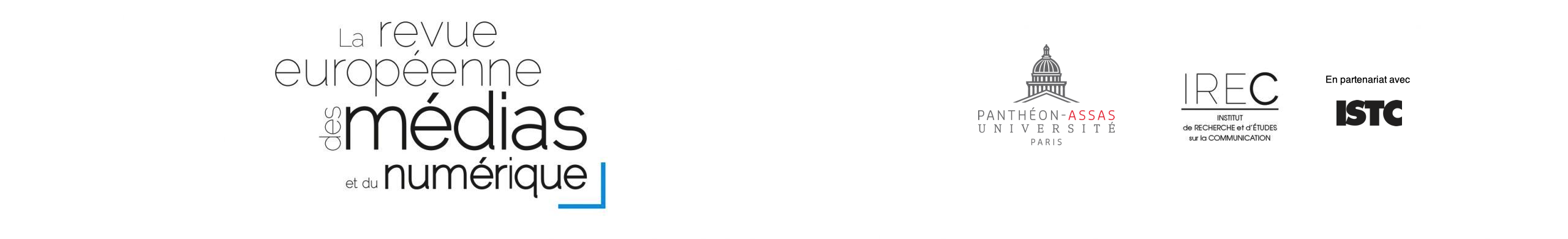|
Concernant l’avenir de l’information générale et politique, quelle est, selon vous, la bonne question à se poser ? La rem a souhaité participer à sa façon aux États généraux de l’information, qui se déroulent jusqu’au printemps 2024, en posant cette question à ses auteurs, enseignants-chercheurs et professionnels. Françoise Laugée
|
Partons du principe que les médias sont le reflet des institutions. Le terme « institutions » désigne les règles s’appliquant à l’ensemble de la société, formant ce qu’économistes et politologues appellent l’« ordre social ». Ce concept fait l’objet d’une théorie récente1 qui distingue deux idéaux-types de société.
Le premier, historiquement le plus ancien, est l’ordre d’accès limité, aussi appelé « État naturel », dans lequel les accès aux privilèges, aux rentes, aux ressources sont conditionnés à l’allégeance au pouvoir. L’économie et le droit y sont en permanence manipulés par la raison d’État. Il en va de même du fonctionnement des médias, qui concourent à légitimer l’assise et l’arbitraire du pouvoir. Dans ce type d’ordre social sous lequel vivent près de 80 % de la population mondiale, la société civile est peu disante, on ne se pose pas de questions.
L’autre idéal-type est l’ordre d’accès ouvert, dans lequel l’économie de marché est couplée à la démocratie représentative sous couvert de l’État de droit. Le libre accès à la propriété ou à la création d’organisations diverses est garanti de manière égalitaire par le droit. Les médias qui activent la société civile concourent au fonctionnement et à l’articulation dynamique de l’économie, de la politique et du droit. Dans la sphère économique, les marchés sont sous-tendus par la publicité qui stimule la concurrence entre firmes et entre produits. Quant au champ démocratique, les médias d’information diffusent des récits d’actualité qui nourrissent la compétition politique. La publicité finançant une part significative des médias d’information, les deux activités sont de facto complémentaires.
Depuis le XXe siècle, ces deux types d’ordres sociaux s’affrontent au plan idéologique, économique et militaire, les ordres d’accès ouvert ayant tendance, malgré l’expansionnisme des États naturels, à gagner de nouveaux États. C’est ainsi que, depuis 1945, l’Union européenne a pu fédérer vingt-sept États membres, tous convertis à l’ordre d’accès ouvert. La vigilance de ladite Union au respect de l’État de droit dans chacun de ses États membres résulte de cette construction.
Les États généraux de l’information (EGI) s’intéressent au fonctionnement des médias dans les ordres d’accès ouvert, dans une conjoncture où ces ordres sont contestés. Ils le sont de l’intérieur par des mouvements populistes et de l’extérieur par des ingérences médiatiques émanant d’États naturels agressifs, cependant que les médias sociaux déploient de nouvelles formes de production et de consommation de l’information. En effet, le populisme qui prend sa source dans la critique des institutions et dans l’incarnation d’un peuple fantasmé prospère des rigidités et des dysfonctionnements de l’ordre d’accès ouvert2. Ce qui fait l’affaire des États naturels souhaitant freiner la progression de l’ordre concurrent. L’opacité éditoriale des médias sociaux, renforcée par l’irruption des robots sémantiques, se prête alors à mille formes d’alliances et d’influences.
LE CRÉDIT À APPORTER AUX MÉDIAS EST FONCTION DE LEUR PROTOCOLE ÉDITORIAL, C’EST-À-DIRE DE L’ORIGINE ET DU CONTEXTE DE LA PUBLICATION
Dans l’ordre d’accès ouvert, les médias relaient l’ensemble des croyances qui s’affrontent au travers des élections. Le crédit à apporter aux médias est fonction de leur protocole éditorial, c’est-à-dire de l’origine et du contexte de la publication3. Le protocole éditorial fait partie des expériences et des croyances de l’ordre d’accès ouvert où la censure est finalement déléguée à l’individu. Autrement dit, l’influence des médias sur l’opinion est toute relative puisque chacun ne retient que ce qu’il veut bien entendre. L’important est que les éditeurs et leurs intérêts soient correctement identifiés. Certes, cela n’empêchera pas chacun de croire ce qu’il veut. Mais l’identification claire des éditeurs écarte d’office l’erreur de bonne foi du lecteur. Ne reste alors que la mauvaise.
Jusqu’à présent, là où ils sont durablement établis, l’efficacité adaptative des ordres d’accès ouvert a réussi à internaliser le discours du populisme et ses relais, autrement dit à empêcher que son arrivée légale au pouvoir ne détruise l’ordre social. Le maintien de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de l’Italie, de la Slovaquie dans l’Union européenne en sont des exemples proches. La résilience du pouvoir judiciaire américain face au populisme d’un Parti républicain dominé par Donald Trump en est une autre illustration.
S’il faut se poser une question, ce peut-être alors la suivante : imagine-t-on, dans la conjoncture que nous avons décrite, des situations dans lesquelles un dysfonctionnement des médias pourrait compromettre l’ordre social ?
La première chose qui vient à l’esprit est le renforcement du populisme par des médias qui en font leur marché. Cependant, si l’opinion populiste n’existait pas, les médias ne la cibleraient pas. Certes, la résonance du populisme par des médias ad hoc amplifie la critique des institutions, mais l’adaptation de celles-ci est sans doute à ce prix. On a beau faire en France des gorges chaudes à propos de Bolloré, le phénomène est ancien : la yellow press de William Hearst qui, avant-guerre, publiait en Amérique des chroniques de Mussolini et d’Hitler, était fanatiquement populiste. Si elle a contribué à retarder l’entrée en guerre des États-Unis, cela ne l’a pas empêchée en 1942 de se rallier aux boys.
On peut se demander si les médias sociaux, dont l’irresponsabilité éditoriale est une exception historique, n’exacerbent pas le populisme au point de le rendre destructeur. Notre sentiment, pourtant, est que leur usage répété a modifié la façon de les percevoir. Ils peuvent, certes, regrouper et organiser des adeptes de théories diverses, mais chacun sait aussi qu’ils servent d’abord à cela. En ordre d’accès ouvert, le populisme, y compris agité par des puissances étrangères, engendre des forces de rappel attachées à l’ordre social en place, lesquelles concourent à le réformer. Et si le populisme in fine parvient au pouvoir, ou bien il s’adapte à l’État de droit, ou bien la menace sur l’ordre social finit par l’écarter4.
Enfin, s’agissant des biais associés à l’intelligence artificielle générative (IAG), les bénéfices sociaux viendront de sa labellisation en tant que telle et de son marquage afin de lui assigner un protocole éditorial spécifique. Cette identification des contenus motive les médias dans lesquels l’IA s’insère, car ceux-ci n’ont pas intérêt à ce qu’elle se confonde avec leurs autres contenus. Le public peut alors s’adapter à ce nouveau média. Le fiasco récent du détournement pornographique de l’image de Taylor Swift ou les efforts de Meta pour marquer les images issues de l’IAG en sont des exemples rassurants.
Cette brève discussion écarte des réponses intuitives à la question posée. D’autres demeurent néanmoins possibles, le débat reste ouvert.
——————–
Olivier Bomsel est professeur d’économie, directeur de la Chaire d’économie des médias et des marques à Mines Paris – PSL et auteur notamment de Les Damnés de la paix, PUF, 2023.
Rémi Devaux est docteur en économie, spécialiste de la publicité et des médias et coauteur, avec Olivier Bomsel, de Le Nouveau Western. Qui peut réfréner les géants du web ?, Le Cherche midi, 2022.
Sources :
- La théorie des ordres sociaux est née du croisement de l’économie des institutions, de l’histoire et de la science politique. Voir l’ouvrage fondateur : North Douglass C., Wallis John Joseph, Weingast Barry R., Violence et ordres sociaux, « Nrf », Gallimard, 2010. Ses développements concernant les médias et la géopolitique sont discutés dans La Nouvelle Économie politique, Folio, 2017, et Les Damnés de la paix, PUF, 2023, d’Olivier Bomsel.
- Sur la définition du populisme, nous empruntons celle du politologue allemand Jan-Werner Müller, auteur de Qu’est-ce que le populisme? Définir enfin la menace, Premier Parallèle, 2016.
- Voir Olivier Bomsel et al., Protocoles éditoriaux. Qu’est-ce que publier ?, Armand Colin, Paris, 2013.
- Le sociologue Federico Tarragoni montre que les populismes historiques ont contribué à renforcer la démocratie. Les partis traditionnels ont absorbé les revendications populistes, lesquelles plaidaient pour plus d’égalité face au marché et au droit. Tarragoni Federico, L’Esprit démocratique du populisme, La Découverte, 2019.