« Ubérisation », ce néologisme s’est récemment répandu comme une rumeur. Mais de quelle prise de conscience est-il le reflet ? Du nom de la start-up américaine Uber, créatrice de l’application mobile UberPop, service de transport urbain, en voiture avec chauffeur, organisé entre particuliers, qui concurrence la profession de chauffeur de taxi, le terme désigne les mutations qui affectent l’ensemble des acteurs économiques – entrepreneurs, salariés et consommateurs – avec la généralisation de l’usage des technologies de l’internet mobile. Expression marketing ou mot à la mode (buzzword), l’ « ubérisation » devrait néanmoins être entendue autrement : un concept qui résume les symptômes d’une société en rupture avec elle-même.
Un concept qui résume les symptômes d’une société en rupture avec elle-même
L’expression s’est répandue à la suite du propos tenu par Maurice Lévy, patron du groupe publicitaire Publicis, lors d’une interview accordée au Financial Times en décembre 2014 : « Tout le monde commence à craindre de se faire ubériser. C’est l’idée qu’on se réveille soudainement pour découvrir que son activité historique a disparu… Les clients n’ont jamais été aussi désorientés ou préoccupés au sujet de leur marque ou de leur modèle économique », a déclaré le publicitaire, estimant que le « tsunami numérique » a causé des bouleversements dans le secteur de la publicité, comme jamais, depuis l’avènement de la radio et de la télévision. Pour survivre dans ce nouveau monde, Maurice Lévy explique que son groupe s’adapte, comme les autres, en embauchant des mathématiciens et des « data scientists », afin de livrer les algorithmes nécessaires à ses clients pour atteindre des consommateurs en particulier. « Nous employons des geeks, des passionnés de nouvelles technologies et des joueurs de jeux vidéo », ajoute-t-il.
L’interprétation du phénomène ne doit pourtant pas s’en tenir à l’introduction du Big data et de ses algorithmes dans l’entreprise, ni à ses seules conséquences. Ce ne sont pas seulement les activités de service qui sont en train de se faire « ubériser ». Avant elles, les industries culturelles se sont faites « youtubiser », « amazoniser », « googliser » ou « nexflixiser », pour reprendre les mots de Marc-Arthur Gauthey, animateur du think tank OuiShare. Une économie « ubérisée » ne se résume pas à une économie « connectée », pas plus qu’elle ne signifie simplement la remise en question de l’ancien modèle par le nouveau, les « briques et mortier » face aux start-up. Réalité économique et sociologique qui concerne la société tout entière, l’ « ubérisation » est une évolution sans précédent, un retour en arrière, diront certains. Indissociable de ce qui est qualifié de troisième révolution industrielle, l’ « ubérisation » est surtout une somme de changements radicaux, économiques, sociaux et politiques.
L’ « ubérisation », c’est l’entrée dans le monde de l’économie dite de partage, née de la généralisation d’une économie à bas coût à l’ère des technologies informatiques.
C’est le règne du low cost numérique reposant sur des principes inédits :
– l’activité économique est organisée en réseaux
– le consommateur devient producteur
– le temps de travail et le temps libre se confondent
– l’amateur défie le professionnel
– l’accès est privilégié à la possession
– la mesure du temps est l’immédiateté
– la matière première est la data
– le produit à vendre est le consommateur
– la gratuité efface la vie privée
– les machines intelligentes se substituent à la pensée humaine
– la consommation à la demande induit le travail à la tâche
– le partage vaut d’abord pour ceux qui possèdent
– l’intermédiation numérique génère des plates-formes industrielles.
Comment l’empêcher de sombrer dans un Mechanical Turk généralisé ?
Dans cet univers, les start-up de la Silicon Valley, devenues dominantes en quelques années seulement, grâce à l’appui des capital-risqueurs, de grandes banques ou de fonds d’investissement, ont instauré de nouvelles règles économiques, sociales et culturelles.
Vécue comme une menace par certains ou comme un progrès par d’autres, l’ « ubérisation » ou l’économie à bas coût est désormais caractéristique de notre modernité. Réfléchir au phénomène devrait revenir à expérimenter le futur des générations Y et Z qui travailleront, apprendront, s’informeront et consommeront dans une économie dite collaborative, parce qu’elle draine les échanges et les partages, faite d’opérations de crowdsourcing et de crowdfunding. Les nouveaux acteurs de cette économie à la demande comblent le vide laissé par des acteurs économiques traditionnels pétrifiés, en offrant une renaissance numérique à des services existants, palliant ainsi l’insatisfaction des consommateurs internautes (l’idée d’Uber est née de l’impossibilité de son fondateur de trouver un jour un taxi dans Paris). Ils ouvrent des marchés en ligne pour des centaines de millions d’utilisateurs de smartphones, désireux de trouver leur bonheur d’un seul clic. Néanmoins, si les uns économisent un peu, tandis que les autres gagnent un peu, ces services sont le fruit de plates-formes numériques, érigées souvent en monopole, qui engrangent de substantiels bénéfices. Fondée en 2009, Uber est aujourd’hui présente dans une quarantaine de pays, soit 200 villes. Prélevant une commission de 20 % par transaction, Uber annonce doubler, tous les six mois, son chiffre d’affaires, qui atteindrait 1,5 milliard de dollars en 2014 pour 300 millions de revenus nets.
Si l’idée de taxer ce nouveau modèle a vite surgi, « rares sont ceux qui interrogent ce que l’atomisation de l’activité productive, ou la « freelancisation » de la vie professionnelle […] va impliquer pour notre conception du travail et du modèle social qui s’appuie dessus », constate Marc-Arthur Gauthey (Les Echos, 17 mars 2015). Le coup dur porté aux positions établies des fleurons du CAC 40 par le modèle des plates-formes participatives focalise l’attention sur leur marge entamée. Mais, de l’autre bout de la lorgnette, apparaît la destruction des emplois et pointe la remise en question du statut de salarié. « Nous serons tous plus ou moins des intermittents du travail. Nous cumulerons ici et là des heures pour remplir nos quotas…qui nous donneront droit, peut-être, à des allocations, une assurance-maladie et un RSA d’un nouveau genre », annonce Marc-Arthur Gauthey. Si la génération Y est adepte de l’économie du partage, peut-être par conviction, elle l’est avant tout par nécessité, s’endettant pour poursuivre des études, ne pouvant accéder à la propriété immobilière, ayant au mieux un « boulot » à défaut de pouvoir choisir une carrière. Comment l’empêcher de sombrer dans un Mechanical Turk généralisé ?
L’économie numérique n’a pas son pareil pour faire émerger le « moins-disant »
Empruntant son nom, un brin cynique, à la supercherie du faux automate joueur d’échecs du XVIIIe siècle (il a fallu cinquante ans pour découvrir qu’une petite personne, cachée dans le meuble, déplaçait les pions), cette application web de crowdworking, lancée par Amazon en 2005, confie à des travailleurs internautes (turkers), par l’intermédiaire d’une plate-forme baptisée MTurk, toutes sortes de missions, faiblement rémunérées, que les ordinateurs ne sont pas encore capables de réaliser (analyse d’image, sondage, traduction ou correction de textes…). Cette place de marché électronique de l’emploi instaure une version high-tech du travail à la chaîne, mettant en relation des crowdworkers et des crowdsourcers, sans qu’aucun contrat de travail ne soit établi et pour une « récompense » (à partir de 1 centime, soit l’équivalent de 3 à 4 euros l’heure en moyenne) qui sera versée à condition que la tâche soit bien exécutée, c’est-à-dire le plus rapidement possible. L’économie numérique n’a pas son pareil pour faire émerger le « moins-disant ». Réputé pour instaurer des conditions de travail pénibles dans ses entrepôts, le géant du commerce en ligne Amazon collecte 10 % de commission au passage. La start-up Foulefactory a introduit ce concept d’externalisation du travail en France.
Après le secteur tertiaire, l’ « ubérisation » s’appliquera demain à l’industrie, avec la généralisation des « fablabs » (fabrication laboratory). S’appuyant sur le travail collaboratif, peuplés d’utilisateurs-créateurs (communauté de makers) de produits high-tech avec un esprit « Do it yourself », ces ateliers de fabrication numérique conçoivent des matériels libres (open hardware) comme il existe des logiciels libres. Equipés d’imprimantes 3D, les makers peuvent aujourd’hui produire à bas coût toutes sortes d’objets. La combinaison du recours aux plates-formes de crowdworking et le développement des imprimantes 3D préfigurent l’industrie du futur. En janvier 2015, l’entreprise américaine Local Motors a présenté au salon de l’automobile de Détroit un modèle de voiture conçue avec l’aide d’une communauté d’internautes et dont la carrosserie, le châssis et les jantes ont été entièrement imprimés en 3D pour un coût inférieur à 5 000 euros.
Ce nouveau modèle économique du partage, paradoxalement sans vision collective, est-il le signe d’un retour au régime des « communs » ou bien, à l’inverse, celui de l’avènement d’un libéralisme absolu ? « Personne ne doit se croire à l’abri des ruptures parce que le droit le protège », avertit Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence (L’Opinion, 17 mars 2015). Transformant la vie humaine dans tous ses aspects, la prédominance de l’économie à bas coût à l’ère du numérique marque un changement radical, une fracture dont l’importance pour l’évolution de notre société peut être comparée à l’« anthropocène » pour celle de la Terre, concept inventé par les géologues pour définir « une nouvelle période où l’activité humaine est devenue la contrainte dominante devant toutes les autres forces géologiques et naturelles qui jusque-là avaient prévalu » (in Wikipédia). Dans le monde des smartphones et des réseaux, nos vies sont transformées par des pratiques numériques qui se répandent, tel un virus, avec une rapidité insolente. Comme le trading à haute fréquence peut entraîner un krach financier, l’« ubérisation » provoque à vitesse grand V une remise en cause de la logique de l’offre et de la demande érigée par l’économie industrielle. La technique numérique est donc bien l’enjeu de notre avenir, comme l’a décrit Jacques Ellul, analysant la mise en œuvre d’un « système technicien ». Au XXIe siècle, quelle régulation parviendra à éviter que la nouvelle économie à bas coût ne mène à un appauvrissement du bien commun (horaires de travail, congés payés, prestations sociales…) forgé au prix de longues luttes par l’économie industrielle et de marché des XIXe et XXe siècles ?
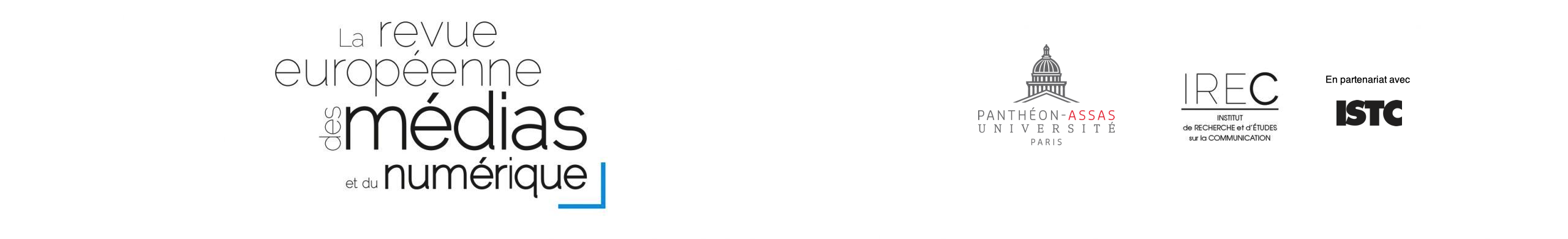

Tout le malheur d’une profession sinistrée… un désastre
Cela concerne toutes les professions, y compris le Photojournalisme… : http://la-rem.eu/2016/01/14/photojournalisme-luberisation-avant-lheure/