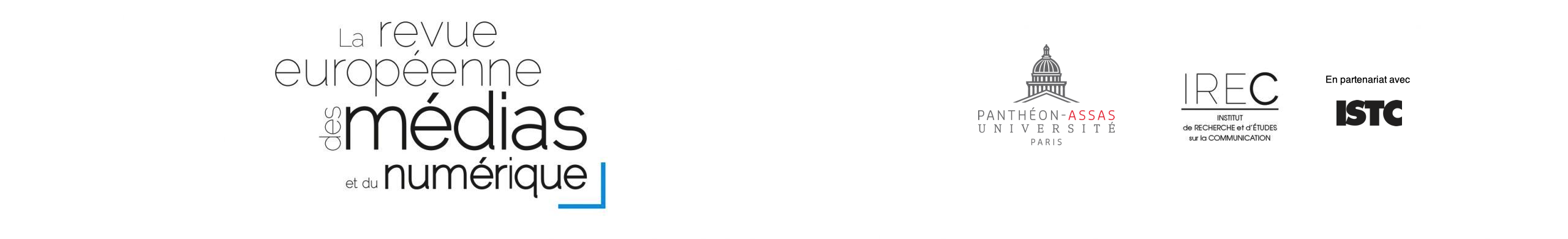La rentrée littéraire, en cet automne 2015, a failli passer inaperçue. Sur le devant de la scène, celle des journaux et des plateaux de télévision, se sont étalées au grand jour les querelles entre les intellectuels du moment et les journalistes les plus consacrés. Hérauts les uns et les autres, de la liberté d’expression, il y avait moins d’un an, ils s’accusaient réciproquement, soudain, d’en être tour à tour les victimes expiatoires et les défenseurs les plus légitimes.
Après avoir affirmé dans les colonnes du Figaro Magazine que la gauche, en France, méprisait le peuple « old school », Michel Onfray était accusé par Libération de « faire le jeu du Front national ». Quelques jours auparavant, le conflit entre Michel Houellebecq et Ariane Chemin prit un tour judiciaire après la publication dans les colonnes du Monde, pendant l’été 2015, d’une série de six épisodes consacrée à l’auteur de Soumission. Après que dans un communiqué à l’AFP, le romancier eut traité les journalistes de « parasites », le directeur du journal, Jérôme Fenoglio, prenant la défense d’Ariane Chemin, engagea le fer avec les « intellectuels ou polémistes », accusés d’« entretenir le mythe de leur martyre en faisant accroire qu’une corporation cherche à leur nuire : les journalistes ».
Le temps n’est plus où la parole d’un Zola dans un journal populaire était tout à la fois rare et retentissante
Rien ne change, décidément, dans cette France qui a toujours accordé un statut privilégié aux intellectuels, écrivains, philosophes ou journalistes. Et pourtant, tout a changé, depuis que les journalistes ont accueilli infiniment plus souvent et plus largement les intellectuels dans les colonnes de leurs journaux ou sur les plateaux de télévision. Le temps n’est plus où la parole d’un Zola dans un journal populaire était tout à la fois rare et retentissante. Le temps est également révolu, où un Balzac garantissait ses fins de mois en écrivant dans les journaux, ce qui ne l’empêchait guère d’affirmer que « si la presse n’existait pas, il ne faudrait surtout pas l’inventer ». On se prend à rêver que sous l’emprise de passions moins délirantes et de médias d’information plus scrupuleux, on ne puisse plus jamais prétendre, comme dans les années 1970, qu’ « il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron ».
Grâce aux médias de l’époque, les journaux imprimés, les journalistes avaient ouvert, dès le milieu du XIXe siècle, de nouvelles perspectives aux intellectuels, qu’ils soient écrivains, savants ou philosophes. Sortis de l’ombre, ces derniers renonçaient soudain à vivre entre eux : leurs œuvres ne subissaient plus le seul verdict d’un public très restreint, elles furent subitement livrées, à l’épreuve du jugement du public, devant le tribunal de l’opinion d’une multitude plus ou moins grande. Dans le sillage des journaux, quotidiens ou hebdomadaires, la télévision leur ouvrait, dès les années 1960-1970, un nouveau théâtre d’opération, infiniment plus large et prometteur : celui du grand public, auquel ils n’avaient encore jamais eu un accès aussi direct.
La presse imprimée, dite encore écrite, comme si les autres médias ignoraient superbement l’écrit, tombait brutalement de son piédestal. Après avoir exercé un magistère exclusif sur la vie intellectuelle, elle cédait la place à la télévision, qui devenait le média dominant de la fin du siècle, à la fois impérieux et condescendant, arbitre de toutes les élégances. Ce fut l’époque des nouveaux philosophes, avec pour chef de file Bernard-Henri Lévy, qui bousculait les clivages partisans en évoquant les stigmates laissés à sa génération par les barbaries du siècle, le stalinisme et le nazisme. Dans leur sillage, les nouveaux économistes choisissaient un universitaire et un journaliste, Pascal Salin et Henri Lepage, pour stigmatiser le socialisme, sous toutes ses formes, et vanter les charmes oubliés de la concurrence et de l’économie de marché.
Les médias coupables d’avoir ouvert la voie à des intellectuels savants dans le monde des journalistes, et journalistes aux yeux des vrais savants
La télévision fut accusée de fermer la parenthèse des intellectuels universels, ouverte jadis par Zola, l’illustre défenseur du capitaine Dreyfus, et dont Jean-Paul Sartre passait pour être le dernier représentant, mort en 1980. Jaloux sans doute de la notoriété soudaine acquise par leurs collègues philosophes ou économistes, davantage encore que nostalgiques d’une époque qui faisait de la France, grâce à ses écrivains et ses artistes, une nation que l’on qualifia de « littéraire », deux sociologues prirent pour cible ces intellectuels qui semblaient être tombés dans les médias comme Monsieur le Trouhadec était tombé dans la débauche. Raymond Boudon, parti de cet individualisme méthodologique emprunté à la sociologie empirique américaine, classé à droite sur l’échiquier politique français, notamment pour cette raison, expliquait que les médias, et principalement la télévision, avaient ouvert aux intellectuels un « second marché » où la recherche de la notoriété à tout prix prévalait sur la consécration par les pairs, seuls capables à ses yeux d’évaluer la conformité d’une recherche ou d’une œuvre aux exigences les plus établies auxquelles elle doit souscrire. De son côté, Pierre Bourdieu, célèbre pour avoir déchiffré les codes sociaux, involontairement valorisés par l’école, qui favorisent la « reproduction » des inégalités sociales, revendiquait son appartenance à une gauche rénovée, rendait les médias coupables d’avoir ouvert la voie à des intellectuels qu’il qualifia d’« intermédiaires », savants dans le monde des journalistes, et journalistes aux yeux des vrais savants, plus soucieux de « passer » à la télévision que d’obéir aux exigences de leur discipline, court-circuitant ainsi leurs pairs afin de conquérir, sans vergogne aucune, les faveurs du « grand public ».
En même temps qu’ils ouvraient le procès de la télévision, les deux sociologues, divisés sur leurs approches, leurs objets d’étude et leurs conclusions, prenaient acte pareillement de la crise de l’enseignement et des difficultés de l’Université. A leur suite, il a été de bon ton de condamner les médias et les journalistes, soupçonnés d’obéir à la seule logique du marché, recherchant à tout prix le meilleur moyen de plaire et de séduire, coupables du même coup de faire la courte échelle à des « pseudo-intellectuels », des « grandes gueules » qui sont aussi de « bons clients », des « fast thinkers », comme on dit aux Etats-Unis, des personnages médiatiques capables de dire n’importe quoi sur n’importe quel sujet, à condition de le dire bien et surtout de le dire dans un espace de temps et avec un vocabulaire, aussi restreints que possible.
Pourquoi les relations entre les journalistes et les intellectuels sont-elles marquées par autant de suspicion réciproques ?
Les relations entre journalistes et intellectuels sont aussi tumultueuses aujourd’hui que jadis. Et leurs conflits font le jeu de la compétition à laquelle se livrent les médias, aujourd’hui plus que jamais : en conflit ouvert avec Le Monde, Michel Houellebecq s’est confié tout au long de l’été 2015 à un journaliste du Figaro Magazine, et Michel Onfray est sollicité par tous les autres médias, en cet automne 2015, pour avoir été accusé par Libération de « faire le jeu » du Front national. Comme avant-hier, le général de Gaulle, plutôt que d’ouvrir le débat avec Raymond Aron sur la politique étrangère de la France, préféra le désigner auprès de ses interlocuteurs indignés comme étant celui qui est « professeur au Figaro et journaliste au Collège de France ». Ceux qui souscrivaient à ses analyses plutôt qu’à celles de Sartre savent aujourd’hui encore ce qu’il leur en coûtait d’avoir raison avec lui.
Pourquoi pareils malentendus, aujourd’hui encore, comme au temps de Balzac ? Pourquoi les relations entre les journalistes et les intellectuels sont-elles, en France peut-être plus que dans les autres démocraties, marquées par autant de suspicion réciproques ? De ces relations, on serait tenté de souscrire au diagnostic de Claude Sales, journaliste formé à l’école de Lazareff, à France Soir, avant qu’il ne rejoigne Le Monde après un passage au Point, évoquant le malentendu entre la presse et le gouvernement : « Nos dirigeants, disait-il, sont excessivement sensibles aux critiques des médias, et ceux-ci admettent difficilement la critique, d’où qu’elle vienne. » Formulé peu avant la fin du siècle dernier, le diagnostic vaut pareillement pour les relations que Claude Sales qualifie aujourd’hui d’empoisonnées, entre les journalistes et les intellectuels.
Plus que jamais, plus encore à l’ère des médias numériques qu’à l’époque où les journaux imprimés régnaient en maître, ils ont pourtant besoin les uns des autres. Les journalistes ne peuvent plus guère se passer des chercheurs, ces intellectuels « spécifiques » pour parler comme Michel Foucault, spécialistes d’un domaine dont ils scrutent méthodiquement, selon les règles d’une méthode consacrée, les différents aspects, quitte à souligner leurs divergences éventuelles, voire leurs différends, sans prétendre pour autant les départager. Quant aux intellectuels, écrivains ou philosophes, chercheurs ou témoins avérés d’un événement de l’actualité, intellectuels universels ou spécifiques, pareillement engagés dans le débat public, n’ont-ils pas le même devoir d’accéder à la tribune des médias, directement ou par le truchement des journalistes, afin de briser des tabous, d’éclairer des enjeux méconnus ou négligés, de déjouer sans relâche les ruses des conformismes, de ce que l’on appelait encore, il y a moins de dix ans, la « pensée unique », à la suite de cette political correctness, dénoncée si justement par les universitaires américains ? Plutôt que de se lamenter sur la fin supposée des intellectuels « universels », hérauts de la liberté de pensée et héros au service de la fierté nationale, plutôt que de déplorer le succès indu ou injustifiable des intellectuels qualifiés de médiatiques, mieux vaut assurément mettre en lumière cette promotion croisée entre journalistes et intellectuels, les services échangés entre eux, dès lors qu’ils contribuent également, ensemble et d’un commun accord, à animer le débat public, à l’aiguillonner même, afin de lui épargner le vain réconfort du bavardage.
Se soumettent-ils en effet les uns comme les autres à une pression si grande qu’elle les détourne des disciplines les plus sacrées de leur métier ?
Là réside en effet le plus urgent : dans le rétablissement, pour les journalistes comme pour les intellectuels, de leurs droits et des devoirs qui en constituent immanquablement le corollaire. Afin d’atteindre cet objectif, ou d’éclairer, si l’on préfère, les conditions pour que le débat public soit plus riche et plus utile, moins atone ou moins bavard, il convient de mettre en lumière les relations nouvelles instaurées par les médias, plus nombreuses et diverses que jamais, entre les journalistes et les intellectuels. Face aux lois du marché, à une concurrence toujours plus rude, se soumettent-ils en effet les uns comme les autres à une pression si grande qu’elle les détourne des disciplines les plus sacrées de leur métier ? Conçus et réalisés avec le seul espoir de plaire au plus grand nombre, les médias ne sont-ils pas devenus des marchandises « comme les autres », à l’encontre de ce qu’ils disent d’eux-mêmes ? Tenu pour être leur seule boussole, l’audimat – ou les ventes à Paris des journaux – est devenu le symbole de l’asservissement de tous à la nécessité impérieuse « de plaire et de séduire », à n’importe quel prix, en suivant les attentes supposées, nobles ou moins nobles, des clients ? Outre ce postulat des démocraties modernes selon lequel, paraphrasant Churchill, le marché est sans doute, pour la liberté d’informer et le droit à l’information, le pire des régimes à l’exception de tous les autres, il importe de ne pas confondre l’audimat avec le marché. Ce que mesure l’appareil, c’est ce qui a marché, la veille ; en suivre les indications, revient donc, pour les médias, à ne jamais proposer que des programmes couronnés de succès dans le passé, à écarter par conséquent tout ce qui pourrait surprendre, étonner ou dérouter leur public habituel. Tout média, à l’instar de tout autre marchand, sait qu’il doit en même temps suivre et précéder ses clients. Les responsables des médias le savent à l’égal de n’importe quel « marchand ». C’est courir un grand risque que de ne jamais prendre de risques. En l’occurrence, le média se contentant de suivre l’audimat serait comparable au chauffeur d’une voiture regardant la route dans le rétroviseur plutôt que devant lui. Le résultat est assuré : il va dans le mur, au sens propre et au sens figuré de l’expression. Au bout de la logique du marché, il y a un appel, venu de la demande, à de l’inédit, à une attente trop longtemps insatisfaite.
L’intellectuel obéit assurément à d’autres lois que celles du marchand. Indifférent aux injonctions d’une quelconque demande, insensible à ses verdicts, il exerce une pensée « autonome et suffisante », pour parler comme Gilles Deleuze, poursuivant une finalité qui le dépasse, à la fois extérieure et supérieure à lui, que l’on peut appeler valeur, faute de mieux, une vérité, dont les vertus sont toujours les mêmes, la véridicité, la rigueur, la sincérité, un idéal en tant que tel, indispensable et inaccessible, et dont la destination ultime n’existe peut-être que dans le désir insatiable que l’on a de l’atteindre. Il s’agit par conséquent d’une quête sans répit, un combat jamais gagné et toujours recommencé, à la merci de la moindre contrariété, du démenti le plus modeste.
Il revient au journaliste, depuis que les journaux, – ou plutôt certains parmi eux –, se sont voulus indépendants, de mettre en tension ces deux logiques, celle du marché, aux lois duquel les médias sont soumis, au moins dans les démocraties libérales, et celui qui est subordonné à la poursuite d’un idéal, en l’occurrence la vérité, et sa voie d’accès, l’objectivité, ou, si l’on préfère, l’honnêteté intellectuelle. Entre logique du profit, qui conduit à faire commerce de tout, à tout faire pour « arrêter l’attention » et «émouvoir » le lecteur ou le téléspectateur, selon les mots mêmes d’Hannah Arendt, et respect de ces lois d’airain que le journaliste partage avec l’intellectuel digne de ce nom, professeur ou chercheur, et dont il peut également, à bon droit, partager les privilèges et les infortunes.
Depuis que les journaux du XIXe siècle ont institué le journalisme comme métier et comme vocation, grâce à la consécration, quelques années plus tôt, de la liberté de la presse, l’information est un jeu qui se joue à trois, vitale pour le débat public, depuis la conversation dans les lieux publics ou les dîners en ville jusqu’aux interventions des partis politiques, dans l’enceinte des parlements. La vocation du journaliste, désormais, est de s’interposer entre des marchands, légitimement fondés à conquérir des clients, et des intellectuels, dont le métier consiste à propager ou à créer des œuvres de l’esprit. Mission difficile, voire impossible, empêchant les uns comme les autres, les intellectuels au même titre que les marchands, de se livrer à la surenchère, de se laisser emporter, par paresse ou aveuglement, contre leur intérêt bien compris, jusqu’aux limites les plus néfastes de leur activité : les journalistes permettent à ce vaste marché qu’est devenue l’information d’avoir un sens, de ne pas tourner à vide, sans repères, sans boussole, au point de faire le vide autour de lui ; ils offrent la possibilité aux intellectuels de ne pas vivre entre eux, repliés sur eux-mêmes, parmi leurs pairs, associés et rivaux, de s’engager à bon escient dans le débat public, chaque fois que s’impose selon eux leur intervention afin d’éclairer plus savamment le « grand public ».
Les journalistes permettent à ce vaste marché qu’est devenue l’information d’avoir un sens, de ne pas tourner à vide
Dans la société hypermoderne, que l’on dit « médiatique », le débat public s’inscrit à l’intérieur d’un triangle dont chacun des angles est occupé par les représentants d’une logique singulière : les journalistes, les intellectuels et les marchands. Entre eux, des relations d’alliance et de rivalité se nouent et se dénouent en permanence. Dans ce jeu à trois, tout doit être entrepris pour empêcher l’un des joueurs de dominer les deux autres ou d’être dominé par eux : le débat public ne s’accommode pas plus de la monocratie ou de la démagogie que de la médiacratie. De la même manière qu’il faut combattre le corporatisme, celui-là même qui naît de l’absence de sanctions à l’encontre de tous ceux qui dérogent aux lois les plus sacrées élaborées par leurs pairs. Ici et là se trouvent les moyens, si l’on veut hausser le niveau du débat public, de reconnaître à de nombreux journalistes le statut de vrais intellectuels, et de restreindre l’accès aux médias de vrais imposteurs, peu nombreux certes, qui revendiquent un statut de vrais intellectuels, sauf à soumettre leurs idées à l’épreuve qu’elles méritent.