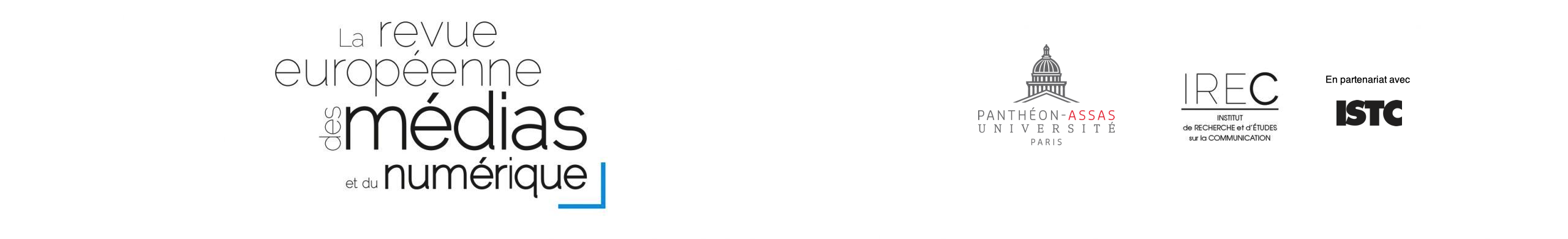Pendant longtemps, on a admiré le journalisme à l’anglo-saxonne : la distinction érigée en dogme entre les faits et les commentaires, l’importance accordée au reportage plutôt qu’à la chronique, la prudence extrême dans ses relations avec les sources d’information, quelles qu’elles soient, les exigences de ce journalisme d’investigation dont le Watergate, entre 1972 et 1974, fut le point d’orgue, enfin, le respect d’une discipline partagée par l’ensemble de la profession.
Le journalisme latino-européen a souvent été présenté comme une figure inversée de ce modèle de vertu : parce qu’il tient l’objectivité pour impossible et qu’il préfère parler de l’honnêteté du journaliste, à cause de son refus de considérer comme un dogme la séparation entre les faits et leurs commentaires, sans doute aussi pour l’inclination des journalistes européens « à expliquer ou à convaincre plutôt qu’à exposer », selon l’heureuse formulation de l’historien Pierre Albert, enfin et surtout, sans nul doute, pour s’être plus difficilement que son homologue anglo-saxon émancipé à la fois de la politique et de la littérature.
Il s’agit là, assurément, de représentations de caricatures, de types idéaux au sens du sociologue Max Weber : des modèles permettant à chacun de mieux rendre compte d’une réalité, d’en comprendre la logique, d’en identifier les règles et les valeurs, d’en expliquer les agissements par leur soumission à une discipline ou, mieux, à un idéal. A l’un, ce principe : les faits sont les faits, et il ne sert à rien d’en nier la matérialité. A l’autre, cette règle opposée : les événements sont inséparables de la signification qu’ils revêtent aux yeux de leurs acteurs ou de leurs témoins. Les Anglo-Saxons appliquent la règle selon laquelle, comme on le disait à l’époque de Balzac, « les faits sont sacrés, le commentaire est libre ». Les Européens, quant à eux, suivent le conseil qui fut donné par le Français Arthur Meyer à l’un de ses journalistes du Gaulois, peu après 1875 : « Sachez, monsieur, qu’il y a une manière légitimiste de présenter un fait divers ou de parler du temps qu’il fait ».
Bien sûr, au fil des ans, les deux formes de journalisme se sont rapprochées l’une de l’autre : le journalisme européen s’est converti aux techniques et aux valeurs du reportage tandis que son homologue anglo-saxon a découvert les charmes d’un journalisme alternativement ou simultanément littéraire et politique. Ce qui les unit a beau prévaloir encore sur ce qui les divise, le journalisme qui se pratique à la BBC, au Times, au Boston Globe ou sur PBS, n’en demeure pas moins un parangon de vertu, cet accomplissement édifiant d’un idéal professionnel tout entier dévoué à la fois au service de la vérité et à celui de l’intérêt commun.
Le scandale des écoutes téléphoniques du News of the World, en juillet 2011 (voir REM n°20, p.30), suivi du rapport de la commission Leveson sur « la culture, la pratique et l’éthique de la presse au Royaume-Uni », paru fin novembre 2012, a écorné grandement l’image idéalisée du journalisme anglo-saxon, en même temps qu’il ouvrait, à nouveau, le débat sur la déontologie, pas seulement au sein des journaux britanniques, mais également parmi leurs homologues américains et français.
Rappelons les faits : le 4 juillet 2011, le Guardian révèle que le téléphone de Milly Dowler, assassinée en 2002, aurait été écouté par un détective privé commandité par le News of the World. Six jours plus tard, soit le 10 juillet, le fleuron du groupe News Corp, le tabloïd dominical à sensation racheté en 2009 par Rupert Murdoch, est obligé de se saborder, après qu’on lui reprocha d’avoir mis sur écoute des centaines de personnes dans les années 2000 pour faire marcher sa machine à scoops, deux jours après que le Premier ministre David Cameron confia au juge Brian Leveson la présidence d’une « commission publique indépendante », chargée de « faire la lumière sur l’affaire » et de considérer l’éthique de la presse, notamment ses relations avec les policiers.
Après avoir entendu plus de 330 témoins, de l’acteur Hugh Grant au Premier ministre en passant par les rédacteurs en chef de nombreux médias britanniques, la commission Leveson recommandait, dans son rapport sur « la culture, les pratiques et l’éthique de la presse au Royaume-Uni », publié le 29 novembre 2012, la création d’une instance indépendante ayant le pouvoir d’enquêter et, le cas échéant, d’infliger des sanctions aux journaux qui dérogeraient aux règles du code de déontologie journalistique et éditoriale. Afin de donner à cette instance une véritable autorité, les rapporteurs préconisaient de graver dans le marbre d’une loi, non seulement sa création, mais également les modalités de son opération et de son fonctionnement. Le jour de la parution du rapport qui porte son nom, le juge Leveson déclara à propos de cette instance : « Il est essentiel que la législation en forme le socle », non sans avoir préalablement ainsi justifié cette précaution : « La presse a trop souvent ignoré ses responsabilités ».
Prudent, le juge Leveson avait néanmoins anticipé les préventions des journaux britanniques à l’endroit d’une discipline qui s’imposerait à eux sans qu’ils aient participé à sa détermination ni à sa mise en œuvre : « La loi, s’était-il empressé de déclarer, n’établirait pas une autorité pour réglementer la presse. Il reviendrait à la presse elle-même de proposer sa propre autorité ». C’est dans cette brèche, diplomatiquement ouverte par le président de la Commission, que vont s’engouffrer d’un même mouvement le Premier ministre et la plupart des journaux britanniques, préférant l’autodiscipline au spectre de toute hétérodiscipline, à l’encontre de Nick Clegg lui-même, vice-premier ministre libéral démocrate, favorable comme une bonne partie de l’opposition travailliste, à un « mini-carcan législatif », afin de répondre à l’indignation d’une opinion publique souvent inquiète devant les dérives des tabloïds.
Chacun, en vérité, avait de bonnes raisons, souvent inavouées, de faire le choix de l’autodiscipline, à l’instar de Tony Blair au lendemain de la mort tragique de Diana, en 1997, et dans le sillage de la Commission des plaintes en 1991 et du Conseil de la presse de 1953, pourtant si souvent voués à l’impuissance, par manque d’autorité véritable. Le Premier ministre David Cameron en vertu de ses convictions libérales, mais aussi parce qu’il était avant tout soucieux d’écarter le soupçon de suivre à la lettre les recommandations de la commission Leveson, alors qu’il avait recruté Andy Coulson, ancien rédacteur en chef du News of the World, pour prendre en charge sa communication. Les journaux britanniques dans leur ensemble, parce qu’ils estiment que les dérives, censées être corrigées par le rapport Leveson, appartiennent désormais au passé, et plus particulièrement parce que les tabloïds représentant environ les deux tiers du tirage de la presse britannique, ne veulent pas briser la machine qui abreuve leurs colonnes de scoops, beaucoup plus souvent médiocres que glorieux. Ainsi, le débat sur la déontologie est à nouveau ouvert, pour tous les journalistes, dans celui des pays démocratiques où il était le moins attendu. Avec la fermeture du tabloïd le plus célèbre du Royaume-Uni, un cap vient d’être franchi, dans ce pays où la lutte pour la liberté de la presse a été livrée plus tôt que partout ailleurs, avec l’abrogation du Licensing Act, en 1695, et avec ses multiples commissions d’enquête, entre 1947 et 2012. Certes, on ne met plus en cause, nulle part, la légitimité des journalistes : s’ils n’existaient pas, contrairement à l’injonction de Balzac, il faudrait … les inventer. Jamais, au contraire, cette légitimité n’a été mieux consacrée, et le monde entier se rallie au moins en paroles, à l’idée selon laquelle la liberté des journalistes est le « poumon » de la démocratie, selon la formule de la Cour européenne des droits de l’homme. Mais les journalistes n’en sont pas moins, pareillement, accusés d’abuser de leur liberté, de céder collectivement au corporatisme de l’irresponsabilité. A l’aube de l’an 2000, le professeur René Friedman, l’un des pères de la fécondation in vitro, protestait avec vigueur : « Que l’on critique un plumitif qui vient de publier une série de sornettes et […] l’ensemble de la profession crie à la censure. Le journalisme peut-il demeurer la seule profession à ne devoir de comptes à personne ? ».
Légitime, le journaliste se doit également, en effet, d’être crédible, de justifier à cette fin la confiance qu’il sollicite. Les lois du marché ne sauraient suffire : leur seule vertu est de permettre aux lecteurs ou aux téléspectateurs d’exprimer leurs préférences par les choix qu’ils opèrent. En l’occurrence, le marché est le pire des régimes, à l’exception de tous les autres, pour paraphraser l’indépassable plaidoyer de Churchill en faveur de la démocratie. Personne, du reste, parmi ses partisans les plus impénitents, n’a jamais fait du marché une école de vertu. La loi et les tribunaux ne suffisent pas davantage pour garantir tout à la fois la véracité des faits rapportés par les journalistes, la rigueur avec laquelle les analyses ou les interprétations doivent être menées et la sincérité avec laquelle ils livrent, le cas échéant, leur commentaire.
Reste alors la déontologie. Jean Daniel soulignait, à juste titre, en 1987 : « La meilleure manière de protéger les journalistes contre la tentation d’un abus de leur pouvoir, c’est d’entretenir un débat permanent sur leurs responsabilités ». Combien de colloques sur la déontologie ? De congrès ou d’états généraux ? De séminaires et de rencontres universitaires ? Pourquoi pas, en effet ? Pareils débats, périodiquement, immanquablement suivis de propositions de réformes, ne semblent guère lasser nos concitoyens, au grand étonnement, souvent, de leurs contemporains britanniques ou américains, pourtant attachés, au moins autant qu’eux, aux vertus et aux limites de la liberté des journalistes. Et il n’y a pourtant pas de meilleure déontologie que celle issue de l’expérience professionnelle. Les chartes déontologiques, ces règles que les journalistes se donnent à eux-mêmes et au respect desquelles ils entendent veiller collectivement, ces solutions intra-professionnelles, cette « autorégulation », ne sont sans doute pas inutiles. Elles sont une béquille pour la responsabilité individuelle du journaliste. Elles ne la remplacent nullement, en aucun cas. Elles ne doivent surtout pas devenir un alibi pour l’irresponsabilité individuelle. En deçà du juge, des lois qu’il est chargé d’appliquer ou de la jurisprudence que peu à peu il élabore, l’autorégulation de la profession joue tout au plus un simple rôle d’adjuvant à l’accomplissement, par les journalistes et les médias qui les emploient, de leurs responsabilités respectives.
Ce que désigne ultimement la permanence de ce débat sur les mérites comparés de l’hétérodiscipline et de l’autodiscipline, sur la supériorité de l’autorégulation sur les lois et la jurisprudence des tribunaux, c’est ce qui rend la tâche du journaliste si malaisée, voire impossible, en France peut-être plus qu’ailleurs, ce double malentendu, souvent, entre les pouvoirs et les journalistes d’un côté, et ces derniers et ceux auxquels ils s’adressent de l’autre.