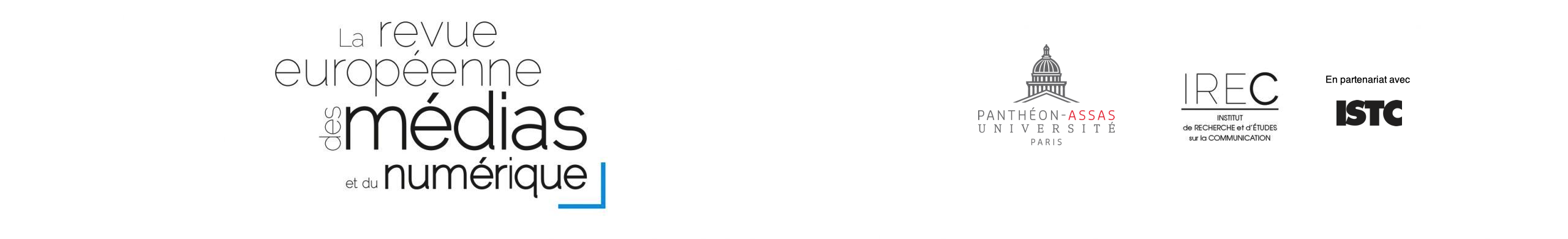Une liberté cardinale, une hyperliberté
Les limites de la liberté d’expression
Pas de liberté sans responsabilité
Morale de la conviction ou morale de la responsabilité ?
Le journaliste, seul juge et responsable
Le journalisme : un art « tout d’exécution »
Les événements tragiques dont la France a été le théâtre, entre le 7 et le 9 janvier 2015, ont ouvert à nouveau le débat sur la liberté de la presse, cette forme canonique de la liberté d’expression. Quelles sont ses limites ? Qui doit les fixer ? En sanctionner le franchissement ? Peut-on tout dire ? Tout montrer ? Tout moquer, tout caricaturer ?
Les foules rassemblées autour d’un même slogan, le 11 janvier, ont rétabli, aux yeux de tous, à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières, l’éminence, la prééminence devrait-on dire, de la liberté de la presse. Ce n’est sans doute pas un hasard si le même mot « presse » désigne l’outil, cette machine à imprimer inventée par Gutenberg, la mission que les siècles lui ont assignée, informer les citoyens, permettre aux hommes de s’exprimer, de communiquer entre eux et, enfin, un idéal, servir la démocratie, dont le destin est inséparablement lié au sien. Car la presse, à travers sa diversité, est l’acteur, le témoin et le chantre de la démocratie, en même temps que son symbole. La presse réalise l’idéal démocratique. Et la démocratie, en la protégeant, rend hommage à son incomparable vocation.
Une liberté cardinale, une hyperliberté
« Pas de liberté sans liberté de la presse » : tel est le sens ultime des slogans « Je suis Charlie – nous sommes Charlie ». Comme eux, l’heureuse formule de l’association Reporters sans frontières désigne excellemment la primauté, ou la suréminence de la liberté de la presse, celle d’une liberté qui n’est pas comme les autres : cardinale ou « fondamentale », elle est en effet première, à la fois logiquement et chronologiquement. Non seulement elle a été conquise avant d’autres libertés, en Suède, en Grande-Bretagne, puis aux Etats-Unis et en France ; mais elle apparaît, plus que jamais, comme la condition de possibilité des autres libertés, civiles ou politiques, personnelles ou publiques.
Cardinale en ce qu’elle permet seule l’expression des autres libertés, de toutes les autres libertés, la liberté de la presse n’en est pas moins semblable aux autres, en ceci que son exercice ne peut guère ne pas être subordonné à un idéal. Faute d’être ordonnée à une finalité, à l’instar de n’importe quelle liberté, la liberté de la presse patine ; comme la roue sur du verglas, elle n’accroche sur rien, elle n’avance pas plus qu’elle ne recule, comme les héros sartriens, prisonniers d’une liberté sans limites ni contraintes : pour se vouloir absolue, elle tourne à vide et finit par faire le vide autour d’elle. En l’occurrence, la liberté de la presse – cette liberté d’informer et son corollaire, le droit d’être informé – subordonne son exercice, pour n’être point vain, à un idéal de vérité, en réponse, n’en déplaise parfois à certains, à une attente informulée mais pressante d’objectivité de la part de ceux auxquels les journaux s’adressent.
[pullquote]Faute d’être ordonnée à une finalité, à l’instar de n’importe quelle liberté, la liberté de la presse patine.[/pullquote]
A travers la sélection qu’il opère entre les faits de l’actualité, la hiérarchie qu’il établit parmi eux, l’interprétation qu’il en donne, la prétention du journaliste à dévoiler la vérité n’est assurément pas infondée. Les récits que lui inspire l’actualité et qu’il nous livre ne sont pas, contrairement à ce que l’on voudrait parfois nous faire accroire, des constructions arbitraires, idéologiques, condamnées immanquablement à flatter ou à manipuler. Les faits sont bien réels, ils existent bien ; il est coupable de les dissimuler et ils doivent être rapportés dans leur véridicité et, autant que possible, avec véracité. Ils doivent être analysés et interprétés avec rigueur, soumis à l’épreuve d’une argumentation précise et serrée. Ils peuvent enfin donner lieu, le cas échéant, à un commentaire, à la lumière de convictions clairement affichées, avec sincérité par conséquent. La véracité, la rigueur et la sincérité sont, en l’occurrence, les vertus de la vérité. Ce que l’on invoque habituellement sous le nom d’objectivité ou d’honnêteté n’y change rien : comme tout idéal, celui-ci est aussi inaccessible qu’indispensable.
On ne peut manquer alors de s’interroger. Pourquoi s’est-on trop souvent interdit la recherche humble et nécessaire des faits, en opposant notamment l’islamisme radical à l’islam. Pendant plus de vingt ans, soulignait récemment Ghaleb Bencheikh, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, « nous n’avons rien fait pour expliquer aux jeunes la religion musulmane ». « Aimer la vérité, mais pardonner l’erreur », disait Voltaire, une idée qui figure sous une autre formulation dans le premier amendement de la Constitution américaine : « Mieux vaut se tromper plutôt que de cacher la vérité. » La vérité, certes, dérange parfois ; elle n’est pas toujours agréable pour tout le monde : « Notre métier, disait Albert Londres, n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Le déni des réalités finit immanquablement, un jour ou l’autre, par faire des victimes : ce ne sont pas toujours celles qu’on croit, mais celles que l’on voulait parfois épargner, par paresse ou par lâcheté. La réalité finit toujours par nous rattraper mais ceux qui la nient n’en sont pas souvent les premières victimes.
Les limites de la liberté d’expression
Cardinale, la liberté de la presse ressemble aux autres libertés, non seulement parce qu’elle est ordonnée à un idéal, en l’occurrence celui de la vérité, lorsqu’il s’agit de l’information, mais également parce que son exercice se heurte à certaines limites : d’abord, aux limitations, déterminées ou non par la loi, au respect desquelles veillent les tribunaux ; ensuite, au sens des responsabilités dont tout professionnel, quel qu’il soit, doit inlassablement et immanquablement faire preuve. Dans toutes les démocraties, avec ou sans le secours des lois, les tribunaux veillent à la protection des personnes, en sanctionnant l’injure ou la diffamation et l’atteinte à la vie privée ou à son intimité. Partout, des dispositions peuvent être prises, plus ou moins sévères, pour maintenir ou rétablir l’ordre public.
La liste des interdits, en France, n’a pas cessé de s’allonger après la loi Pleven, en 1972, instituant le délit de « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence », renforcée en 1990 par la loi Gayssot qui interdit « toute discrimination fondée sur l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion », à laquelle s’ajoute, depuis novembre 2014, l’interdiction de l’apologie du terrorisme, sans parler des lois, dites « mémorielles » qui confient à la loi plutôt qu’aux historiens le soin d’apprécier les méfaits de la colonisation, sans parler de cette loi de février 2000 interdisant, au nom de la présomption d’innocence, la publication des images de personnes menottées ou entravées.
Est-ce bien à la loi de restreindre la liberté d’expression, si légitimes que ces interdits puissent paraître ? La société française serait-elle à ce point fragile qu’elle ne puisse supporter la confrontation avec des contre-vérités, si ignobles soient-elles ? Et les esprits si faibles qu’ils ne puissent jamais résister à des manipulations, si grotesque soient-elles ? C’est oublier que la confrontation des opinions est nécessaire pour informer et éduquer les citoyens. Et que le meilleur moyen d’établir la vérité est encore et toujours de dénoncer les mensonges ou les erreurs qu’on peut commettre en son nom, en faisant usage de la raison, pour parler comme Emmanuel Kant. Et davantage encore que la meilleure façon de combattre l’obscurantisme est de lui permettre de s’exprimer, afin de mieux le récuser : non pas tolérer les propos intolérables, mais les réfuter avec la dernière des énergies. Le philosophe Gaspard Koenig, fondateur de Génération Libre, estime que c’est par la raison et l’éducation, et non par la censure, que l’on gagnera ce combat, fidèle en cela à l’esprit des Lumières. La meilleure façon de lutter contre l’obscurantisme n’est pas de l’interdire ; il faut au contraire lui permettre de s’exprimer, afin de le mettre en danger et de le mieux pourfendre. L’humoriste Jamel Debbouze, aussitôt rejoint par Human Rights Watch, ne disait pas autre chose, à propos de l’interdiction du spectacle de Dieudonné : « Laissons parler les imbéciles ». Autrement, en effet, dans ses emballements, la machine médiatique en fait une victime ou un héros, donnant de surcroît l’impression très fâcheuse du deux poids, deux mesures.
[pullquote]La meilleure façon de lutter contre l’obscurantisme est de lui permettre de s’exprimer[/pullquote]
La multiplication des limitations apportées à la liberté de la presse, si légitimes que puissent paraître leurs justifications, marque assurément la défiance du législateur vis-à-vis des citoyens, estimant que la mauvaise information finirait par chasser la bonne, comme on dit de la mauvaise monnaie qu’elle chasse la bonne. Mais elle ne peut manquer, à la longue, d’engager les journalistes dans la voie d’une censure insidieuse, donnant ainsi des gages aux conformismes les plus établis et les mieux ancrés dans l’opinion. L’autocensure n’est-elle pas pire que le silence imposé par la loi ? On ne peut s’empêcher de recommander cette injonction, à propos de la liberté de la presse et de la démocratie, à l’adresse des législateurs trop pressés d’agir : autant de débats et d’éducation que possible, autant de police et de justice que nécessaire.
Pas de liberté sans responsabilité
Nulle part, les limitations apportées par la loi ou la jurisprudence des tribunaux ne sauraient suffire : elles tracent seulement un périmètre à l’intérieur duquel s’exerce la liberté de la presse et des journalistes. Pas plus que la concurrence entre les journaux n’est un secours ou un alibi : le marché n’est pas une école de vertu, il permet seulement au lecteur de choisir son journal, seule façon de lui donner le dernier mot, celui auquel il a droit ; le pire des régimes, selon la formule de Churchill, à l’exception de tous les autres.
A l’intérieur de ce périmètre, jusqu’où le journaliste peut-il aller ? Le débat sur la déontologie, partout, est permanent. Parce que la liberté dont les journaux jouissent implique, de leur part, le sens toujours en alerte de leurs multiples et diverses responsabilités, certaines institutions ont souvent été mises en place : conseils de presse, selon l’exemple britannique, médiateurs – ombudsmen – au sein des rédactions, suivant le modèle suédois, revues professionnelles ou académiques qui dénoncent les dérives de l’information…
[pullquote]Autant de débats et d’éducation que possible, autant de police et de justice que nécessaire[/pullquote]
A propos de ces diverses institutions, créées avec les meilleures intentions du monde, on ne peut néanmoins manquer de s’interroger : de quelle légitimité peuvent-elles se prévaloir pour juger les œuvres des journalistes ? Qui sont-ils, les initiateurs de ces institutions, qu’ils soient ou non journalistes, pour juger ? Au demeurant, comme l’affirmait encore Jean Daniel récemment, « la meilleure manière de protéger les journalistes contre la tentation d’un abus de leur pouvoir, c’est d’entretenir un débat permanent sur leurs responsabilités ».
Les journalistes, dans les temps agités que nous vivons, sont parfois accusés, en effet, d’abuser de leur liberté, d’aller trop loin, forts de la légitimité que leur confère la place imminente de la presse, institution égale en dignité au Parlement, au moins dans les démocraties dignes de ce nom. Les juges en tout cas leur donnèrent raison après la publication par Charlie Hebdo, en février 2006, des caricatures du prophète Mahomet, quatre mois après un quotidien danois, contre certaines associations musulmanes françaises accusant le journal satirique français « d’injures publiques envers un groupe de personnes en raison de [leur] religion ». En concluant par la relaxe, les juges avaient alors admis, comme le souhaitaient les journaux français, solidaires de leurs confrères, que les religions, si « respectables » soient-elles, ne pouvaient échapper « à l’analyse, à la critique, à la dérision ». Les journalistes donneraient-ils alors l’impression, au nom de la liberté dont ils sont titulaires, de « tourner (cette liberté) au corporatisme de l’irresponsabilité », comme l’affirmait Jean-Louis Servan-Schreiber il y a plus de vingt ans ?
Morale de la conviction ou morale de la responsabilité ?
Au lendemain des événements tragiques de janvier 2015, les journalistes de Charlie Hebdo furent confrontés à ce dilemme : en publiant en couverture du journal, le 14 janvier, une caricature de Mahomet, ils obéissaient au principe de la liberté d’expression dont se réclame la démocratie, tout en demeurant fidèles à la facture de la publication dont les principaux responsables venaient d’être assassinés. En refusant de publier ces dessins, ils auraient pris en compte les conséquences qu’une pareille publication pouvaient comporter, mais ils auraient transgressé, assurément, leur ultime raison d’être, bien au-delà de ce que leurs lecteurs, habituels ou non, attendaient. Eternel débat entre la morale de la conviction et la morale de la responsabilité. Le médecin ou l’avocat est confronté quotidiennement au même dilemme : quand celui-là ajuste le propos à son patient atteint par la maladie ou quand celui-ci agit de même pour le justiciable confronté à un juge, l’un et l’autre obéissent pareillement à ce commandement selon lequel, afin d’atteindre le but recherché, au mieux la guérison ou le non-lieu, l’un et l’autre ne donnent à leur interlocuteur que la dose de vérité qu’il est capable de supporter. Force est bien d’admettre que le journaliste n’est pas avec chacun de ses lecteurs dans cette même relation de colloque singulier qui caractérise le face-à-face du malade avec son médecin ou celui du justiciable avec son avocat. De là cette difficulté particulière, voire cette mission impossible, pour le journaliste, soucieux en permanence de ne pas rompre le contrat de confiance qui le lie à chacun de ses lecteurs, au risque permanent d’entamer sa crédibilité, le crédit dont il bénéficie, jusqu’à sa totale extinction.
Le journaliste, seul juge et responsable
Une chose, au moins, est sûre, si l’on prend en compte tout ce qu’implique le respect du principe de la liberté de la presse : c’est aux journalistes seuls d’agir en toute responsabilité, et non aux tribunaux de trancher, et pas davantage à leurs lecteurs eux-mêmes, qui sont toujours libres de se détourner de ce qui les offense ou leur déplaît. Au pape François, en voyage aux Philippines, qui dénonçait, à propos du Charlie Hebdo paru le 14 janvier, l’offense commise à l’endroit d’une religion, les implications du principe de la liberté de la presse commandent, en toute logique, de préférer l’attitude du grand rabbin de France, Haïm Korsia, déclarant quelques jours plus tard : « Si quelque chose est blasphématoire pour moi, je ne le regarde pas », comme une conséquence de cet avertissement : « On ne peut pas projeter notre interdiction (de blasphème) sur les autres. »
Le constat en appelle un autre, non moins contraire aux idées reçues. La déontologie – ces règles plus ou moins codifiées que la profession se donne à elle-même et que les journalistes sont censés respecter grâce à des institutions qui prétendent les représenter –, n’est au mieux qu’un adjuvant pour l’exercice, par les journalistes, de leurs responsabilités. Elle peut jouer le rôle de béquille pour l’exercice, par chaque journaliste, de sa responsabilité. Elle ne saurait en aucun cas la remplacer et ne doit pas davantage devenir un alibi pour l’irresponsabilité individuelle. Au pire, les déontologues autoproclamés qui veillent sur les journalistes ne sont que les gendarmes de la pensée officielle. Ils détournent alors les journalistes de leur vocation plutôt que d’en favoriser un accomplissement moins imparfait.
Il faut l’admettre sans barguigner, contrairement aux idées reçues : la seule règle est celle de la responsabilité personnelle du journaliste. Le droit d’informer implique le devoir, parfois, de se taire. Pierre Péan, célèbre pour les enquêtes qu’il a menées, exprimait récemment ce devoir sans ambages : « J’estime que j’ai le droit, voire le devoir, de ne pas tout dire ce que je sais. Le journalisme, ce n’est pas seulement trouver, mais c’est choisir. » Hugues Moutouh, l’auteur de 168 heures chrono, la traque de Mohamed Merah, témoin du télescopage entre l’enquête policière et l’enquête journalistique, lorsqu’il était membre du cabinet du ministre de l’intérieur, semble donner raison au journaliste : « Lors d’une enquête judiciaire sensible, le plus souvent les médias sont un boulet. »
La religion, aux Etats-Unis, est un domaine parfaitement sanctuarisé : on peut tout à loisir, défendre les thèses les plus ignobles, proférer des propos éminemment blasphématoires et exprimer même des opinions proches du nazisme, mais on ne peut guère, sous la bannière étoilée, porter atteinte à ces religions qui se confondent, dans le roman national américain, avec le civisme et la fidélité au drapeau. Aussi les journaux anglo-saxons ont-ils apporté des réponses différentes à la question de l’opportunité de publier les caricatures de la « une » de Charlie Hebdo du 14 janvier. Le New York Times a choisi de ne pas publier ce dessin, qu’il jugeait offensant et qui constituait à ses yeux une « provocation », en application d’une règle que le journal prétend s’imposer à lui-même : « Nous ne publions jamais de contenus intentionnellement destinés à heurter les sensibilités religieuses. » Au Royaume-Uni, les médias n’ont pas tenu un langage très différent, justifiant leur refus de publier le dessin de Luz, comme le Guardian, précisant sur son site que l’article « contient l’image de la couverture de magazine, que certains peuvent trouver offensante ». Le Washington Post a fait le choix inverse, estimant que la couverture du journal n’était pas « délibérément ou gratuitement offensante ». Apparemment dédouanés ou encouragés par leur illustre confrère, les plus grands médias d’information américains l’ont suivi, depuis USA Today et le Los Angeles Times jusqu’à CBS News, en passant par le Wall Street Journal et The Daily Beast.
Au sein du monde musulman, les grands médias furent également divisés sur l’opportunité de reproduire les dessins parus dans l’hebdomadaire français de 14 janvier. Les plus nombreux, parmi eux, ont choisi de ne pas publier la caricature, rejoints par certains pays d’Afrique ou d’Asie. Ils se ralliaient en l’occurrence à l’argument avancé par Al Azhar, la principale autorité sunnite ayant son siège au Caire, qui a estimé qu’avec ces dessins, le journal français « ne sert pas la coexistence pacifique entre les peuples et entrave l’intégration des musulmans dans les sociétés européennes et occidentales ». A l’inverse, le plus grand quotidien laïque, en Turquie, Cumhuriyet, a repris dans un cahier central du journal, la plupart des articles et des dessins de Charlie, y compris sa couverture, bravant les autorités conservatrices d’Ankara, qui en vilipendaient les « provocations ».
Parmi les journaux français qui ont opté pour la reproduction de la couverture représentant Mahomet en larmes, les arguments sont différents de ceux avancés par leurs homologues étrangers ayant fait le même choix : ils invoquent leur solidarité avec Charlie Hebdo et prônent le droit à la liberté d’expression, quelles que soient les modalités de son exercice. Libération s’honore de la parution du journal dont les rédacteurs ou caricaturistes furent assassinés, en lançant un retentissant « Je suis en kiosque ». Le Monde justifie son choix en estimant qu’« il s’agit […] d’un message pacifique. Le dessin n’est ni injurieux ni agressif ». Et d’ajouter : « Nous défendons notre droit à publier n’importe quel dessin qui ne soit pas insultant. » Quant aux Inrockuptibles, à partir d’un autre dessin représentant lui aussi Mahomet en larmes, il entend illustrer une « tristesse partagée par tous, exprimer [une] colère sourde ». Allant jusqu’aux conséquences possibles de ce choix : « Si certains veulent y voir un blasphème, tant pis : rien ne les empêchera de réagir comme ça. »
[pullquote]Nous sommes, avec les seules armes du raisonnement, dans le domaine de l’indécidable[/pullquote]
Aucun argument, en réalité, ne permet de choisir entre la morale de la conviction et la morale de la responsabilité, de façon en tout cas aussi tranchée que notre volonté d’être rassurés le voudrait. Nous sommes, avec les seules armes du raisonnement, dans le domaine de l’indécidable. L’exercice du droit à la liberté d’expression, en cette cruelle occurrence, est d’autant plus redoutable que l’appréciation de ses conséquences est sinon impossible, du moins incertaine. L’intransigeance dans la défense des principes les plus sacrés permet-elle jamais à quiconque de se soustraire à ses responsabilités, si difficiles à appréhender soient-elles ?
Le journalisme : un art « tout d’exécution »
Le journaliste, comme l’historien, sait qu’il n’accède jamais qu’à des vérités partielles, imparfaites, approximatives et provisoires, mais l’un ou l’autre veut, comme ceux auxquels il s’adresse, que ces vérités ne soient entachées d’aucun esprit partisan, d’aucun esprit de système, d’aucun esprit de certitude, sauf s’il prend le parti contraire et qu’il l’affiche plutôt que de le cacher. Du fait que les vérités du journaliste sont vues immanquablement à travers le prisme de leurs préoccupations ou de leurs inclinations, pourquoi conclure qu’il faut renoncer à l’idéal d’objectivité, à la courageuse et nécessaire recherche de la vérité ? Pourquoi, de la même façon, ne pas admettre que l’information, pour les médias, est un combat sans fin ? Un combat qui n’est jamais gagné contre ce que Jean-Claude Guillebaud appelle le « grand bavardage des médias », qui fait trop souvent son lit de nos paresses et de nos faiblesses. Un combat permanent contre les rumeurs ou les préjugés, qui expriment toujours nos peurs et nos ignorances. Un combat difficile mais nécessaire enfin contre l’esprit du temps, ces idées reçues ou cette pensée commune que les bien-pensants répètent sans jamais se lasser, et sans du reste jamais penser. Le comble de l’objectivité, quand on commence à douter de sa possibilité, n’est-il pas d’avouer sa subjectivité, dans un ultime élan d’honnêteté : c’est Albert Camus, parangon de sincérité, suppliant son interlocuteur, peu avant 1962, de ne pas avoir à choisir entre sa mère et l’Algérie ?
Puissent les événements de janvier 2015 rappeler à chacun la vocation indispensable pour une société démocratique des professionnels de l’information, irremplaçable et difficile. Produit de l’histoire plutôt que réalisation d’un architecte inspiré, le journalisme est une parole singulière, une parole que la société se donne à elle-même et à propos d’elle-même. Cette parole ne vaut que si elle est véritablement libre et autonome : le journaliste se doit d’entretenir de bonnes relations avec tout le monde sans être jamais le porte-parole de qui que ce soit. Vis-à-vis des responsables de la ligne éditoriale, des experts dont il sollicite les avis, de ses confrères, à la fois associés et rivaux, et des acteurs ou des témoins de l’actualité, le journaliste doit garder ses distances, ni trop loin, ni trop près de chacun d’eux, sans défiance ni confiance excessives, évitant par conséquent les écueils opposés d’une suspicion et d’une connivence également trompeuses et compromettantes. Les pressions exercées à l’endroit du journaliste ne sont pas en soi scandaleuses ; il serait scandaleux, en revanche, que le journaliste ne leur opposât aucune résistance, aucun esprit critique.
C’est dans cette équidistance qu’il trouve sa liberté, soumise aux seules exigences d’exactitude et de sincérité qui sont les vertus de la vérité. Cette liberté lui serait contestée ou retirée par ses mandants, lecteurs ou téléspectateurs, auditeurs ou internautes, s’il était l’avocat, sans le dire, d’un interlocuteur privilégié, d’un parti pris ou d’une idéologie quelconque. S’il choisit officiellement d’être impartial plutôt que militant, le journaliste fait peser un soupçon sur l’information, chaque fois qu’il s’écarte de cette mission que la société ouverte et démocratique lui assigne : être un spectateur et non un acteur, un observateur plutôt qu’un instituteur, un greffier et non un avocat ou un procureur, un médiateur plutôt qu’un censeur. Il peut arriver que le journaliste ne remplisse pas sa mission, en démocratie, parce qu’il prétend jouer un rôle qui n’est pas le sien : celui de la Pythie de Delphes, chargée de transmettre les oracles des dieux, plutôt que celui de la vigie, apparemment moins glorieux, chargée de surveiller le large, en observation dans la mâture ou à la proue du navire.
[pullquote]Le journalisme est une parole singulière, une parole que la société se donne à elle-même et à propos d’elle-même[/pullquote]
Puissent ces mêmes événements du début 2015 également mettre en garde chacun d’entre nous contre la tentation toujours présente d’oublier l’injonction de la Bible selon laquelle la vérité, seule, nous « rendra » ou nous « fera » libres. Puissent-ils enfin mettre en demeure tous ceux qui nous informent, par quelque média que ce soit, que leur responsabilité est, comme, la guerre selon Napoléon, un art « tout d’exécution ». Et que la presse, le plus ancien des médias d’information, n’est plus seule. Pourquoi ce qui est bon pour les journaux, la concurrence, le professionnalisme, avec ses savoir-faire et ses disciplines, ne serait-il pas également bon pour les radios, les télévisions et les services du web, qui se veulent pareillement dévolus à l’information ? A jouer quitte, la liberté perdrait, à tous les coups. Il n’y a pas d’autre choix, à l’ère numérique, que de doubler la mise.