Des années 1980 aux années 2000, entre une économie mondialisée dominée par les marchés financiers et les difficultés des puissances publiques à tenter d’en réguler les effets sur les sociétés et les individus, le capitalisme est entré dans une crise complexe qui contredit la doxa de l’autorégulation. Parmi les déclencheurs figurent l’excès de financiarisation des secteurs de l’économie de services, la tension entre la surproduction et la paupérisation d’une partie croissante des classes sociales, l’accentuation des dégâts environnementaux de l’industrie et de la consommation de masse, les antagonismes géopolitiques entre richesse, pauvreté et accès aux ressources (matières premières et ressources vitales).
Facteur décisif, l’informatisation de la société amorcée dans les années 1960 s’est intensifiée : elle a suivi l’avancement des technologies de l’information et a amorcé une nouvelle transition, de nouveaux choix collectifs, faisant reposer de plus en plus les organisations sur les technologies numériques, les réseaux et l’automatisation de la décision. En réplique, les critiques du capitalisme ne se concentrent plus sur la seule approche marxiste du rapport entre propriété des moyens de production, course au taux de profit et conséquences sur les classes sociales. Ces critiques analysent aussi les modalités du capitalisme moderne à travers les choix stratégiques comme la transformation de la donnée en capital et la concentration des savoirs ; les choix structurels telle l’émergence d’une économie de plateformes ; les choix de l’investissement spéculatif dans les technologies de l’information, dans la prépondérance du marketing et des orientations de l’économie de services ; enfin les choix éthiques comme l’intrusion dans la vie privée et la sélection sociale des consommateurs. Ces choix ont ceci de particulier qu’ils accentuent le rôle crucial de la surveillance, conçue à la fois comme moyen de production de données, comme moyen d’influence de l’économie marchande (influence sur le consommateur) et comme moyen d’optimisation de la production (surveillance des travailleurs sur l’outil de production ou sur la plateforme à l’interface entre travailleur et client).
Ces pratiques de surveillance font l’objet de critiques d’autant plus acerbes que leur régulation par l’État a tendance à échouer sur les rivages de la confiance politique et des contradictions de la démocratie libérale. Les Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) sont souvent sous les feux de la rampe. Depuis une vingtaine d’années, ces entreprises américaines organisent à leur profit une concentration, inédite dans l’Histoire, de capitaux et d’innovations technologiques. Leur hégémonie déséquilibre le rapport de force nécessaire aux États dans leur rôle de régulateur. En concentrant les capitaux et la technologie, elles organisent aussi une concentration du pouvoir qu’elles disputent aux États en situation de quémandeurs1.
En 2014, les révélations d’Edward Snowden démontraient les alliances, dans une vaste opération d’espionnage global, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières, entre les plus hautes autorités des États-Unis et ces entreprises disposant des capitalisations boursières les plus élevées. Depuis, la concurrence mondiale a eu tendance à accentuer les effets délétères des luttes hégémoniques, en particulier selon les trois aspects de la géopolitique (par exemple, les firmes américaines versus les géants chinois, les BATX que sont Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), des secteurs d’innovation à forte croissance (par exemple, le courtage de données, les infrastructures de réseaux) et des plateformes (par exemple, le divertissement en ligne, la voiture connectée, les services à la personne, la santé personnalisée).
L’ANNÉE 2014 A VU NAÎTRE UN CONCEPT DÛMENT TRAVAILLÉ, CELUI DE CAPITALISME DE SURVEILLANCE
L’impact de l’économie de la surveillance sur la vie quotidienne des individus et sur les rapports sociaux est cependant analysé depuis de nombreuses années par les études de surveillance (surveillance studies), sans pour autant faire des technologies numériques et de la gouvernementalité les objets centraux de leurs préoccupations. L’essentiel de ces études est influencé par la pensée européenne sur la politique (Max Weber), par la critique des technologies (Jacques Ellul), par l’histoire des institutions et la critique du pouvoir (Michel Foucault). Cet héritage est mobilisé surtout aux États-Unis dans les années 1970, conjointement aux premiers grands débats publics concernant l’usage des bases de données et le traitement des données personnelles par les institutions publiques ou les grandes entreprises. À cette période, surgissent au premier plan des juristes tels Alan Westin2 ou Arthur R. Miller3 qui entreprennent une critique systématique de l’informatisation de la société et qui posent les bases d’une définition de la privacy (les conditions d’exercice de la vie privée), laquelle se répandra rapidement en Europe. Et c’est au sociologue James B. Rule que revient la primeur d’une approche intégrée de la surveillance en société, considérée comme « l’attention systématique portée sur la vie d’une personne de manière à exercer une influence sur elle »4. Cette action sur le quotidien est examinée selon une heuristique de la « surveillance totale »5. Inspiré en arrière-plan par la dystopie orwellienne, J. B. Rule développe une critique du contrôle social, de l’analyse prédictive des comportements et, dans la droite ligne de Michel Foucault, examine le rapport entre traitement automatisé des données, obéissance, institutions et pouvoir.
Pour autant, les postures théoriques des études de surveillance sont très différentes et dépendent de l’objet que l’on envisage sous l’angle de la surveillance. Dès lors, pour adopter un point de vue plus global, il faut inscrire ces études dans l’histoire de la surveillance, autrement dit, comprendre dans quelle mesure l’économie de la surveillance et la critique de la surveillance cheminent ensemble depuis les débuts de la révolution numérique et comment cette « dialectique » a construit nos rapports individuels et collectifs à la surveillance, dans le droit, les institutions, l’innovation technologique (plus généralement industrielle) et la politique.
À l’instar de David Lyon pour qui la surveillance est devenue culturelle6 et participe à la structuration sociale (tout le monde est surveillé, s’accommode de la surveillance et même y participe activement), un premier pavé dans la mare des liens entre modernité et surveillance avait été jeté dès le début des années 1980 par Anthony Giddens. Prenant du recul par rapport à la seule approche sociale, il interroge notre condition d’êtres en perpétuelle insécurité, dont découle le besoin d’une confiance, parfois irrationnelle, dans les institutions.
Giddens s’emploie à déterminer ce que sont les « institutions » de la modernité qui se sont radicalisées : le capitalisme, l’industrialisme, le militarisme, la surveillance (le contrôle de l’information et le monitoring social). Ces régimes organisationnels forment ensemble une définition globalisée de l’État « moderne-contemporain » et en assurent la permanence. En 1985, il affirmait ainsi à leur propos : « Ce sont des processus associés au système de l’État-nation, coordonnés par des réseaux mondiaux d’échange d’information, l’économie capitaliste mondiale et l’ordre militaire mondial. »7
Selon Giddens, il reste des moyens de dépasser ces régimes de la modernité : ce sont les mouvements sociaux tels le syndicalisme, l’environnementalisme, le militantisme contre l’armement. Cela étant dit, on peut s’étonner que, lecteurs ultérieurs de Giddens (ceux que l’on dira de la « troisième voie » prônée par des dirigeants tels que Clinton ou Blair, et Macron), certains décideurs politiques s’obstinent à susurrer un refrain social-démocrate basé sur des mécanismes de régulation du capitalisme les moins contraignants possible, pour finir par laisser la voix au discours néolibéral qui ne fait qu’intensifier inégalités et tensions sociales. Il reste qu’aujourd’hui, si la « troisième voie » n’est plus considérée comme une option viable, c’est parce que les mouvements contre-discursifs se situent désormais dans la « zone du dehors » selon l’expression d’Alain Damasio8, plus exactement en dehors de l’opinion que l’on façonne et que l’on surveille (à grand renfort de communication numérique, comme l’a montré le scandale Facebook-Cambridge Analytica), et en dehors des mécanismes désuets de la représentation politique. Ils prennent place dans un ensemble fédéré de mouvements préfiguratifs (en tout cas anthropologiquement visibles9) qui tout à la fois inventent des mécanismes de démocratie directe et s’inscrivent dans une critique radicale du capitalisme. En ce sens, faire une critique de la surveillance et de sa tendance à structurer la société de manière normative, institutionnelle et culturelle, c’est contribuer à cette critique globale du capitalisme.
L’année 2014 a vu naître un concept dûment travaillé, celui de capitalisme de surveillance, concept qui caractérise à la fois l’économie comportementale et l’impératif du profit qui transforme la donnée numérique en capital extractible de toutes les composantes de l’économie, notamment nos vies publiques et privées, notre travail, notre santé. En 2014, le sociologue John B. Foster et l’historien des communications Robert W. McChesney ouvrent la voie dans les pages de la Monthly Review et inaugurent dans un article fondateur10 le concept de capitalisme de surveillance11. Ils le situent dans une histoire longue, celle de l’économie politique de la seconde moitié du XXe siècle. Ils suivent une critique du capitalisme monopoliste et des stratégies américaines en termes d’intérêts de marchés (une critique datant des années 197012) tout en interrogeant la dynamique hégémonique de l’économie de la donnée soutenue par le complexe industrialo-militaire et la surfinanciarisation économique. Leur conclusion est sans appel : le capitalisme de surveillance fonctionne sur la connivence entre le système impérialiste états-unien et les entreprises qui jouent le même jeu dans un échange d’intérêts bien compris.
Ce que la population mondiale a appris avec les révélations d’Edward Snowden, ce n’est pas le degré d’exhaustivité de la surveillance (contrairement aux idées reçues, c’est un sujet déjà ancien), c’est le rapport entre la surveillance et la géopolitique, c’est-à-dire le lien entre les technologies de surveillance – qui, après la Guerre froide, ont trouvé un débouché dans l’économie de plateformes et de la consommation – et les stratégies hégémoniques des États-Unis, qui abritent les principaux fournisseurs de ces technologies.
L’ERREUR MÉTHODOLOGIQUE CONSISTE À CROIRE QUE CETTE FORME DE CAPITALISME EST NÉE AU XXIe SIÈCLE
S’appropriant le concept de J. B. Foster et R. W. McChesney13 dans une série d’articles et dans un best-seller14, la spécialiste en management Shoshana Zuboff entreprend une analyse systémique des pratiques du capitalisme de surveillance dans l’économie numérique récente. Elle adopte une posture plus descriptive et se concentre sur l’hydre qu’ont créée les plateformes des années 2000, illustrant en particulier avec Google le destin des start-up condamnées à exploiter les données personnelles pour répondre à la pression de la rentabilité, sous couvert d’un discours solutionniste15. Ce qu’elle dénonce comme « capitalisme de surveillance », jusqu’à essentialiser les « capitalistes de surveillance » , c’est l’action combinée de la soif de données et de la normativité comportementale qu’elle induit, dans cet effort permanent de prédiction algorithmique et de recherche de rentabilité. Tout en poursuivant son « processus historique d’extraction » (ici des données personnelles), le capitalisme aurait subi selon elle une transformation néfaste, au point de conditionner nos comportements, nous priver de vie privée et de nos capacités d’agir de manière autonome, que ce soit individuellement ou collectivement. La conclusion est la même que précédemment : le capitalisme de surveillance est une menace pour la démocratie. En revanche, là où J. B. Foster et R. W. McChesney proposent une critique globale et historique, S. Zuboff réclame plutôt (sans toutefois fournir de solution) un sursaut démocratique dans le domaine de la régulation, un remède pour sauver le capitalisme malade dans nos démocraties libérales. S. Zuboff a popularisé le concept de capitalisme de surveillance parce que son analyse correspond parfaitement à la vision immédiate des causes et des effets de la surveillance dans l’économie comportementaliste d’aujourd’hui. C’est un réquisitoire, tout à fait fondé, à propos des plateformes de courtage de données qui conditionnent nos comportements et accaparent quotidiennement nos expériences. Mais qui devrions-nous accuser précisément ? L’erreur méthodologique consiste à croire que cette forme de capitalisme est née au XXIe siècle, par l’entremise des moyens inédits d’automatisation de l’exploitation des données dans les mains de quelques monopoles. C’est faire bien peu de cas de l’Histoire16. C’est succomber à une certaine forme de déterminisme technologique : quelles innovations auraient été à ce point dominantes qu’elles en auraient radicalement et subitement transformé le capitalisme ?
L’EFFET PERVERS FUT DE LAISSER FINALEMENT LIBRE COURS AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE DE L’EXPLOITATION DES DONNÉES PERSONNELLES TANT QUE LEUR USAGE EST CONSIDÉRÉ LÉGITIME ET CONSENTI
Deux aspects de l’Histoire doivent plutôt retenir notre attention. Le premier est le fait que ce que nous appelons rapidement « défense de la vie privée » est la tendance, depuis plus de cinquante ans, à construire un cadre réglementaire de l’usage des données personnelles pour défendre l’individu face aux pratiques des entreprises et des États, tout autant qu’à prémunir les États des risques anticonstitutionnels liés à l’exploitation des données personnelles. Durant ce demi-siècle, de l’affaire Conus Intel au Patriot Act aux États-Unis, ou du scandale de l’affaire Safari à la loi Renseignement en France, les sociétés n’ont eu de cesse de mettre en cause les pratiques d’extraction, de conservation et d’usage des données personnelles par les autorités à des fins de contrôle ou d’influence.
Concernant les entreprises, à commencer par les banques et les assurances, d’Equifax à Google, l’encadrement des pratiques a une histoire tout aussi longue et concomitante17. Avant d’essaimer en Europe et partout dans le monde, c’est aux États-Unis que débute la défense de la vie privée face aux pratiques des entreprises, particulièrement les banques et les sociétés de crédit18, et la propension de l’État à concevoir des banques de données sur les citoyens. Cette histoire a consolidé les conditions selon lesquelles nous exerçons notre droit à avoir une vie privée, ce que rassemble le terme anglais privacy : secret, intimité physique et psychique, sécurité et protection de l’individu, maîtrise de l’information le concernant. Si la privacy est un concept en perpétuelle évolution, c’est parce qu’il conditionne le développement du droit en la matière depuis les années 1960. Les flous juridiques ne cessèrent de se dissiper au fur et à mesure des luttes collectives des consommateurs et des scandales qui jalonnent l’histoire de la révolution informatique. En d’autres termes, la sauvegarde de l’autonomie de l’individu à consentir ou non à l’exploitation de ses données personnelles est ce qui a construit l’échafaudage du droit en la matière, mais l’effet pervers fut de laisser finalement libre cours au développement économique et technique de l’exploitation des données personnelles tant que leur usage est considéré légitime et consenti. Là où la défense de la vie privée est un combat collectif devant la toute-puissance du Leviathan, elle devient une question de liberté individuelle devant l’impératif économique. Or, le pouvoir de l’individu n’est rien à partir du moment où la surveillance des comportements devient la clé de voûte de toute l’économie de consommation et même un marché ouvert aux institutions de contrôle étatiques.
L’EMPLOI JUDICIEUX DES MACHINES POUR « TRAVAILLER » LA DONNÉE
En ce sens, les pratiques de Google et de Facebook ne sont que des fruits du capitalisme de surveillance et non des jeunes pousses qui auraient à elles seules transformé le capitalisme. Pour mieux le comprendre, le second aspect qui doit nous intéresser a trait à l’histoire des techniques. On retient souvent de la révolution informatique une grande suite d’innovations – des machines à calcul aux microprocesseurs et à la naissance de l’industrie logicielle. Mais lorsque l’on se penche de manière un peu plus concrète sur les usages, on constate au tournant des années 1960 et 1970 ce que des historiens appellent la « seconde révolution informatique »19, celle de l’utilité des ordinateurs, leur intégration dans les organisations pour devenir des « systèmes d’information ». Ces derniers deviendront les supports d’une nouvelle forme de rentabilité, celle qui permet d’augmenter le profit en valorisant les données numériques. Calculer et modéliser la production, prédire statistiquement le comportement de la clientèle et adapter la stratégie marketing sont des éléments qui finirent par caractériser l’activité économique à grand renfort de bases de données.
LES PRATIQUES DE GOOGLE ET DE FACEBOOK NE SONT QUE DES FRUITS DU CAPITALISME DE SURVEILLANCE ET NON DES JEUNES POUSSES QUI AURAIENT À ELLES SEULES TRANSFORMÉ LE CAPITALISME
À l’instar de David Edgerton pour qui l’histoire des techniques gagne à s’intéresser davantage aux usages, aux routines, et aux transformations des objets d’innovation plutôt qu’aux innovations elles-mêmes20, on peut considérer la transformation numérique des organisations dans l’économie capitaliste comme l’évolution des usages des machines informatiques, en dehors des seuls besoins de calcul d’ingénierie ou de comptabilité, vers l’ouverture de nouveaux débouchés. Ce fut la jonction entre l’industrialisation et la vente en masse des ordinateurs mainframe, les premiers grands travaux théoriques sur les bases de données relationnelles, et l’émergence d’un savoir-faire en stockage de l’information. Non pas tant la création de nouvelles machines et supports de stockage (quoique les industriels, IBM en tête, y jouèrent un rôle fondamental), mais l’emploi judicieux des machines pour « travailler » la donnée. C’est ainsi que, disposant d’ordinateurs mainframe pour leur propre gestion interne, de grandes entreprises américaines comme l’Union Tank Car Company (spécialisée dans la location de wagons de chemins de fer) ou Thompson Ramo Wooldridge Inc. (spécialisée dans l’aérospatiale et les composants électroniques) rachetèrent des bases de données de sociétés d’évaluation de crédit pour devenir respectivement Trans Union et Experian. C’est aussi en s’informatisant et en rachetant d’autres compagnies et leurs bases de données que la Retail Credit Company devint Equifax. Il y avait une montagne de données à exploiter et des investissements informatiques à rentabiliser.
On sait que ces entreprises, qui exercent aujourd’hui un monopole extraordinaire dans leurs domaines, furent régulièrement sur le devant de la scène durant les décennies qui suivirent en raison de leurs pratiques irrespectueuses du cadre juridique de la vie privée. Or tout ceci se joua à l’extrême fin des années 1960 et au début des années 1970, non pas parce qu’on avait innové en créant des ordinateurs (ils étaient là auparavant) mais parce que, après la maîtrise de la donnée de production dans l’organisation du travail, l’exploitation de la donnée clientèle avait acquis l’un des plus hauts degrés de rentabilité en économie, et a justifié davantage les monopoles et la concentration de l’information.
Nulle surprise par conséquent de voir l’émergence du courtage de données à cette même période, à la jonction entre le traitement des listes de clients et les recherches les plus pointues en statistiques et bases de données appliquées à la prédiction comportementale.
L’EXPLOITATION DE LA DONNÉE CLIENTÈLE AVAIT ACQUIS L’UN DES PLUS HAUTS DEGRÉS DE RENTABILITÉ EN ÉCONOMIE
Sur ce point, l’histoire passionnante d’Acxiom, aujourd’hui leader mondial du courtage de données, mérite que l’on s’y intéresse. Auparavant, nommée Demographics Inc. et fondée en 1969 afin d’appuyer les campagnes électorales des Démocrates de l’Arkansas, et aussi d’autres États, Acxiom regroupait d’anciens cadres d’IBM qui cherchaient à améliorer la rentabilité de leur modèle de marketing électoral informatisé. Avec un matériel informatique vieillissant, mais dont ils connaissaient les moindres rouages, ils ouvrirent en 1972 un nouveau marché basé sur l’automatisation du traitement marketing. Sans entrer dans les détails, on retient qu’il s’agissait d’un service en réseau de traitement numérique automatisé de campagne marketing à destination des entreprises. On passait de la simple campagne de mailing personnalisé à l’adaptation différentielle de l’exploitation des bases de données en fonction des cibles clientèles et de leur répartition géo-démographique. On retient aussi que, avec un tel outil, Demographics n’avait pas quitté la course numérique que se livraient les partis Républicains et Démocrates depuis des années aux États-Unis. Marketing et politique menaient un même combat sur le marché de l’influence. C’est aussi en 1972 que naquit Claritas Inc., dirigée par un sociologue, Jonathan Robbin, qui développait PRIZM (Potential Rating Index for Zip Markets), devenu aujourd’hui une référence, un système de segmentation et de classification géodémographique des populations croisé avec l’analyse du style de vie (lifestyle). Et cet ensemble doit aussi être rapproché des recherches sur les bases de données relationnelles tels les travaux initiés par Edgar Codd en 1970 et par toute une communauté de chercheurs avec lui21.
LE MARKETING IMPOSE UNE IDENTITÉ SOCIALE ESSENTIELLEMENT DÉFINIE PAR LE COMPORTEMENT DE CONSOMMATION
Pour comprendre ce qu’implique le capitalisme de surveillance dans nos vies, il ne suffit pas de s’enivrer des multiples reproches que l’on pourrait faire aux entreprises dont le rôle est d’extraire et d’exploiter nos données personnelles. Il faut aussi s’interroger sur l’histoire de la construction d’une culture de la surveillance qui implique l’adhésion à plusieurs principes. Ainsi, accepter que le marketing a lui aussi procédé à une révolution numérique dans les années 1970 et qu’il impose une identité sociale essentiellement définie par le comportement de consommation (au sens large de la décision / acquisition) et réductible à un ensemble de caractéristiques mesurables. Ces caractéristiques sont de l’ordre de la démographie (qui habite où, qui va où, etc.) et de la psychologie sociale (le concept de voisinage, de leader d’opinion, la place dans la hiérarchie d’une entreprise, etc.). Cela aboutit à des classements par stéréotypes dont la cohérence repose sur des scores quantifiés. Or, comme le disaient déjà James Martin22 et Adrian Norman dans The Computerized Society en 197023, le principal danger de l’omniprésence des algorithmes dans les systèmes décisionnels est que, à partir du moment où un système est informatisé, la quantification devient la seule manière de décrire le monde avec tous les biais que cela suppose. David Lyon consacrera de nombreuses études au sujet de ce qu’il nomme le tri social, à la source de nombreuses inégalités et néanmoins socialement structurantes.
LA QUANTIFICATION DEVIENT LA SEULE MANIÈRE DE DÉCRIRE LE MONDE AVEC TOUS LES BIAIS QUE CELA SUPPOSE
Un autre principe auquel nous avons fini par adhérer est que les caractéristiques que l’on surveille prédisent le comportement et ce qu’il faut attendre d’un individu lorsqu’au moins une donnée modifie sa vie quotidienne. Cela suppose de représenter les individus suivant l’homogénéité de leurs habitudes et de classer les groupes ou segments de consommateurs en fonction de caractères psychologiques communs24. C’est ce qui explique que le capitalisme de surveillance, outre l’effet d’accaparement propre au capitalisme tout court, est en réalité la construction de notre adaptation aux modèles économiques par la privation de libre choix (concurrentiel), ce qui va même à l’encontre du libéralisme classique et de la sacro-sainte liberté de choix du consommateur dans un marché de libre concurrence. Un point que soulève S. Zuboff – mais qui est sans conteste mieux analysé par Barbara Stiegler qui livre une critique du néolibéralisme et de l’économie comportementale qu’il a engendrée25, ainsi que par Bernard Stiegler qui concevait que le nouvel ordre de l’économie numérique a prolétarisé l’homme en le privant de ses savoirs (les savoir-faire, en particulier dans le monde du travail, et les savoir-être, en transformant les modes de vie)26.
NOTRE ADAPTATION AUX MODÈLES ÉCONOMIQUES PAR LA PRIVATION DE LIBRE CHOIX
La notion de classe sociale a-t-elle laissé la place à cette segmentation systématique ? L’affaire Facebook-Cambridge Analytica a montré au moins deux choses. La première est que les vieilles techniques de profilage (clustering, segmentation, règles d’association, etc.) et de prédiction (séries temporelles, modèles de régression, etc.) qui ont été élaborées dans les années 1970 fonctionnent toujours, simplement à des niveaux d’exhaustivité plus hauts en raison de l’abondance des données. Ce fut le rôle de marketing d’influence de AggregateIQ, la société à laquelle était adossée Cambridge-Analytica. La seconde est que la communication devient mot d’ordre (au sens où Gilles Deleuze l’entendait27) à partir du moment où l’effet de l’information dans un système (un groupe, une cible) est calculé et pondéré afin de transformer significativement le système, comme influencer un vote. Dans une telle configuration, le dialogue politique n’a plus lieu d’être : l’information est réduite à n’être que ce que statistiquement la cible ou le segment peut ou doit entendre.
En somme, le capitalisme de surveillance est l’expression d’un marché de la donnée dont les débouchés principaux (les services) sont l’influence, la prédiction et le contrôle. Ce marché est la réponse économique à un capitalisme en crise et qui, pour se maintenir, impose une guerre d’acteurs hégémoniques dans une course à la donnée numérique. Les enjeux se situent tantôt sur les marchés intérieurs (par exemple, hier augmenter la production de l’économie de consommation pour les États-Unis, aujourd’hui maîtriser les velléités trop libérales des BATX pour la Chine), tantôt sur les marchés extérieurs (par exemple, la gestion stratégique des noms de domaine, ou la propriété des câbles sous-marins). L’argument selon lequel le capitalisme de surveillance nous prive de nos libertés économiques aboutit invariablement au fait qu’il nous confisque aussi notre autonomie de décision et par conséquent nos choix politiques. Néanmoins, nous ne sommes pas réductibles à nos libertés économiques. Prétendre le contraire serait jouer ce jeu de l’économie comportementale et, à l’instar de S. Zuboff, réduire le combat à la sauvegarde de la « dynamique de la démocratie de marché »28.
L’INFORMATION EST RÉDUITE À N’ÊTRE QUE CE QUE STATISTIQUEMENT LA CIBLE PEUT OU DOIT ENTENDRE
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’une nouvelle critique du capitalisme, avec cette double perspective mondiale et sociale : une interrogation sur nous-mêmes qui pourrait composer avec la technique, sur nos résistances, notre réappropriation « tactique » comme l’aurait dit Michel de Certeau29, afin de s’opposer à l’ordre organisateur du capitalisme de surveillance dans ses dimensions techniques, économiques et politiques.
Low-techs, logiciels libres, réseaux fédérés sont des solutions techniques d’opposition qui ont besoin d’une mise en commun des savoirs plus que jamais nécessaire pour entrevoir des portes de sortie. Mais la réponse tactique n’est pas que technique, elle ne peut venir que par l’entremise des groupes et des collectifs qui réinventent les usages des technologies et les pratiques démocratiques, préfigurant un monde plus juste et plus égalitaire face aux deux piliers du capitalisme que sont la radicalisation du contrôle par les institutions et l’omniprésente influence par les entreprises monopolistes.
Sources :
- Après avoir organisé leur propre neutralisation par les politiques de dérégulation des communication, comme le dit Pierre Musso : « La dérégulation a fonctionné comme une politique symbolique qui permit aux visions néolibérale et néosocialiste de célébrer en commun la fin de l’emprise étatique et politique sur la communication ». Musso Pierre, Télécommunications et philosophie des réseaux. La postérité paradoxale de Saint-Simon. Paris, Presses universitaires de France, 1998, p.353.
- Alan F. WESTIN, « Civil Liberties and Computerized Data Systems », Martin Greenberger (dir.), Computers, Communications, and the Public Interest, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1971.
- Arthur R. MILLER, The Assault on Privacy. Computers, Data Banks and Dossier, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1971.
- James B. RULE, Douglas McADAM, Linda STEARNS et David UGLOW, « Documentary Identification and Mass Surveillance in the United States », Social Problems, 1983, vol. 31, n°2, p.222-234.
- James B. RULE, Private Lives and Public Surveillance : Social Control in the Computer Age, New York, Schocken Books, 1974.
- David LYON, The Culture of Surveillance : Watching as a Way of Life, Cambridge, Royaume-Uni, Polity Press, 2018.
- Anthony GIDDENS, The Nation-State and Violence, Cambridge, UK, Polity Press, 1985, p.135 et p.290. (En 1981, déjà, Giddens affirmait que « l’ordinateur n’est pas aussi dissocié de l’histoire du capitalisme industriel que l’on pourrait l’imaginer ; et considérer l’informatisation seule comme un nouveau complément tout à fait distinct de la surveillance est trompeur ». Anthony GIDDENS, A Contemporary Critic of Historical Materialism. Vol. 1 Power, Property and the State, Berkeley, University of California Press, 1981, p.169.)
- Alain DAMASIO, La Zone du dehors, Paris, France, La Volte, 2007.
- Marianne MAECKELBERGH, « Doing is Believing : Prefiguration as Strategic Practice in the Alterglobalization Movement », Social Movement Studies, 2011, vol. 10, n°1, p.1-20 ; David GRAEBER, Comme si nous étions déjà libres, traduction de l’anglais d’Alexie Doucet, Montréal, Canada, Lux Éditeur, 2014.
- Cet article a été récemment traduit par Maud Barret Bertelloni et Vincent Ortiz dans la revue LVSL sous le titre « Marketing, financiarisation et complexe militaro-industriel : les trois sources de la data-économie » (01/09/2021). URL : https://lvsl.fr/marketing-financiarisation-et-complexe-militaro-industriel-les-trois-sources-de-la-data-economie/.
- John Bellamy FOSTER et Robert W. McCHESNEY, « Surveillance Capitalism. Monopoly-Finance Capital, the Military-Industrial Complex, and the Digital Age », Monthly Review, 07/2014, vol. 66.
- Paul Alexander BARAN et Paul Marlor SWEEZY, Le Capitalisme monopoliste : un essai sur la société industrielle américaine, Paris, France, François Maspero, 1968 ; Susan STRANGE, « International Economics and International Relations : a Case of Mutual Neglect », International Affairs, 1970, vol. 46, n°2, p.304-315.
- Sans toutefois citer les auteurs qui ont travaillé cette idée auparavant. Voir la note des éditeurs de la Monthly Review, vol. 68, n°1, 2016. URL : https://monthlyreview.org/2016/05/01/mr-068-01-2016-05_0/.
- Shoshana ZUBOFF, The Age of Surveillance Capitalism : The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, New York, Public Affairs, 2019.
- Evgeny MOROZOV, Pour tout résoudre cliquez ici. L’aberration du solutionnisme technologique, Paris,Éditions FYP, 2014.
- Christophe MASUTTI, Affaires privées. Aux sources du capitalisme de surveillance, Paris, C&F éditions, 2020.
- Au Congrès des États-Unis, par exemple, les longues discussions préalables au Privacy Act de 1974 concernaient aussi bien l’usage des données par le gouvernement que l’usage des données par les entreprises privées. (U.S. CONGRESS SENATE COMMITTEE ON GOVERNMENT OPERATIONS, Legislative History of the Privacy Act of 1974, Washington, U.S. Government Printing Office, 1976 ; UNITED STATES CONGRESS, Federal Data Banks, Computers, and the Bill of Rights : Hearings, Ninety-second Congress, U.S. Government Printing Office, 1971).
- Josh LAUER, Creditworthy. A History of Consumer Surveillance and Financial Identity in America, New York, Columbia University Press, 2017.
- Paul E. CERUZZI, A History of Modern Computing, MIT Press., Cambridge, Mass., 2003.
- David EDGERTON, « De l’innovation aux usages. Dix thèses éclectiques sur l’histoire des techniques », Annales. Histoire, sciences sociales, 1998, vol. 53, n°4, p.815-837.
- Voir Christophe MASUTTI, « En passant par l’Arkansas. Ordinateurs, politique et marketing au tournant des années 1970 », Zilsel, Science, Technique, Société, vol. 9, 2021 (à paraître).
- James MARTIN fut l’auteur quelques années plus tard d’un best-seller : The Wired Society, 1978.
- James MARTIN et Adrian R. D. NORMAN, The Computerized Society. An Appraisal of the Impact of Computers on Society over the Next 15 Years, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1970.
- Cette conception sera plus clairement formulée par les travaux d’Arnold Mitchell et du Stanford Research Institute qui, partant de l’étude sociologique de la fragmentation de la société américaine des années 1950 et 1960, propose le concept de segmentation psychographique, une approche suivant la méthodologie Values, Attitudes and Lifestyles (VALS). Les premiers travaux du SRI commencèrent en 1970 et A. Mitchell publia un best-seller à ce sujet en 1983 (Arnold MITCHELL, The Nine American Lifestyles. Who We Are and Where We’re Going, New York, Macmillan Publishing, 1983).
- Barbara STIEGLER, « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique, Paris, France, Gallimard, 2019.
- Bernard STIEGLER, La Société automatique 1. L’avenir du travail, Paris, Fayard, 2015.
- C’est-à-dire un système de contrôle. Voir sa conférence Qu’est-ce que l’acte de création ?, Mardis de la Fondation FEMIS, 17/05/1987.
- Shoshana ZUBOFF, « Big Other : Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization », Journal of Information Technology, 30, 2015, p.75-89.
- Michel de CERTEAU, L’Invention du quotidien, Paris, France, Gallimard, 1990.
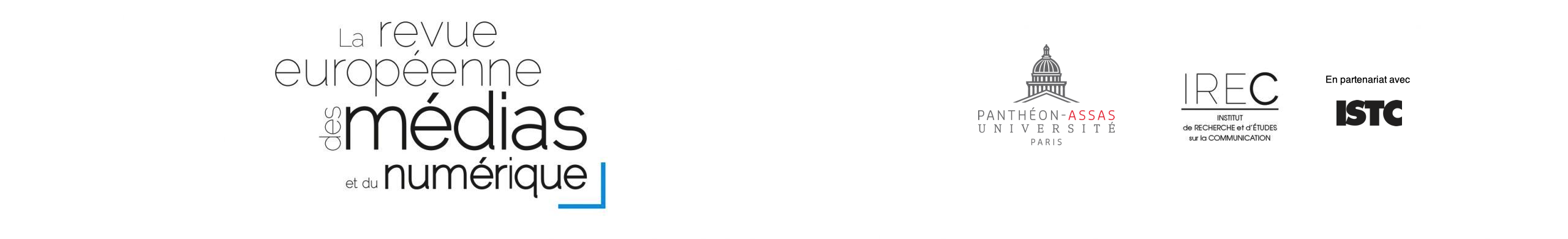

[…] Encore une autre approche du capitalisme de surveillance Par Christophe Masutti -N°59 Automne 2021 […]