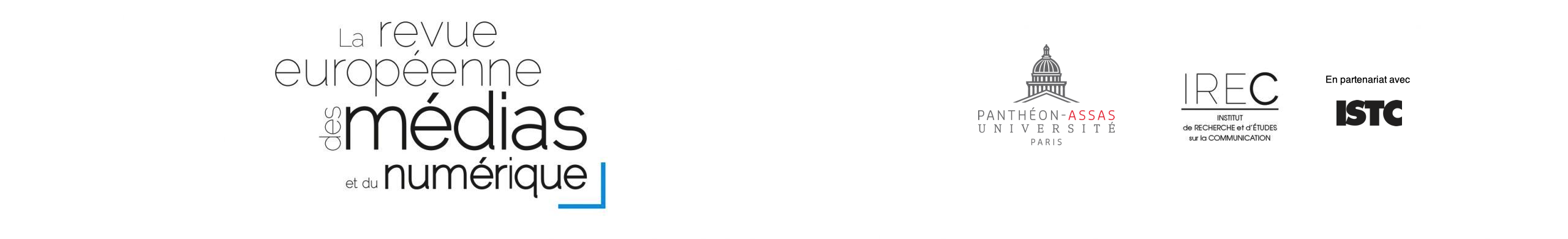L’affaire Snowden, qui défraya la chronique tout au long de l’été 2013, éclaire d’un jour nouveau les relations des journalistes avec leurs informateurs, ce qu’il est convenu d’appeler leurs « sources ». Non pas que l’internet, avec ses témoignages improvisés, les conversations diverses dont il est le convoyeur attitré, constitue désormais un vivier inépuisable et sans fond à la disposition des journalistes professionnels. Mais parce qu’il perpétue en l’amplifiant une évolution dont le coup d’envoi remonte aux années 1970.
Snowden n’est assurément ni un traître, ni un héros ; ni celui qui, par ses révélations, aurait trahi les Etats-Unis et leurs alliés, ni un champion de la liberté d’expression, dénonciateur indispensable des atteintes aux libertés publiques et aux droits des citoyens dont le gouvernement de son pays se serait rendu coupable. Il ne mérite, en vérité, ni cet excès d’honneur, ni cette indignité. Il n’est, à tout prendre, que le continuateur, avec les moyens de son époque, d’une entreprise dont Ralph Nader, le célèbre militant du droit des consommateurs, fut l’heureux initiateur, aux Etats-Unis, dans les années 1970. C’est lui qui proclama, en 1974, la possibilité, voire le devoir, pour des employés, de révéler à leur direction, à la police ou aux médias, au nom de l’intérêt commun, la malhonnêteté d’un administrateur, la corruption d’un dirigeant, un commerce nuisible à la santé ou une entrave aux libertés. Le dénonciateur, le whistleblower – celui qui souffle dans le sifflet -, comme on le désigna très vite outre-Atlantique, constitue ainsi, pour Ralph Nader, « la dernière ligne de défense des citoyens ordinaires contre le déni de leurs droits et de leurs intérêts par des institutions secrètes et puissantes ».
Semblables dénonciations furent légion, dès les années 70, relayées par les médias les plus prestigieux, depuis les « papiers du Pentagone », livrés au New York Times en 1971 par Daniel Ellsberg, un analyste militaire, qui dévoilaient l’intensification de l’engagement militaire américain au Vietnam, jusqu’aux avertissements lancés en 1979 par certains écologistes, lors de l’accident de la centrale de Three Mile Island, en passant par la célèbre affaire du Watergate, divulguée en 1974 au Washington Post par Mark Felt, l’un des chefs du FBI.
La floraison de dénonciations a conduit le Congrès américain à promulguer, en 1989, le Whistleblower Protection Act, qui défend toute personne apportant la preuve d’« une infraction à une loi, à une règle ou à un règlement », ou bien encore celle d’« une mauvaise gestion évidente d’un flagrant gaspillage de fonds, d’un abus de pouvoir ou d’un danger significatif [ayant] trait à la santé et à la sécurité du public ». La protection apportée par cette loi a été étendue aux employés fédéraux dépendant de l’exécutif par la No Fear Act de 2000, puis, en 2012, par le Whistleblower Protection Enhancement Act.
En évoquant pour la première fois en 1994 le rôle des « lanceurs d’alerte », le sociologue français Luc Boltanski, lui-même dénonciateur impénitent des injustices, donnait ses lettres de noblesse à une autre catégorie de révélations : à la différence du whistleblower, qui atteste d’une dérive ou d’un abus de pouvoir déjà existant, le lanceur d’alerte anticipe un risque, dans le domaine de la santé ou celui de l’environnement, révélant une menace ou, davantage encore, un danger qu’il estime sous-évalué, voire méconnu. Les lanceurs d’alerte ont leur Ralph Nader en la personne d’André Cicoletta. Toxicologue à l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), il organisa un colloque international, en avril 1994, sur les effets nocifs de certains solvants utilisés dans les peintures et les détergents, ce qui devait entraîner son licenciement pour « faute grave » par l’Institut. La Cour de cassation reconnut le caractère abusif de cette mise à pied, en octobre 2000, et le rétablit dans ses droits.
Depuis cette date, la liste des craintes collectives n’a pas cessé de s’allonger, tandis que le principe de précaution, gravé désormais dans la Constitution de la République française, leur conférait, sinon toujours une irréfutable justification, du moins une forme de légitimité, une ultime raison d’être : dans le désordre, le changement climatique, les diverses pollutions, les maladies émergentes, les menaces du Big data sur la vie privée…
Pareil concours de circonstances rencontra son point d’aboutissement lorsqu’une loi du 3 août 2013 consacra le lanceur d’alerte en disposant que « toute personne physique ou morale a le droit de rendre public ou de diffuser un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou pour l’environnement ».
Le constat aujourd’hui s’impose : les lanceurs d’alerte et les dénonciateurs, successeurs plus ou moins inspirés du toxicologue français ou du défenseur américain du consommateur, sont pour les journalistes d’ici ou d’ailleurs des informateurs à part entière, en même temps que les témoins et les acteurs d’un événement de l’actualité, ou encore les auteurs de n’importe quelle œuvre, glorieuse ou médiocre. Bien plus : les journalistes et ces informateurs consacrés par l’air du temps ont besoin les uns des autres. Privés du relais des médias d’information, les dénonciations et les avertissements, si justifiés soient-ils, resteraient lettre morte. Et les médias, de leur côté, doivent dénoncer « ce qui ne va pas » et alerter sur les risques à venir, afin de les mieux prévenir en même temps qu’ils rapportent, en historiens du présent, « ce qui se passe ». Ils failliraient à leurs obligations s’ils y renonçaient, avec l’espoir aussi vain que secret, de ne pas tourmenter ceux qui leur font confiance.
C’est ici que réside, pour les journalistes, l’exercice d’une responsabilité redoutable et écrasante. Parmi les dénonciations qui sont portées à leur connaissance, lesquelles divulguer parce qu’elles servent l’intérêt public : les actes pénalement répréhensibles ? Les agissements coupables des autorités ? Toute dénonciation doit être suspectée de verser dans la délation, parce qu’elle peut se révéler infondée, malveillante ou calomnieuse. Qui est-on pour dénoncer ? De quel droit ? En vertu de quel devoir ?
Les journalistes ne sont pas moins épargnés par la perplexité lorsqu’il s’agit de se faire ou non l’écho des avertissements des lanceurs d’alerte. Quels objectifs poursuivent-ils en désignant un risque potentiel, une menace plus ou moins grave, un danger imminent ? Parmi les experts, combien n’ont d’expert que le nom ? Pseudo-experts ou experts autoproclamés ? Certains ne sont-ils pas des « prophètes de malheur », très opportunément désignés ainsi par Hans Jonas, le philosophe allemand auteur du principe de précaution ? D’autant qu’à l’heure de l’internet, n’importe qui peut s’improviser lanceur d’alerte. Comment rendre compte des désaccords parmi les experts, des positions respectives des uns et des autres, alors que les médias sont tentés de donner la parole aux seuls dissidents ?
WikiLeaks et Snowden constituent chacun, en l’occurrence, un cas d’école. Chacune de ces deux affaires a mis les journalistes et les médias au pied du mur, les condamnant à accomplir une mission improbable ou délicate, voire impossible. Qui, pourtant, reprocherait aux représentants de quatre journaux – The New-York Times, Der Spiegel, The Guardian et Le Monde – aussitôt rejoints par El Paìs -, d’avoir accepté la proposition de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks ? Existe-t-il en effet un seul journal capable de résister devant la promesse de coups médiatiques en série ? Au ministre italien des affaires étrangères de l’époque qui évoque un « 11-septembre médiatique », Sylvie Kauffmann, du quotidien français, objecta par avance qu’avant la publication des premiers mémos diplomatiques, près de 120 journalistes des cinq rédactions avaient échangé « beaucoup d’informations, d’analyses et d’expertises », écartant certains télégrammes dont le « sérieux » ne semblait pas garanti, « rayant [en outre] des noms ou des indications pour protéger la sécurité des personnes ».
De leur propre aveu, les acteurs et les spécialistes eux-mêmes des relations internationales n’ont assurément pas appris grand-chose qu’ils ne savaient déjà. Bien qu’il ne se soit agi, le plus souvent, que de pseudo-révélations, la proposition de Julian Assange n’en est pas moins pour autant un hommage du vice rendu à la vertu. Après un procès de plus de trois mois, pendant lequel il expliquait n’avoir pas « mesuré la portée » de ses actes et regretté qu’ils « aient blessé les Etats-Unis », le soldat de deuxième classe Bradley Manning a été reconnu coupable d’« espionnage » et condamné à 35 ans de prison pour avoir transmis à WikiLeaks plus de 700 000 documents confidentiels de l’armée américaine. « Toute révélation d’un secret, disait La Bruyère, est la faute de celui qui l’a confié ».
Le cas d’Edward Snowden est différent. Interrogé par Le Monde, André Cicoletta, le parangon des lanceurs d’alerte en France, déclara à propos de l’ancien administrateur de la NSA : « Il est courageux. Il a choisi l’intérêt public alors qu’il risque sa liberté ». Au demeurant, Snowden n’a rien révélé, comme le souligne Philippe Boulanger, qu’on ne savait déjà. Ou bien, si l’on préfère recourir au vocabulaire de son collègue Michel Riguidel, expert européen en sécurité numérique, l’ancien consultant de la CIA n’aurait révélé qu’un « secret de Polichinelle ». Ne disait-on pas, à l’époque de la guerre froide, que les ambassades étaient des « nids d’espions » ? Il se prévaut néanmoins d’un devoir moral pour divulguer ces informations, se drapant dans les oripeaux de la liberté d’expression, ceux des amendements de la Constitution américaine, le premier, mais aussi les 4e et 5e. Réfugié à Hong Kong, il déclarait en août 2013 : « Je suis prêt à tout sacrifier car je ne peux pas, en l’occurrence, laisser le gouvernement américain détruire la protection de la vie privée ». Les dispositions du Whistleblower Protection Act de 1989 n’ont pourtant pas empêché l’inculpation d’Edward Snowden, au grand regret du National Whistleblower Center, dirigé par Stephen Kohl : la plupart des agents fédéraux qui dépendent de l’exécutif ou du renseignement américain, en effet, ne sont pas protégés par la loi. Alertés, les journalistes devaient-ils s’interdire de divulguer ces vrais ou faux secrets ? Pour se défendre, ils peuvent, eux aussi et à bon droit, invoquer la célèbre mise en garde de La Bruyère.
Heureux ou amer, le constat s’impose : à l’ère de l’internet, les révélations de toute nature, sous forme de dénonciations, d’alertes ou d’avertissements, qu’elles émanent d’experts ou de militants diversement qualifiés et plus ou moins bien intentionnés, se multiplient et se multiplieront toujours davantage. Comment séparer le bon grain de l’ivraie ? Qui croire, quand on ne sait rien ou pas grand-chose ? Jusqu’où aller pour ne pas aller trop loin, sans mettre en péril la sécurité des personnes ou celle des collectivités auxquelles elles appartiennent ? A l’égal d’un médecin ou d’un historien, le journaliste sait qu’il ne doit jamais proposer que la dose de vérité que ceux qui lui accordent leur confiance sont capables de supporter, d’autant que ses vérités sont toujours partielles, imparfaites et provisoires. Il sait aussi, ce même journaliste, que les curiosités des ses mandants ne sont pas toujours glorieuses et qu’il serait irresponsable de flatter ou d’encourager abusivement, parmi elles, les plus médiocres, les moins indispensables et, probablement, les plus pernicieuses.
Aucune loi, aucun décret, ne facilitera, pour le journaliste, l’exercice d’une responsabilité dont on sait désormais qu’elle est tout à la fois plus exigeante et plus malaisée que jamais. Les pressions qui s’exercent sur lui ne sont pas toutes, en tant que telles, scandaleuses, d’où qu’elles viennent : on tiendrait pour scandaleux, en revanche, qu’il ne leur opposât aucune résistance, aucun esprit critique. Faute d’exercer pleinement cette responsabilité, de l’exercer souverainement, en parfaite autonomie, les médias d’information, tentés toujours de vouloir « plaire et séduire », encourent le risque de tourner à vide et de se perdre en de vains bavardages.