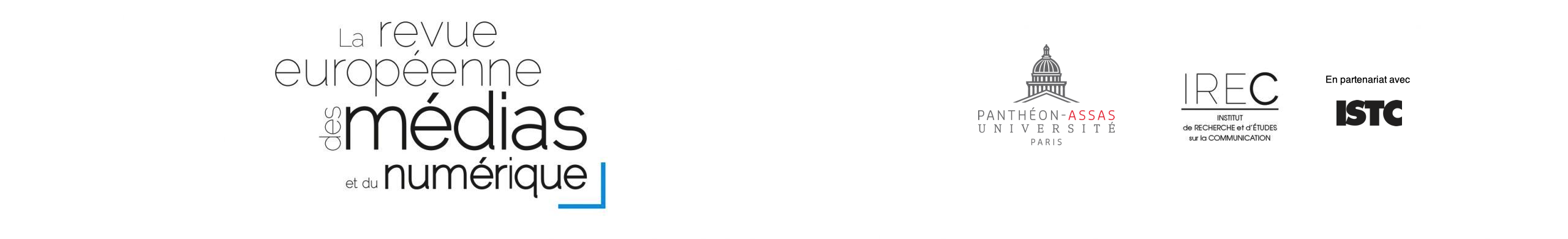Interview d’Agnès Callamard, rapporteure spéciale à l’ONU – Propos recueillis par Françoise Laugée
Depuis 2016, vous êtes rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires au Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Quelles sont les conditions d’exercice de votre mandat ?
Les personnes nommées au titre des procédures spéciales sont des experts indépendants nommés par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour traiter des situations propres à un pays ou à des questions thématiques, où que ce soit dans le monde. Ces experts reçoivent leur mandat sur la base de leurs compétences, de leur expérience dans le domaine couvert et de leur indépendance. J’ai été nommée à ce poste en juillet 2016, à l’issue d’un processus beaucoup plus difficile que celui qui caractérise ces nominations en règle générale. Au dernier moment, alors que les États membres du Conseil des droits de l’homme étaient sur le point d’approuver ma nomination, la Russie s’y est opposée. Les fondements de ce rejet étaient pour le moins peu clairs. Il s’agissait probablement de « jouer des muscles » au niveau diplomatique et d’imposer un droit de veto. Cela n’a pas abouti et je suis très reconnaissante envers le président du Conseil de l’époque (le diplomate coréen) d’avoir tenu bon face aux menaces.
En tant que rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, j’exerce mes fonctions à titre personnel (six ans au maximum) et dans une totale indépendance. Je ne fais pas partie du personnel de l’ONU et je ne perçois aucun traitement ni aucune autre rémunération en contrepartie de mon travail. Ce principe est fortement remis en question par l’ensemble des rapporteurs de l’ONU. En pratique, il signifie que seuls les experts qui ont les moyens financiers de travailler au moins deux jours par semaine sans être payés peuvent vraiment poser leur candidature à ce poste. Seuls sont donc volontaires ceux et celles qui sont à la retraite, ou ayant des employeurs qui reconnaissent l’importance d’un tel poste, comme les universités. Il y a des exceptions bien sûr. Mais de nombreux rapporteurs spéciaux sont issus du milieu universitaire.
SEULS LES EXPERTS QUI ONT LES MOYENS FINANCIERS DE TRAVAILLER AU MOINS DEUX JOURS PAR SEMAINE SANS ÊTRE PAYÉS PEUVENT VRAIMENT POSER LEUR CANDIDATURE À CE POSTE
Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) est censé nous fournir du personnel et un appui logistique afin de soutenir notre travail. De nouveau, c’est loin d’être le cas. Je fais partie des privilégiés dans la mesure où mon mandat reçoit le soutien à l’heure actuelle de deux employés du HCDH, en raison du grand nombre d’exécutions auquel je dois répondre. Mais nombreux sont mes collègues qui ne reçoivent aucune aide ou très insuffisante. En ce qui me concerne, dans la mesure où j’ai cherché à explorer des thèmes liés à mon mandat, qui n’avaient pas été jusqu’alors étudiés et à mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail, j’ai dû trouver de l’aide à l’extérieur du HCDH, auprès de collègues universitaires, d’étudiants, ainsi que d’autres personnes prêtes à travailler bénévolement, n’ayant aucun budget pour recruter. Trouver ces personnes, sans soutien administratif, est déjà un travail en soi. Autant que faire se peut, j’ai cherché à être la plus indépendante possible du HCDH, afin d’analyser très librement, sur le plan conceptuel, les thèmes qui me tenaient à cœur. Dans d’autres cas, l’indépendance m’a été plus ou moins imposée dans la mesure où les Nations unies n’ont pas ou insuffisamment soutenu mon travail, telle mon enquête sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
LES PROCÉDURES SPÉCIALES REPRÉSENTENT SOUVENT UN MÉCANISME DE DERNIER RECOURS POUR LES VICTIMES
Un aspect important de mon mandat, largement grâce à l’apport de mon équipe au OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights), est de répondre aux demandes d’intervention en lien avec des allégations d’exécutions arbitraires, par l’obtention d’éclaircissements auprès des gouvernements sur des violations présumées et, si nécessaire, par la demande d’adoption des mesures de protection appropriées. En tant que rapporteure spéciale, je peux réagir rapidement à des violations présumées des droits humains (dans mon cas le droit à la vie), quels que soient le moment et l’endroit du monde où elles se produisent. Les procédures spéciales représentent souvent un mécanisme de dernier recours pour les victimes. Nos méthodes de travail sont relativement agiles, elles ne prévoient pas de procédures très complexes. On arrive parfois à empêcher de graves violations, et même à sauver des vies, notamment à travers des appels urgents adressés aux États. J’essaie également de sensibiliser le public à certaines situations ou phénomènes, notamment les menaces qui pèsent sur la protection contre les exécutions arbitraires. Si les circonstances le justifient, je partage mes préoccupations publiquement par le biais de communiqués de presse ou de déclarations dans les médias. Je peux également effectuer des missions d’enquête dans les pays, sur invitation des gouvernements, pour évaluer les situations des droits humains qui relèvent de mon mandat, et formuler par la suite des recommandations afin de les améliorer.
Chaque année, je présente deux rapports thématiques, au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale, dans lesquels je cherche à identifier les causes profondes ainsi que les tendances générales en lien avec les exécutions arbitraires, mais aussi à mettre en évidence les bonnes pratiques et enfin, à élaborer des recommandations. Ces rapports annuels constituent une source importante et une base de référence afin d’encourager le développement progressif du droit international. Ils apportent des indications de nature législative, politique et opérationnelle sur des problèmes concrets qui permettent de guider le travail des acteurs concernés, tant au niveau gouvernemental qu’au niveau des acteurs non étatiques. Ces rapports sont rendus publics et peuvent être consulter sur le site du OHCHR.
CERTAINS GOUVERNEMENTS VONT MÊME JUSQU’À PORTER PLAINTE AUPRÈS DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, M’ACCUSANT DE VIOLER LES TERMES DE MON MANDAT
L’objectif principal est d’influencer les pratiques des États et d’autres acteurs comme les Nations unies, le Conseil de sécurité, les groupes du secteur privé et la société civile. Des relations de coopération et un dialogue constructif avec les gouvernements sont essentiels afin de remplir pleinement et efficacement mon mandat. En pratique, cela ne fonctionne pas avec tous. Certains gouvernements rejettent mes allégations ou conclusions de façon très agressive, sans chercher à apporter les preuves de leurs dénégations. Certains vont même jusqu’à porter plainte auprès du Conseil des droits de l’homme, m’accusant de violer les termes de mon mandat ou les codes de bonne conduite inhérents à ma nomination. Aucune de ces plaintes n’a abouti. En réponse à la dernière en date, le Comité de coordination des procédures spéciales a conclu que « la lettre présentée par ce groupe d’États ne satisfait à aucune des normes identifiées par le Comité, et soulève des soupçons importants de représailles en réaction aux travaux de fond de la Rapporteuse, avec lesquels les signataires peuvent être en désaccord mais qu’ils n’ont pas réfutés par d’autres moyens. Le Comité note également que certains États du groupe ont lancé des menaces et des attaques contre les Rapporteur-e-s. »
Vous avez lancé une enquête sur l’assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, journalistes de RFI, au Mali en 2013, ainsi qu’une enquête sur l’assassinat
du journaliste Jamal Khashoggi, collaborateur du Washington Post, à Istanbul
en 2018. Disposez-vous de moyens spécifiques afin d’élucider ces crimes politiques ?
Je ne dispose d’aucun moyen spécifique pour de telles enquêtes. En règle générale, les rapporteurs spéciaux agissent sur des cas individuels de violations et sur la base des critères énoncés dans le code de conduite des procédures spéciales, notamment la fiabilité de la source et la crédibilité des informations reçues. Mais il ne s’agit pas d’une enquête à proprement parler. Basées sur les informations reçues, nos communications allèguent des violations, requièrent des informations et des témoignages et, si nécessaire, demandent aux États de prendre des mesures de prévention ou d’investigation.
S’il est vrai que le Conseil des droits de l’homme a exhorté à maintes reprises tous les États à coopérer avec les procédures spéciales, aucun instrument juridique ne contraint ces États ni à coopérer ni à suivre ses recommandations. Souvent, les États ne répondent pas ou ils se limitent à donner des réponses standards qui n’abordent pas le fond des allégations.
Cette situation m’a menée à décupler mes efforts afin d’obtenir les éléments de preuve irréfutables en ce qui concerne la responsabilité des États ou d’autres acteurs. J’ai ainsi mis en œuvre une nouvelle méthodologie de travail qui consiste à enquêter à proprement parler sur des cas individuels ou spécifiques de violations, afin d’obtenir des éléments de preuves, de tenter de contribuer à la recherche de justice, mais aussi d’extraire des leçons et des recommandations d’ordre général. Le cadre juridique de mes enquêtes est double : en premier lieu, je suis une méthode d’enquête propre au droit international des droits humains, qui cherche à établir les responsabilités des États. En second lieu, je m’inspire aussi des méthodes d’enquête en lien avec le droit criminel qui cherche à établir les responsabilités individuelles. Plus précisément, il m’a semblé que l’absence d’enquêtes sérieuses sur les meurtres commis contre les journalistes et les défenseurs des droits humains encourageait le régime d’impunité qui sévit dans de nombreux pays. J’ai donc décidé de mener des enquêtes pendant plusieurs mois sur les meurtres ou tentatives de meurtre – Jamal Khashoggi, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, Christopher Allen, Halla et Orouba Barakat, Alexei Navalny. J’ai aussi enquêté sur le meurtre ciblé du général iranien Soleimani, sur le meurtre en détention de l’ex-président égyptien Morsi et sur l’attaque iranienne contre le vol ukrainien PS 752.
L’ABSENCE D’ENQUÊTES SÉRIEUSES SUR LES MEURTRES COMMIS CONTRE LES JOURNALISTES ET LES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS ENCOURAGEAIT LE RÉGIME D’IMPUNITÉ QUI SÉVIT DANS DE NOMBREUX PAYS
Ces initiatives n’ont bénéficié d’aucun support institutionnel des Nations unies. En fait, elles peuvent même être l’objet d’obstacles de type administratif, logistique et financier, voire de messages ambigus remettant en cause la décision et le bien-fondé de procéder à une enquête. Pourtant, de telles enquêtes sont importantes car elles ont permis de mettre en lumière non seulement les responsabilités étatiques et individuelles, mais aussi les problèmes de nature structurelle et systémique, qui demandent des réponses énergiques, y compris de la communauté internationale. Par exemple, l’enquête sur le meurtre de Jamal Khashoggi a révélé l’absence de mécanismes internationaux permettant de traiter les cas individuels de graves violations. Celle sur le vol ukrainien a mis évidence les grandes faiblesses du système international pour la protection des vols civils en zone de guerre.
Selon la plateforme du Conseil de l’Europe pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes, la France est désormais classée parmi les « pays à suivre » aux côtés de l’Albanie, la Bulgarie, la Russie, la Hongrie, la Pologne, la Serbie, Malte…
La liberté d’informer est-elle menacée en France ? En Europe ?
Beaucoup a déjà été dit et écrit sur la portée liberticide de la loi sur la « sécurité globale » mais aussi au sujet de la loi sur le séparatisme. Il n’y a aucun doute que l’adoption et l’application de ces lois entraîneront des atteintes importantes aux droits humains et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, la liberté de circulation, la liberté d’expression et la liberté d’association et de réunion pacifique, la liberté de religion, le droit au travail, le droit à l’éducation et le droit à la vie privée et familiale.
EN FRANCE, L’USAGE DES DRONES AVEC CAMÉRAS A SOULEVÉ DE NOMBREUX AVIS NÉGATIFS
La loi, qui a pour objectif de garantir une « sécurité globale », vise à « savoir être inventif et innovant afin de renforcer le continuum de sécurité, tout en respectant pleinement les identités et les missions de chacun des acteurs qui y contribuent. Elle vise aussi à doter chacun d’entre eux des moyens et des ressources pour assurer plus efficacement et plus simplement les missions qui leur sont confiées ». La loi traite notamment de la question du recours à de nouveaux moyens technologiques par les forces de l’ordre et de l’interdiction de recours par les citoyens.
La proposition de loi crée un cadre juridique de captation d’images par des moyens aéroportés, en l’occurrence, via l’utilisation de drones équipés de caméras. L’article 22 de la proposition de loi établit que les forces de l’ordre peuvent procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images, au moyen de caméras installées sur des drones.
Sur la base des standards internationaux des droits humains, l’usage de drones avec caméras soulève de nombreuses préoccupations. Tout d’abord, il s’agit d’une méthode particulièrement intrusive, qui pourrait dissuader ceux et celles qui souhaiteraient participer à des réunions pacifiques. De plus, les forces de sécurité seront en mesure de collecter de façon massive et indistincte des données à caractère personnel, sans aucun garde-fou de protection de ces données, approprié à de telles activités. La France a souscrit à la réglementation prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD) sur la protection des données personnelles. Mais encore faut-il que cette réglementation soit parfaitement adaptée aux circonstances prévues par l’article 22, et pour le moment, elle ne l’est pas. Non seulement les données collectées par les drones pourraient permettre de ficher les manifestants selon leurs opinions politiques alléguées, mais de plus ces informations pourraient être tout à fait erronées, en lien avec les personnes et agissements autour d’eux.
Les lignes directrices de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de la Commission de Venise sur la liberté de réunion pacifique précisent que « les images numériques des organisateurs et des participants à une manifestation ne doivent pas être enregistrées, sauf lorsque cela est spécifiquement autorisé par la loi et nécessaire dans les cas où il y a des raisons probables de croire que les organisateurs ou les participants se livreront à une activité illégale grave. »1 L’utilisation de l’enregistrement d’images à des fins d’identification, y compris au moyen de logiciels de reconnaissance faciale doit être limitée à des circonstances bien spécifiques : les infractions pénales qui sont effectivement commises ou pour lesquelles il existe un soupçon raisonnable de comportement criminel imminent. En aucun cas, ces enregistrements ne devraient devenir une routine policière comme une autre.
En France, l’usage des drones avec caméras a soulevé de nombreux avis négatifs : le juge des référés du Conseil d’État a ainsi jugé qu’il n’était pas possible, en l’absence de disposition législative ou réglementaire, de recourir à des drones pour s’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur lors de la période de déconfinement ou pour surveiller les manifestations sur la voie publique2. La Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a, quant à elle, sanctionné le ministère de l’intérieur pour avoir utilisé de manière illicite des drones équipés de caméras, et lui a enjoint de ne recourir à la captation de données à caractère personnel à partir de drones que si un cadre normatif autorisant la mise en œuvre de tels traitements était adopté3.
Dans ses recommandations, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, sur la surveillance et les droits humains, a émis de sérieuses réserves quant à la technologie de reconnaissance faciale concernant la liberté d’expression. Il a recommandé aux États « d’imposer un moratoire immédiat sur l’exportation, la vente, le transfert, l’utilisation et la maintenance des technologies de surveillance conçues par le secteur privé, et de ne le lever uniquement lorsqu’un régime de garanties conformes aux droits de l’homme aura été établi ». En tant que rapporteure spéciale, j’ai soutenu ce moratoire à la suite de mon travail sur l’usage des technologies de surveillance par l’Arabie saoudite.
L’article 24 de la loi sur la « sécurité globale » prohibe « l’usage malveillant » de l’image des policiers nationaux et militaires de la gendarmerie en intervention. Cet article prévoit, spécifiquement, qu’« est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police ».
COMME L’A FAIT REMARQUER LE CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME, LE JOURNALISME EST UNE FONCTION PARTAGÉE PAR UN LARGE ÉVENTAIL D’ACTEURS
Il n’est pas inopportun de rappeler de nouveau le rôle primordial joué par la liberté d’expression et d’information, et la liberté de la presse au sein de nos démocraties : la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Elle s’applique autant aux « informations » ou aux « idées » accueillies favorablement qu’à celles qui choquent ou dérangent…
AFIN D’ÊTRE CONFORME AU DROIT INTERNATIONAL, TOUTE RESTRICTION À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET D’INFORMATION DOIT POURSUIVRE UN OBJECTIF LÉGITIME
La libre circulation, au-delà des frontières, d’informations et d’idées sur des questions publiques et politiques est indispensable au bon fonctionnement des sociétés et implique une presse libre capable de commenter des questions publiques sans censure ni retenue et d’informer l’opinion publique. Non seulement la presse a pour tâche de diffuser ces informations et ces idées mais le public a également le droit de les recevoir. S’il en était autrement, la presse serait incapable de jouer son rôle vital de « chien de garde public »4.
À l’ère du numérique, certaines de ces fonctions sont partagées avec d’autres acteurs, y compris avec les citoyens qui informent les autres par le biais des médias sociaux. Comme l’a fait remarquer le Conseil des droits de l’homme, le journalisme est une fonction partagée par un large éventail d’acteurs, qui comprend des journalistes professionnels à plein-temps, mais aussi des blogueurs et autres acteurs qui s’engagent dans des formes d’autopublication dans la presse écrite, sur internet ou ailleurs. La liberté d’informer se conçoit avec certaines limitations mais celles-ci sont régies par le droit et la jurisprudence.
Afin d’être conforme au droit international, toute restriction à la liberté d’expression et d’information doit poursuivre un objectif légitime : être prévue par la loi, et être nécessaire et proportionnée à l’objectif légitime identifié. En pratique, cela signifie que les restrictions doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger. L’article 24 de la loi sur la sécurité globale viole ce dernier critère en particulier.
LES INFORMATIONS VÉHICULÉES SUR L’UN DES ASPECTS LES PLUS IMPORTANTS DE NOTRE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE, CELUI DE L’USAGE DE LA FORCE, SONT INDISPENSABLES À SON BON FONCTIONNEMENT
Les membres des forces de l’ordre sont déjà protégés par le RGPD, comme tous les citoyens, contre l’utilisation ou la réutilisation d’enregistrements aux seules fins de nuire. Une loi de plus ne peut se justifier. En revanche, les abus de pouvoir qu’entraînerait l’adoption de l’article 24 est une certitude : cela se traduirait par les arrestations arbitraires de ceux et celles qui filment les interventions policières, l’instauration d’un climat d’autocensure et de peur, et l’augmentation des violences policières. Les risques à moyen et long terme que ces lois font peser sur notre démocratie et notre société ne doivent pas être minimisés.
L’information du public et la publication d’images ou d’enregistrements relatifs à des interventions de police sont non seulement essentielles au respect du droit à l’information, mais elles sont en outre légitimes dans le cadre du contrôle démocratique des institutions publiques. Nous en avons eu la preuve tout au long de l’année 2020, des États-Unis à la France, de la Russie aux Philippines en passant par l’Inde.
Les informations véhiculées sur l’un des aspects les plus importants de notre société démocratique, celui de l’usage de la force, sont indispensables à son bon fonctionnement. Lorsque des personnes en uniforme deviennent des tueurs en uniforme, et que l’uniforme leur confère l’impunité, c’est l’ensemble des principes de gouvernance, des relations entre gouvernés et gouvernants qui est mis en danger. Si des vidéos citoyennes permettent de prouver l’utilisation excessive ou létale de la force, d’en amener les responsables devant les juges : c’est l’ensemble de la société qui doit s’en réjouir. N’oublions pas qu’à travers le monde, comme au cours de l’Histoire, les violations des forces de l’ordre et l’impunité constituent la plus grande menace pour le fonctionnement de nos sociétés démocratiques.
SANS CES VIDÉOS, SOUVENT CITOYENNES, DE VIOLENCES POLICIÈRES, LE RÉGIME D’IMPUNITÉ SOUVENT DÉJÀ EN PLACE EN RAISON D’INSTITUTIONS FAIBLES OU MÊME CORROMPUES SERAIT D’AUTANT PLUS RENFORCÉ PAR LE SILENCE ET PAR LA PEUR
Sans ces vidéos, souvent citoyennes, de violences policières, le régime d’impunité souvent déjà en place en raison d’institutions faibles ou même corrompues serait d’autant plus renforcé par le silence et par la peur. Sans ces vidéos, les faiblesses inhérentes aux institutions censées surveiller la Police et s’assurer que l’État respecte la loi seraient cachées, camouflées, et nos sociétés d’autant plus fragilisées.
80 ans après la Seconde Guerre mondiale – le gouvernement de Vichy et sa complicité active dans la mise en œuvre de l’Holocauste –, ces lois s’inscrivent dans une époque caractérisée par la présidence de Donald Trump, l’attaque du Parlement américain le 6 janvier 2021, les violations répétées de la Pologne et de la Hongrie contre les valeurs européennes inscrites, entre autres, dans la Convention européenne des droits de l’homme. Les idéologies du populisme, en France et ailleurs, offrent des réponses simplistes, souvent fondées sur la désignation de boucs émissaires, à des problèmes de société complexes. La loi sur la « sécurité globale » tout comme celle sur le « séparatisme » s’inscrivent dans un contexte, en France et dans le monde, caractérisé par un rétrécissement de l’espace civique, des violations répétées du droit de manifester, en particulier par le biais de pouvoirs accrus donnés aux forces de l’ordre, par la normalisation de pouvoirs exceptionnels attribués à l’État et encore aux forces de l’ordre, et par l’usage croissant de la violence dite « légitime » de l’État comme moyen de pacification sociale.
J’aime à rappeler les propos de Pierre-Henri Teitgen en 1949, lors des débats sur la création des institutions européennes : « Les démocraties ne deviennent pas nazies en un jour. Le mal progresse sournoisement, avec une minorité opérant, pour ainsi dire, pour supprimer les leviers de contrôle. Une par une, les libertés sont supprimées dans une sphère après l’autre. L’opinion publique et toute la conscience nationale sont asphyxiées. Et puis, quand tout est en ordre, le Führer est installé et l’évolution se poursuit même jusqu’au four du crématorium… ». Il en appelait à l’époque à « une conscience qui doit exister quelque part, qui sonnera l’alarme dans l’esprit d’une nation menacée par cette corruption progressive ». Pour lui, « une Cour internationale et un système de supervision et de garanties pourraient être la conscience dont nous avons tous besoin ». Nous ne sommes pas immunisés contre le mal sournois dont parle le juriste et homme politique Teitgen.
Qu’enseignez-vous aux étudiants qui suivent vos cours sur la liberté de la presse et la liberté d’expression à l’université Columbia, lorsqu’il s’agit des médias sociaux ?
Mes cours mettent en avant les diverses dimensions de ce monde en ligne. La première considération tient à la nature exceptionnelle de la technologie et de ce nouvel écosystème du cyberespace. L’internet, les médias sociaux et les moteurs de recherche ont créé d’énormes opportunités pour la réalisation de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui envisageait un monde où le droit de rechercher, d’obtenir et de répandre des informations et des idées devait s’exercer indépendamment des frontières. La révolution de notre écosystème de l’information ne tient pas seulement au nombre de personnes impliquées, aux informations accessibles par-delà les frontières et à leur vitesse de circulation, mais au fait que 4,7 milliards de personnes en ligne ne sont pas seulement des consommateurs d’information, mais aussi potentiellement des producteurs d’information, notamment de vidéos, de films, de programmes de radio, d’opinions écrites et d’actualités.
Deuxièmement, il va sans dire que la régulation de cet écosystème pose des défis spécifiques, liés aux qualités transfrontalières d’internet et du cyber-contenu, de leurs capacités à nier ou remettre en cause la géographie physique et politique5, au rôle des grandes entreprises multinationales qui sont largement à l’origine du développement actuel du monde numérique, et, paradoxalement, à la centralité de la souveraineté nationale et des juridictions nationales.
L’INTERNET A PROVOQUÉ DES TEMPÊTES NORMATIVES
Ainsi que nous en avons fait état dans l’ouvrage que, Lee Bollinger et moi-même, nous venons de codiriger6, la vitesse, la croissance et la nature transfrontière du discours en ligne auraient pu inciter les gouvernements à convenir de normes communes ; or c’est l’inverse qui s’est produit. L’internet a provoqué des tempêtes normatives, dont la résolution est rendue d’autant plus compliquée que de nouvelles sources de normes sont apparues : les grands fournisseurs de services internet, principalement américains, alimentant le monde en ligne ; les nouvelles formes ou langage de normes, à savoir les algorithmes, les codes, l’intelligence artificielle (IA), le machine learning, qui ont également pris un caractère normatif global.
L’avènement du monde numérique a apporté de nouveaux instruments de codification, y compris la codification de la parole et des comportements, qui ont remis en question l’idée de ce que constitue un système juridique et normatif. Lawrence Lessig a bien saisi les particularités juridiques du cyberespace lorsqu’il a inventé le principe désormais célèbre selon lequel « le code est la loi », sous-tendant ainsi que les instructions (obscures, non transparentes) intégrées dans le logiciel et le matériel qui composent le cyberespace, le réglementent également. Les codes et les algorithmes incarnent des valeurs et cherchent à être « la loi ». Mais ces valeurs sont exprimées dans un langage, un mode de transmission mathématique, qui complique beaucoup le dialogue normatif « traditionnel » et augmente sensiblement le risque de conflits normatifs. Et ce d’autant que l’espace en ligne n’est plus « seulement » un espace d’expression. C’est l’espace économique, politique, social et culturel du XXIe siècle, et de plus en plus fréquemment l’espace où se déroulent les guerres, où la sécurité et les intérêts nationaux sont avancés ou protégés. C’est un espace de contestation, de confrontation et de domination.
AU COURS DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES, NOUS AVONS ASSISTÉ À UN CHANGEMENT REMARQUABLE DANS LA CULTURE AMÉRICAINE DU PREMIER AMENDEMENT
Il est important de rappeler que les difficultés inhérentes à l’intégration de la cascade de normes mondiales liées à la liberté d’expression ont été aggravées au début du XXIe siècle, par le 11 septembre et ses effets dominos, en particulier l’introduction et la normalisation de lois et de politiques contre l’insécurité et « contre le terrorisme ».
NOUS NE DEVONS PAS NOUS LAISSER TROMPER PAR LA NATURE APPAREMMENT CHAOTIQUE, SPONTANÉE ET INDISCIPLINÉE DU MONDE NUMÉRIQUE
La troisième caractéristique de notre environnement est son instabilité. Nous assistons depuis plusieurs années à diverses tentatives pour réguler le contenu en ligne, provenant de gouvernements, institutions régionales, entreprises, utilisateurs eux-mêmes, etc. Nous sommes à la recherche d’institutions, de mécanismes et de normes appropriées à ce nouvel espace, mais aucune pour le moment ne s’est suffisamment « cristallisée », permettant de construire un véritable écosystème réglementaire. La technologie elle-même continue d’évoluer très rapidement, tout comme les comportements en ligne, ceci dans un contexte de reconfiguration des relations internationales, avec le rôle grandissant de la Chine en tant que superpuissance.
Partout dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis, ces dernières années ont démontré que les principes et le fonctionnement d’un « libre marché des idées », de « plus de discours comme meilleurs antidotes » et de « contre-discours » ne sont pas adaptés à un écosystème numérique qui fonctionne en grande partie comme une chambre d’écho, validant la vision du monde des utilisateurs, tout en excluant et en bloquant toute information ou nouvelle qui remettrait en question une telle vision7. Comment encourager alors les gens à ouvrir leur monde cyber à d’autres perspectives ?
Même avec la tradition américaine du Premier amendement, l’opposition à la réglementation de l’expression s’est érodée. Ceux et celles qui ont traditionnellement défendu l’approche américaine de la liberté d’expression ont été confrontés à la présidence Trump, à ses attaques et mensonges quotidiens, véhiculés à grande échelle par les médias sociaux et quelques médias traditionnels. En effet, s’il existe clairement des désaccords sur les décisions de Facebook et Twitter d’interdire définitivement l’ancien président sur leurs plateformes, il est remarquable de voir à quel point ces décisions ont également reçu une large approbation aux États-Unis.
Au cours des quatre dernières années, nous avons assisté à un changement remarquable dans la culture américaine du Premier amendement, avec une convergence beaucoup plus grande vers par exemple la position européenne sur la liberté d’expression. Il semble que l’avis dominant selon lequel les États-Unis devraient tolérer des vues cherchant à saper les fondements politiques de la démocratie américaine a pris un coup dur ; qu’une telle vision était en quelque sorte fondée sur la notion d’une démocratie américaine forte, capable de répondre aux attaques contre ses valeurs fondamentales à travers le libre marché des idées. Mais quatre ans de présidence Trump, et ces convictions ont été largement érodées. En effet, censurer certains discours politiques ou empêcher au moins leur large diffusion et leur amplification semble maintenant avoir pris une urgence beaucoup plus existentialiste, et donc tolérable et justifiable. Il sera très intéressant de voir comment ces considérations évolueront dans un environnement politique différent, comment elles se traduiront aux niveaux juridique, réglementaire et politique, comment elles pourraient transformer les règles internes des plateformes de médias sociaux.
LE DÉFERLEMENT DE HAINE CONTRE LES ROHINGYAS VIA FACEBOOK NE RÉSULTAIT PAS DE FAILLES STRUCTURELLES D’INTERNET, IMPULSÉES PAR LE GRAND PUBLIC ET LES BOTS
Finalement, je me fais un devoir de rappeler à mes étudiants que nous ne devons pas nous laisser tromper par la nature apparemment chaotique, spontanée et indisciplinée du monde numérique. Il y a là aussi des dirigeants, des mouvements organisés et donc des responsabilités à définir et à rechercher.
Prenons l’exemple contemporain de crimes contre l’humanité et de génocides, alimentés par les médias sociaux, tel celui des Rohingyas au Myanmar : les recherches approfondies ont montré que le déferlement de haine contre les Rohingyas via Facebook ne résultait pas de failles structurelles d’internet, impulsées par le grand public et les bots. La large diffusion de désinformations n’était pas organique : elle était planifiée et organisée. Une enquête du New York Times a révélé que la propagation de la haine était le résultat d’une exploitation systématique et secrète par l’armée du Myanmar qui a créé de nombreux comptes sur Facebook afin d’inonder la plateforme de propagande haineuse et de désinformation8. Quant à la Mission d’enquête indépendante (FFM) au Myanmar, commanditée par l’ONU, elle a mis en lumière le fait que la réponse de Facebook à l’utilisation abusive de sa plateforme pour répandre la haine avait été « lente et inefficace », et avait donc probablement accru la discrimination et la violence.9
LE CYBERESPACE DEMANDE DONC QUE L’ON COMPRENNE À LA FOIS SON FONCTIONNEMENT INHÉRENT ET PROPRE À LA TECHNOLOGIE MAIS AUSSI LE MILIEU PHYSIQUE ET BIEN RÉEL DANS LEQUEL IL OPÈRE
Nous savons grâce aux recherches menées sur les effets de la propagande que les tueurs ne sont pas des guerriers « idéologiques » fanatiques, mais qu’ils sont au contraire des « gens ordinaires », peut-être « passifs, indifférents »10. L’assimilation des croyances, y compris celles liées à la haine et aux peurs, dépend de l’influence, souvent exercée en ligne, de personnes ayant une autorité morale tels que les dirigeants politiques, présidents et ministres, les intellectuels, les leaders religieux et communautaires. Il existe bien des « leaders de la haine dans le monde virtuel », qui sont aussi et tout d’abord des leaders dans le monde physique.
REPENSER LA NOTION DE TERRITOIRE, EN VUE DE DÉFINIR ET D’INCORPORER CELLE DU TERRITOIRE NUMÉRIQUE ET DES FRONTIÈRES NUMÉRIQUES
Ces entrepreneurs de la haine et de la polarisation déshumanisent et construisent des menaces, affirmant l’existence d’ennemis cachés, sonnant l’alarme sur la survie et l’avenir. Ils utilisent les effets de désinhibition et de chambre d’écho d’internet afin de mener des campagnes fondées sur des rumeurs, des mensonges et des fausses solutions. Nous avons bien affaire à des individus, utilisant la technologie à des fins allant de l’opportunisme politique à la diffusion de discours et d’idéologies menant aux pires crimes11.
Le cyberespace demande donc que l’on comprenne à la fois son fonctionnement inhérent et propre à la technologie mais aussi le milieu physique et bien réel dans lequel il opère. L’une des pistes de gouvernance du cyberespace à explorer est celui du droit international. Il faut s’orienter, selon moi, vers une refonte du droit international afin de pouvoir attribuer aux entreprises qui alimentent l’internet des obligations en matière de droits humains, différentes de celles des États, une approche intermédiaire pouvant être l’établissement de mécanismes d’autorégulation significatifs et efficaces.
Le développement d’un cadre juridique international approprié et pertinent pour l’espace en ligne est particulièrement nécessaire12. Même si le contexte international ne se prête pas à de tels développements concrets, il ne devrait pas nous empêcher de réfléchir à ce qui serait nécessaire pour fonder un cadre juridique international, pertinent pour l’espace en ligne et la protection des droits humains en ligne. Cela demande de repenser la notion de territoire, en vue de définir et d’incorporer celle du territoire numérique et des frontières numériques, et d’identifier les implications juridiques internationales et le contenu de ces concepts. Un tel processus exigera sans aucun doute de repenser les sources du droit, afin d’y ajouter les normes créées par l’industrie. Cela nécessitera, aussi et surtout, une meilleure appréciation du fonctionnement du monde et de la société mondiale du XXIe siècle, qui demande entre autres que les acteurs non étatiques tels que les plateformes numériques soient vus et compris comme des sujets « spécifiques » du droit international, avec des droits et des devoirs spécifiques.
Sources :
- BIDDH/OSCE & Commission européenne pour la démocratie par le droit,
lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique. - Ordonnance du 18 mai 2020, req. n°440442, 440445 et décision du 20 décembre 2020, req. n°446155.
- Délibération n° 2021-011 du 26 janvier 2021 portant avis sur une proposition de loi relative à la sécurité globale https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/d-2021-011_pplsecu.pdf
- Ct. H.R. Case of Observer and Guardian v. the United Kingdom, Application no. 13585/88, para. 58, November 26, 1991.
- Daniel Bethlehem, The End of Geography : The Changing Nature of the International System and the Challenge to International Law, The European Journal of International Law, vol. 25, no°1, 2014.
- Agnès Callamard, Regardless of Frontiers ? Global Freedom of Expression in a Troubled World, in Lee C. Bollinger and Agnès Callamard, Regardless of Frontiers : Global Freedom of Expression in a Troubled World, Columbia University Press, 2021, p.13-15.
- Agnès Callamard, « Are Courts re-inventing Internet Governance », International Review of Law, Computers and Technology, 23 March 2017 ; Agnès Callamard, « The Control of « Invasive » Ideas in a Digital Age », Social Research : An International Quarterly (Johns Hopkins University Press) 84 (1) : 119-145, 2017.
- A Genocide Incited on Facebook, With Posts From Myanmar’s Military https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
- Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, report released on 18 September 2018. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx
- Jonathan Leader Maynard Rethinking the Role of Ideology in Mass Atrocities,
Terrorism and Political Violence 26/5 (2014) : 821-841 - « Challenging Truth and Trust : A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation », http://comprop.oii.ox.ac.uk/research/cybertroops2018/
- Agnès Callamard, « Caught between a rock and a hard place : human rights protection in the digital world », in Human Rights in the Age of Platforms, edited by Rikke Frank Jorgenssen, MIT, 2019.