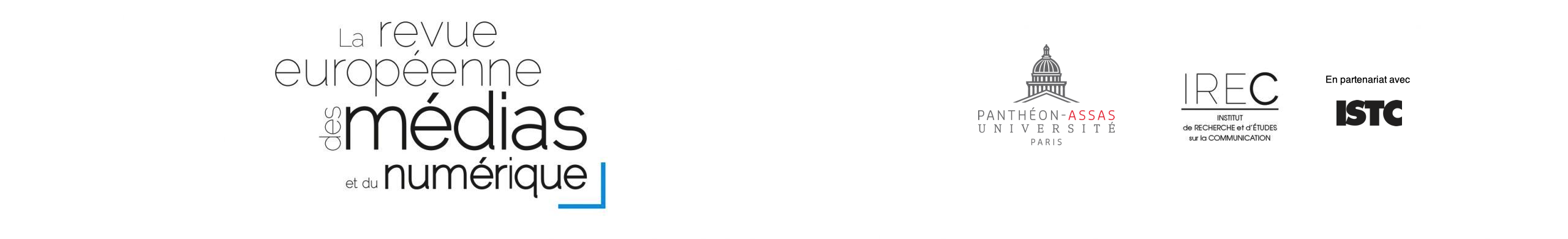Note sous CAA Paris, 1re ch., 27 mars 2023, n° 21PA00815.
Les réseaux sociaux constituent une formidable opportunité de communication pour les institutions publiques. Comme l’a relevé le Conseil d’État dans son rapport consacré à ce sujet (voir La rem n°63, p.86), les réseaux sociaux pourraient permettre de rééquilibrer les forces au profit de l’utilisateur et du citoyen1. En effet, une communication plus directe et plus souple peut être établie, via ces services, entre les administrés et l’Administration, loin des procédés traditionnels. C’est pourquoi de nombreuses administrations disposent déjà de leur propre compte sur les réseaux utilisés par une grande partie du public, à commencer par Twitter, pour y publier toutes sortes d’informations, telles que des décisions ou des explications de leur activité. Les récents épisodes de manifestations contre la réforme des retraites en attestent parfaitement. Les préfectures des départements ayant édicté des arrêtés antimanifestations, plus poétiquement qualifiés d’« anticasserolades », ont ainsi pu publier ces actes directement sur le réseau social. Elles ont pu y être interpellées par des opposants, et surtout par des juristes, professeurs de droit2 et avocats3, contestant la légalité de ces arrêtés. Ceux-ci y ont eux-mêmes tenu un fil d’actualité sur les recours exercés devant les tribunaux administratifs pour les faire annuler.
Si la prudence est de mise, il est indéniable que ces publications constituent un moyen renouvelé de garantir une certaine transparence, cet accès plus direct à l’information contribuant à l’objectif poursuivi par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La page Facebook d’une commune a ainsi été considérée comme un bulletin d’information générale au sens du Code général des collectivités territoriales, le maire devant alors y garantir un espace d’expression ouvert aux élus de l’opposition4. Aussi est-il logique que ces comptes soient les plus accessibles possible.
Cet intérêt a également fait l’objet d’une importante jurisprudence aux États-Unis. On rappellera que la Cour suprême a considéré, dans une décision phare de 20175, que les réseaux sociaux constituaient de nouvelles « places publiques » où tout citoyen doit pouvoir venir s’informer sur toutes sortes de sujets le plus librement possible, au nom du premier amendement de la Constitution (voir La rem n°44, p.62). De la même façon, la cour du district Sud de New York a affirmé que le président des États-Unis, alors Donald Trump, ne pouvait « bloquer » aucun de ses followers sur Twitter, son compte étant officiellement celui d’une institution publique6. Tout citoyen peut donc consulter, commenter et critiquer les informations qui y sont publiées.
Cela implique préalablement de savoir si l’usage d’un réseau social par une administration peut engager celle-ci vis-à-vis des administrés. Ces espaces d’expression étant fournis par des entreprises privées, et non des services publics à proprement parler, leur usage par des institutions est-il susceptible d’être en lui-même la source d’actes administratifs ? Si tel est le cas, dans quelle mesure celles-ci peuvent restreindre l’accès de certains utilisateurs à leurs publications ?
Telles étaient les questions posées à la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt édifiant du 27 mars 2023. Les faits trouvent leur source dans plusieurs publications effectuées sur le compte Twitter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), établissement public administratif. En commentaire, un membre de la Cimade y avait interpellé directement l’établissement pour dénoncer la lenteur de ses procédures et le manque de moyens humains qui lui sont alloués. Prétextant un risque de sécurité pour ses agents, l’Ofii a alors bloqué le compte de cette personne, qui ne pouvait plus accéder aux publications de l’établissement, ni les partager et les commenter. Le requérant a alors saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de cette décision de blocage. Sa demande ayant été rejetée, il fit appel devant la cour administrative.
Celle-ci a estimé que le blocage d’un utilisateur sur le compte d’une administration constituait une décision faisant grief. En l’espèce, elle entraînait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et d’information du requérant. Ce faisant, la Cour conforte l’accès des citoyens aux données publiques via les réseaux sociaux, lequel contribue au droit du public à l’information et à la liberté de critique sur des questions d’intérêt général.
L’accès à des données publiques facilité par les réseaux sociaux
L’Ofii contestait la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige, en faisant valoir le caractère privé des conditions d’utilisation du réseau social, lesquelles ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun. Le requérant invoquait pour sa part les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration, en particulier pour ce qui concerne le droit d’accès et le droit de réutilisation des documents administratifs.
L’argument ne manquait pas d’originalité en dépit de la forme et du procédé de mise à disposition des données publiques en cause. Encore faut-il établir que ces informations participent des activités de service public de l’Ofii. Sur ce point, on rappellera que la Commission d’accès aux documents administratifs a elle-même affirmé que le régime de réutilisation des données publiques, tel qu’il découle du code précité, n’investit pas les autorités administratives d’une mission de service public, mais leur impose seulement des obligations légales assorties de la faculté de valoriser ces informations7. Le seul « service public de la donnée » existant ne concerne que les données de référence et fut créé par l’article 14 de la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique. Pour autant, la précision ne concerne que le régime de réutilisation des données à d’autres fins que la mission de service public pour laquelle celles-ci ont été produites.
En l’espèce, la Cour constate que la politique de communication de l’Ofii sur Twitter consiste notamment en la « publication d’informations sur son activité et la réponse aux questions et commentaires des utilisateurs du réseau social », ce qui relève bien de ses missions de service public. Quand bien même il ne s’agirait pas de la mission principale, la diffusion d’informations relatives au fonctionnement d’un établissement public ne peut être considérée autrement, qu’elle soit diffusée par un réseau social ou par un autre moyen. Aussi la Cour confirme-t-elle la compétence de la juridiction administrative, estimant que le blocage effectué est une décision faisant grief.
En effet, le droit d’accès aux documents administratifs constitue une garantie fondamentale reconnue aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, au sens de l’article 34 de la Constitution8. Tel est le cas avec la liberté d’expression et d’information9, le droit d’accès ne pouvant alors subir que des restrictions prévues par la loi, strictement proportionnées et poursuivant un but légitime10.
Du droit d’accès aux données publiques au droit à l’information
En soi, le droit d’accès aux données publiques participe du droit du public à l’information, qui est un élément de la liberté d’expression. On sait l’importance accordée à l’exercice de cette liberté lorsque sont en cause des institutions ou des personnalités publiques, comme l’a fréquemment rappelé la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci n’a pas manqué de souligner l’intérêt que représentent les services de communication en ligne11, et particulièrement les réseaux sociaux, jusqu’à des actes aussi anodins que l’usage du bouton « like » de Facebook12.
Il était donc logique que le requérant se fonde principalement sur cette liberté pour contester la mesure de blocage dont il faisait l’objet. La cour administrative d’appel de Paris affirme très pertinemment qu’une administration qui fait le choix, dans le cadre de ses missions de service public, de publier des informations relatives à celles-ci et de prendre part au débat public en réagissant aux commentaires des utilisateurs ne peut restreindre la liberté d’expression de ces derniers qu’en respectant les conditions précitées. De là, la Cour constate que l’activité de l’Ofii sur Twitter présente certaines particularités qui en font un espace sans équivalent. En effet, l’Office a développé une politique active de communication sur ce réseau social, en n’hésitant pas à répondre aux polémiques et aux critiques qui le concernent, cela afin de faire respecter sa réputation. Il est par ailleurs avéré que la communication ainsi effectuée excède la neutralité qui serait normalement attendue d’un tel service. Enfin, il se trouve que le compte Twitter de l’Ofii est bien plus riche en informations que son site web, qui n’est pas mis à jour avec la même régularité. Autrement dit, aucun autre service de communication ne lui est parfaitement substituable. Surtout, le débat d’intérêt général relatif aux activités de l’Office ne peut être pleinement mené que par l’intermédiaire de ce compte, qui est comparable à une place publique, pour reprendre la formule employée par la Cour suprême des États-Unis.
Partant, la Cour examine la nature des propos ayant légitimé la mesure de blocage contestée par le requérant. Dans d’autres circonstances, on sait que des allégations fausses imputées à des personnes morales ont effectivement pu présenter des risques envers leurs employés. Tel a été le cas s’agissant de la vidéo par laquelle une personne a accusé l’Institut Pasteur d’avoir breveté le coronavirus13. Mais on doit aussi garder à l’esprit que la liberté d’expression autorise le recours à l’exagération et à la provocation14 ; il en va particulièrement ainsi lorsque sont en cause les activités d’une institution ou d’une personnalité publique15. En l’espèce, si les commentaires litigieux ont bien une nature polémique, ils ne sont en aucun cas diffamatoires envers l’établissement. S’ils visent effectivement les fonctions de son personnel, c’est essentiellement pour dénoncer le manque de moyens qui lui sont accordés, ce qui intéresse la mission même de l’Office. Le risque semble donc très exagéré.
Le blocage du requérant constitue par conséquent une ingérence disproportionnée dans l’exercice de sa liberté d’expression.
Du droit à l’information à la liberté de critique
Outre l’absence d’équivalent au compte Twitter de l’Ofii, la Cour prend en compte la situation du requérant vis-à-vis des autres utilisateurs. Pour contourner la mesure de blocage, il lui serait loisible de consulter le compte via un autre ordinateur sans être connecté à Twitter ou même de créer un autre compte sous pseudonyme pour retrouver une pleine capacité d’action. Mais c’est bien parce que cette mesure l’empêche d’accéder aux informations et d’y poster des commentaires et critiques sous son nom que l’ingérence apparaît disproportionnée.
C’est là un point de la décision qui mérite d’être souligné, en ce qu’il renvoie au droit à l’anonymat. L’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes physiques publiant des contenus à un titre non professionnel ne sont pas tenues de le faire sous leur véritable identité, sous réserve de rester identifiables par l’intermédiaire de l’hébergeur. Cette disposition est censée garantir l’exercice le plus large de la liberté d’expression. Souvent critiquée et remise en cause, en ce que l’anonymat induirait un effet de distanciation vis-à-vis des propos publiés en ligne16, sa portée doit pourtant être bien comprise au regard de la liberté d’expression17. Il ne s’agit en effet que d’une faculté, dont l’intérêt est variable en fonction de l’activité. Rien n’interdit à un utilisateur de s’identifier avec ses véritables nom et prénom, mais aussi avec ses qualités professionnelles ou associatives. Or, la mention de ces informations sur le compte d’un utilisateur qui s’exprime publiquement peut avoir un intérêt pour comprendre le sens et la portée de ses propos. Dans un autre domaine, la Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler que de telles indications sur le compte personnel d’un salarié, présenté sous sa véritable identité, pouvait permettre de caractériser un manquement au devoir de loyauté ou de réserve vis-à-vis de son employeur18. Plus encore, les qualités et l’identité d’un particulier peuvent elles-mêmes participer d’un débat d’intérêt général.
Tel était le cas dans la présente affaire. En effet, le requérant est coordinateur national sur les questions d’asile au sein de la Cimade depuis 2006. S’il s’exprime sur Twitter à partir d’un compte personnel, son activité en fait naturellement un participant actif au débat qui porte sur les politiques nationales d’immigration et d’intégration. Il lui est donc particulièrement essentiel de pouvoir s’exprimer sous son nom sur le compte de l’Ofii. L’ingérence que constitue la mesure de blocage n’en est que plus disproportionnée. Au vu de tous ces éléments, la Cour annule logiquement le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision du directeur général de l’Ofii.
La portée de cette décision est très importante, car elle intéressera la modération de tous les comptes de réseaux sociaux appartenant à des institutions publiques ou à des personnalités politiques. À l’heure où se multiplient les critiques adressées directement aux élus19, notamment les membres du Gouvernement, il appartiendra de faire la part des choses entre la prévention d’infractions en ligne, tels que les « raids numériques » et autres formes de cyberharcèlement, et la critique admissible, qui peut cependant à l’égard de ces personnes être exagérée ou provocante.
Sources :
- Conseil d’État, « Les réseaux sociaux : enjeux et opportunités pour la puissance publique », étude annuelle 2022, La Documentation française, 323 p.
- Voir le compte de M. Paul Cassia, professeur de droit public : @PaulCassia1
- Voir le compte de M. Jean-Baptiste Soufron, avocat : @soufron
- TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384 (§ 10-11), LPA, 18 juillet 2019, p. 8-14, note J.-P. Camby.
- Supreme Court of the United States, Packingham v. North Carolina, 582 U.S. (2017), June 19, 2017.
- United States District Court for the Southern District of New York, Knight First Amendment Inst. at Columbia Univ. v. Trump, No. 1 : 17-cv-5205 (SDNY), No. 18-1691 (2d Cir.), May 23, 2018.
- Avis n° 20180226, 17 mai 2018, Mairie d’Halluin.
- CE, 7e et 5e SSR, 29 avril 2002, n° 228830, RFDA, janvier 2003, p. 135-140, concl. D. Piveteau.
- CE, 10e et 9e ch. réunies, 3 juin 2020, n° 421615, DA, juillet 2020, p. 7. (« Il peut en résulter un droit d’accès à des informations détenues par une autorité publique lorsque l’accès à ces informations est déterminant pour l’exercice du droit à la liberté d’expression et, en particulier, à la liberté de recevoir et de communiquer des informations, selon la nature des informations demandées, de leur disponibilité, du but poursuivi par le demandeur et de son rôle dans la réception et la communication au public d’informations. »)
- CE, 10e et 9e SSR, 11 juillet 2008, n° 304752, AJDA, 2008, p. 2178-2180, note J.-D. Dreyfus.
- CEDH, 4e sect., Times Newspaper Ltd c./ Royaume-Uni (n° 1 et 2), 10 mars 2009, n° 3002/03 et 23676/03 (§ 27) ; CEDH, 2e sect., 18 décembre 2012, Yildirim c./ Turquie, n° 3111/10 (§§ 48-50), CCE, septembre 2013, p. 7-10, note J.-P. Marguenaud ; CEDH, GC, 16 juin 2015, Delfi AS c./ Estonie, n° 64569/09 (§ 110), LP, n° 330, septembre 2015, p. 501-508, note C. Bigot ; CEDH, 2e sect., Kalda c./ Estonie, 6 juin 2016, n° 17429/10 (§ 52), Dalloz IP/IT, mai 2016, p. 266-268, note L. Saenko ; CEDH, 4e sect., 4 décembre 2018, Magyar Jeti ZRT c./ Hongrie, n° 11257/16 (§ 73), RDTI, n° 74, décembre 2019, p. 93-108, note E. Cruysmans.
- CEDH, 5e sect., 15 juin 2021, Melike c./ Turquie, n° 35786/19 (§§ 49-51), LP, n° 395, septembre 2021, p. 424-428, note G. Loiseau.
- « Covid-19 : le tribunal correctionnel de Senlis condamne pour diffamation l’auteur d’une vidéo « fake news » », Institut Pasteur, 4 novembre 2020.
- CEDH, 1re sect., Vereinigung Bildender Künstler c./ Autriche, 25 janvier 2007, n° 68354/01 (§ 33), RDP, 2008/3, p. 961, obs. M. Levinet.
- CEDH, Oberschlick c./ Autrice, 1er juillet 1997, n° 20834/92 (§§ 58-59) ; CEDH, 1re sect., 5 juin 2008, I Avgi Publishing & Press Agency SA & Karis c./ Grèce, n° 15909/06 (§ 28).
- Problématique soulevée à l’égard des faits de cyberharcèlement : Catherine Blaya, « Le cyberharcèlement chez les jeunes », Enfance, n° 2018/3, p. 424-425.
- Emmanuel Netter, « Opinion – Contre la levée de l’anonymat en ligne », Les Échos, 11 février 2019.
- C. cass., ch. soc., 19 octobre 2022, n° 21-12.370, JCP-G, 2022, p. 2271-2274, note J. Colonna et V. Renaux-Personnic.
- Élisa de La Roche Saint-André, « Marlène Schiappa, en tant que ministre, peut-elle bloquer des citoyens sur Twitter ? », Libération, CheckNews, 21 juillet 2021.