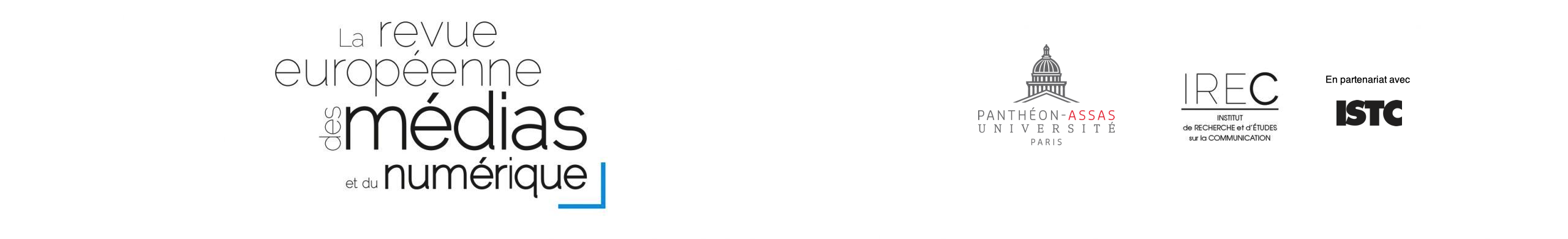Le constat : Netflix fragilise désormais la télévision, payante ou en clair
Un éclairage français
Renforcer les chaînes en clair, repenser la relation entre chaînes et producteurs
Entre enjeux économiques et culturels, quelles priorités ?
Le constat : Netflix fragilise désormais la télévision, payante ou en clair
Né en 1997 comme loueur de DVD, Netflix a basculé son offre sur internet pour inventer, à partir de 2007, le marché de la sVoD : les débits étant au rendez-vous, le streaming vidéo pouvait se déployer et le téléchargement à l’acte être remplacé par un abonnement mensuel. À nouvelle pratique, tarifs attrayants puisque Netflix a initialement été commercialisé à moins de 10 dollars auprès des foyers américains. Constitué principalement de droits issus de séries déjà largement diffusées à la télévision américaine, le service ne semblait pas menacer les chaînes du câble. Pour se développer, Netflix a dû toutefois séduire. Les premières productions Netflix vont donc relever plus de la logique marketing que d’une stratégie de long terme, visant à la constitution d’un catalogue de productions originales. Ainsi, après avoir récupéré les droits en streaming de Mad Men en 2011, la série faisant par ailleurs les bonnes audiences de la chaîne AMC, Netflix va offrir à l’internet sa première série 100 % en ligne. Ce sera House of Cards en 2013, la série ayant été commandée à un producteur indépendant. En 2015, Netflix va créer son propre studio : de distributeur de programmes, le groupe est devenu également producteur.
Cette évolution se lit dans les chiffres de Netflix. Avant Mad Men, en 2010, Netflix s’était contenté d’investir seulement 180 millions de dollars dans l’achat de droits. Dès 2011, avec les droits pour Mad Men, la facture bondit d’un coup à 2 milliards de dollars. Le montant sera multiplié par trois en 2016, avant de passer à 8 milliards de dollars en 2018 et 12 milliards de dollars annoncés en 2019. C’est qu’entre-temps Netflix aura dû repenser sa stratégie de production. De simple argument marketing, les exclusivités Netflix, qu’il s’agisse des droits achetés à des producteurs tiers ou de productions internes, sont devenues le moyen de se protéger des concurrents nouveaux qui ont émergé. Comprenant la menace que fait peser le service de sVoD sur l’économie des chaînes payantes, les grands studios ont en effet préféré limiter la revente de leurs droits à Netflix et se sont engagés à leur tour sur le marché de la sVoD. La production originale chez Netflix est donc devenue le meilleur moyen de mettre un terme à la dépendance historique du service à l’égard des producteurs. Cette évolution stratégique a conduit Netflix à repenser l’ensemble du marché mondial de la distribution et de la production vidéo.
En effet, pour conserver les tarifs peu élevés qui sont la clé de sa croissance accélérée face aux offres onéreuses des chaînes issues du câble et du satellite, Netflix a dû trouver d’autres moyens pour amortir le coût de ses productions. Le choix de l’internationalisation sera fait dès 2010. Aujourd’hui, Netflix est présent dans plus de 180 pays, les programmes étant donc amortis à l’échelle planétaire sur une base d’abonnés sans commune mesure avec celle des marchés nationaux. C’est d’ailleurs ce qui explique l’envolée des coûts de production de la plateforme de sVoD : le potentiel de croissance du nombre d’abonnés est suffisamment important pour que Netflix se transforme en gigantesque major consommant énormément de liquidités chaque année, au moins le temps de constituer son catalogue.
LA MONDIALISATION DE L’OFFRE ET LES EFFETS DE TAILLE SONT CONSTITUTIFS DES RUPTURES APPORTÉES PAR NETFLIX
La mondialisation de l’offre et les effets de taille qu’elle autorise sont donc constitutifs des ruptures apportées par Netflix aux marchés de la distribution et de la production vidéo. Cette logique se retrouve désormais chez les concurrents de Netflix qui s’engagent dans la sVoD : Disney a racheté 21st Century Fox (voir La rem n°45, p.43), l’opération étant effective depuis le 20 mars 2019 ; AT&T s’est emparé de Time Warner (voir La rem n°41, p.62) et Comcast a pris le contrôle de Sky en Europe (voir La rem n°48, p.73). Les premiers perdants sont les distributeurs nationaux de chaînes payantes, à l’instar du Groupe Canal+ en France. Ces derniers ont vu arriver sur leur marché une offre de programmes en ligne extrêmement compétitive et ils n’ont pas les moyens d’une internationalisation rapide comme peuvent l’espérer Disney ou le nouveau Warner Media. La mondialisation de l’offre de Netflix a par ailleurs interdit aux distributeurs nationaux de jouer la carte du localisme contre un envahisseur venu des États-Unis.
À mesure que Netflix a internationalisé son parc d’abonnés, la production de la plateforme s’est également diversifiée. En tant que producteur et distributeur de contenus à la demande, Netflix cherche d’abord à produire des séries et des films qui satisfont des niches plutôt que des programmes grand public qui génèrent un engagement moins intensif auprès des abonnés. Netflix a donc exploré des genres délaissés par les grands studios et les chaînes en clair, comme les films d’horreur ou les comédies romantiques, mais également les films d’auteur. Cette volonté de diversification de l’offre afin de mieux cibler les abonnés dans les recommandations que leur propose le service s’est retrouvée également dans le choix de produire des contenus locaux, tout en exigeant des producteurs qu’ils anticipent une consommation planétaire. Netflix a ainsi misé sur la série européenne pour en faire un genre mondialement plébiscité et il développe désormais ses premiers programmes d’origine indienne ou africaine. Netflix est donc devenue la première major non exclusivement américaine, ce qui a enlevé aux chaînes locales leur monopole sur la production nationale.
Le succès planétaire de cette stratégie, Netflix étant passé de 20,9 millions d’abonnés hors États-Unis début 2015 à 80,7 millions fin 2018, a eu une autre conséquence. Avec ses séries et ses « films » ou « téléfilms », Netflix dissuade de plus en plus ses abonnés d’aller au cinéma. En aval, si l’on considère la chronologie des médias, Netflix finit également par pénaliser les chaînes en clair : la richesse de son offre et les tarifs peu élevés deviennent un moyen pour de nombreux téléspectateurs d’éviter les coupures publicitaires sur la télévision en clair.
Enfin, cette mondialisation de l’offre a rendu obsolètes les régulations nationales des écosystèmes audiovisuels qui doivent désormais prendre en compte ce nouveau concurrent et sa nature très particulière, comme c’est le cas en France.
Un éclairage français
Disposant d’une fréquence depuis 1984, la chaîne Canal+ a bénéficié de conditions exceptionnelles de distribution qui ont permis au groupe éponyme d’imposer sa domination sur tout l’écosystème français de la télévision payante. La capacité de résistance du Groupe Canal+ est encore intacte aujourd’hui, mais les barrières à l’entrée sur le marché de la télévision payante ont rompu. Attaqué une première fois en 2012 sur le sport avec BeIn Sports (voir La rem n°24, p.27), le Groupe Canal+ est désormais débordé par les offres dites over the top, avec Netflix en premier compétiteur.
NETFLIX EST DONC DEVENUE LA PREMIÈRE MAJOR NON EXCLUSIVEMENT AMÉRICAINE
Arrivé dans l’Hexagone en septembre 2014 (voir La rem n°32, p.10), Netflix a confirmé au Figaro, en février 2019, avoir recruté 5 millions d’abonnés en France. En moins de cinq ans, le service de sVoD aura ainsi dépassé Canal+ France en nombre d’abonnés. Alors que Canal+ avait de plus en plus de mal à conserver ses abonnés, l’année 2018 aura toutefois était celle de la stabilisation avec 4,8 millions d’abonnés en France, cette stabilisation étant liée au succès des nouvelles offres commerciales du groupe qui proposent des bouquets à la carte avec Canal+ comme service de base (voir La rem n°41, p.91). Le groupe a ainsi perdu 250 000 abonnés à CanalSat et gagné 251 000 abonnés à la chaîne Canal+. Il s’agit d’abonnés auto-distribués, pour lesquels le groupe précise qu’ils génèrent un revenu moyen de 44 euros par mois, soit plus de quatre fois le prix d’un abonnement à Netflix. Enfin, les accords de distribution passés avec les opérateurs télécoms permettent au Groupe Canal+ d’élargir autrement sa base d’abonnés, avec 3 millions de clients supplémentaires qui rapportent en moyenne 5 euros par mois. Le Groupe Canal+ dispose donc de 7,8 millions d’abonnés en France.
Mais cela ne suffit pas face à Netflix qui a pour lui de bénéficier d’un taux de croissance impressionnant (Netflix ne comptait que 3,5 millions d’abonnés en avril 2018 selon Libération). Cette croissance repose par ailleurs sur l’attrait du service auprès de publics jeunes, lesquels désertent de plus en plus la télévision qui peine à renouveler ses audiences. La moyenne d’âge du téléspectateur de Canal+ en 2018 est de 51,7 ans. En comparaison, celle de TF1 est de 52,7 ans et celle de M6 de 46,9 ans. À l’exception de France 4 qui a une programmation ciblant les plus jeunes en journée, les chaînes du service public attirent un public très vieillissant puisque la moyenne d’âge est systématiquement supérieure à 60 ans : 60,1 ans pour France 2 ; 62,9 ans pour France 3 ; 62,2 ans pour France 5. Netflix attire à l’inverse une population jeune qu’il fidélise grâce à ses comédies romantiques et ses films d’horreur. Aux milléniaux, qui plébiscitent pour deux tiers d’entre eux la sVoD aux offres linéaires, s’ajoute de plus en plus la tranche des 35-49 ans qui bascule progressivement dans la sVoD selon NPA Conseil. Le cabinet estime ainsi que 5,5 % des foyers français ont recours à la sVoD en janvier 2019, ce qui ouvre de prometteuses perspectives de croissance, le taux d’utilisation de la sVoD étant de 69 % aux États-Unis. Autant dire que Canal+ est pour l’instant contraint d’être dans une position défensive, ce qui est le cas également des chaînes en clair.
PARTOUT EN EUROPE, LA VALORISATION BOURSIÈRE DES GROUPES AUDIOVISUELS EST EN CHUTE LIBRE
Avec sa banalisation progressive dans les foyers français, Netflix commence à compter en termes de parts d’audience, même s’il ne s’agit pas d’une mesure officielle (voir La rem n°49, p.51). Selon NPA Conseil, la sVoD serait regardée en prime time par 1,7 million de Français, dont 60 à 70 % regarderaient Netflix qui devient de facto la cinquième chaîne française, devant toutes les chaînes nées avec la TNT. Après Canal+, ce sont donc aussi les chaînes en clair qui sont menacées. Les analystes ne s’y trompent pas. Partout en Europe, la valorisation boursière des groupes audiovisuels est en chute libre : en 2018, la valeur de l’action TF1 a été divisée par deux quand M6 a perdu 40 % ; en Allemagne, le groupe ProSiebenSat.1 a également vu sa valeur en Bourse fondre de moitié quand RTL Group a perdu 33 %. Mediaset, déjà mal valorisé (voir La rem n°41, p.65), perd 34 % en Italie. À l’inverse, le britannique ITV résiste bien avec un cours en repli de 18 % seulement sur un an. C’est qu’ITV a décidé de miser sur la production en plus de la distribution (voir La rem n°42-43, p.49). Or, ce dernier marché bénéficie assurément de l’arrivée des services de sVoD dans le paysage audiovisuel européen.
LES CHAÎNES SONT VICTIMES D’UN EFFET DE CISEAU. NETFLIX MENACE LEURS RECETTES D’ABONNEMENTS OU DE PUBLICITÉ. LA HAUSSE DU COÛT DES DROITS SURENCHÉRIT LE COÛT DE LA GRILLE
Le succès des services de streaming vidéo se traduit par la nécessité pour chacun d’entre eux de se constituer un catalogue de séries et de films, idéalement en exclusivité. Dès lors, Netflix et ses compétiteurs deviennent des interlocuteurs essentiels des producteurs, notamment les producteurs indépendants. En n’étant pas liés à un éditeur, ces producteurs échappent au conflit d’intérêt qui peut amener un groupe intégré à refuser de céder à la concurrence ses droits sur les films et séries, une option choisie par Disney qui a opté pour son propre service de sVoD (voir La rem n°45, p.43). Cet appétit des services de sVoD pour les droits audiovisuels et cinématographiques provoque un regain de concurrence qui favorise les producteurs les plus en vue et les meilleurs talents quand il s’agit des réalisateurs. Certes, le cinéma est épargné en France où la chronologie des médias tient Netflix à distance. Mais ce n’est pas le cas pour les séries, où l’accès aux œuvres devient de plus en plus difficile pour les chaînes qui se retrouvent en concurrence avec les acteurs de la sVoD. Dès lors, les chaînes sont victimes d’un effet de ciseau. D’une part, Netflix menace leurs recettes, qu’il s’agisse d’abonnements ou de publicité. D’autre part, la hausse du coût des droits surenchérit le coût de la grille qui devient de plus en plus difficile à amortir.
LE CINÉMA EST ÉPARGNÉ EN FRANCE OÙ LA CHRONOLOGIE DES MÉDIAS TIENT NETFLIX À DISTANCE
Ce phénomène a plusieurs conséquences qui menacent les équilibres du paysage audiovisuel français. La première d’entre elles est le risque de tarissement des droits disponibles, qu’il s’agisse de programmes américains ou français. En effet, en annonçant lancer leur propre service de sVoD afin de contrer Netflix et de profiter de la dynamique du marché du streaming vidéo, les majors hollywoodiennes vont progressivement verrouiller leurs droits à mesure qu’elles en deviendront progressivement les distributeurs en ligne en Europe. Un groupe comme Orange est de ce point de vue très menacé puisque l’intérêt principal de son offre OCS repose sur le contrat noué avec HBO qui court jusqu’en 2022. Ce contrat lui permet de proposer en exclusivité en France la série culte Game of Thrones. Or, cette dernière risque bien de finir dans l’offre de sVoD que Warner Media compte lancer aux États-Unis puis dans le reste du monde. Orange en a d’ailleurs tiré les conséquences. En 2017, le groupe annonçait un investissement de 100 millions d’euros dans les séries sur cinq ans. Depuis, il multiplie ses investissements dans les créations originales, souvent dans le cadre de coproductions afin de garantir la soutenabilité financière des projets. Ainsi, Orange Content a cofinancé avec la RAI l’adaptation du Nom de la rose et s’est associé à Netflix pour produire The Spy. En effet, avec près de trois millions d’abonnés en France, OCS n’est toujours pas rentable et ne peut pas financer de nombreux projets ambitieux, ce qui l’oblige à passer des alliances avec des coproducteurs. OCS conserve les droits de diffusion en France et cède au coproducteur les droits internationaux ou accepte de perdre l’exclusivité nationale après une première exploitation sur ses chaînes payantes.
Ces contraintes liées à la faiblesse financière des groupes français positionnés sur le seul marché national ont une autre conséquence qui concerne cette fois les grands équilibres sur le marché de la production nationale. Avec ses moyens financiers importants et ses audiences planétaires, Netflix sait attirer les producteurs en mettant à leur disposition les budgets nécessaires pour la création de séries ambitieuses, tout en leur faisant la promesse d’une possible reconnaissance internationale de leur talent. Or, sur ces projets, Netflix finance des créations originales, c’est-à-dire exclusives : il exige des producteurs qu’ils lui cèdent leurs droits en exclusivité et sur une très longue durée. Certes, le montant des droits est plus élevé à l’achat, mais il n’y a plus, ensuite, d’exploitation possible de ces mêmes droits dans la durée. En cas de succès pour une série, la profitabilité de l’investissement revient tout entière à Netflix et échappe au producteur. Ce dernier est donc aussi menacé en partie.
LE PRINCIPE DE LA PRODUCTION INDÉPENDANTE QUI DONNE AU PRODUCTEUR ET NON À LA CHAÎNE LE CONTRÔLE DES DROITS AUDIOVISUELS EST REMIS EN QUESTION
Sur un marché national trop étroit pour garantir le financement de séries à gros budget, le producteur a avantage à s’associer avec Netflix pour rendre possible son projet. En même temps, cette association lui interdit de profiter véritablement des économies d’échelle dont a toujours bénéficié la production audiovisuelle à chaque succès. C’est l’amer constat dressé par TF1 qui a cédé à Netflix les droits d’exploitation de la mini-série La Mante après une première exploitation à l’antenne. Le succès de La Mante a été tel sur Netflix que TF1 a réclamé un rééquilibrage dans ses relations avec Netflix car, selon Ara Aprikian, son directeur général adjoint contenus, cité par Les Echos, « le prix payé par Netflix pour La Mante n’est pas à la hauteur de l’exploitation mondiale de l’œuvre ». TF1 et Netflix ont annoncé en mars 2019 s’associer de nouveau dans le financement d’une nouvelle série, Le Bazar de la Charité, Netflix s’étant engagé sur une participation plus importante en contrepartie de quoi le service de sVoD disposera d’une exclusivité mondiale sur la série pendant quatre ans, juste après son passage sur l’antenne de TF1. Si TF1 est parvenu cette fois-ci à imposer ses vues à Netflix, rien ne dit qu’il en sera ainsi demain. En effet, Netflix a intérêt à sécuriser définitivement les droits acquis, ce qui l’incite à limiter les coproductions, lesquelles impliquent toujours un partage des droits. Le principe même de la production indépendante qui donne au producteur et non à la chaîne le contrôle des droits audiovisuels est donc remis en question. Or, ce principe d’indépendance des producteurs est la pierre angulaire du dispositif français de financement de la production audiovisuelle et cinématographique. Il est censé permettre de garantir une plus grande diversité créative, motif qui à lui seul légitime les contraintes qui pèsent sur le secteur en France.
C’est ce système que Netflix fait voler en éclats. En n’investissant pas dans la production dite indépendante, il confisque une partie des droits. À l’inverse, les chaînes sont contraintes par leurs obligations d’investissement dans la production indépendante, prenant de facto le risque de voir les producteurs qu’elles financent vendre leurs droits à des concurrents en ligne qui ne sont pas assujettis aux mêmes règles. Au-delà des relations entre éditeurs et producteurs, Netflix menace plus largement l’économie des chaînes payantes et en clair en détournant vers ses offres les abonnés des uns et les audiences des autres. Or, le système de financement de la production audiovisuelle et cinématographique en France est, pour ce qui concerne les obligations des chaînes, indexé sur leur chiffre d’affaires. L’effet de ciseau décrit plus haut a donc pour conséquence une remise en question de tout l’écosystème français et de la réglementation nationale qui le structure depuis la libéralisation de l’audiovisuel dans les années 1980. En effet, les grands principes ont été consacrés dès 1990 avec les décrets dits Tasca qui ont appliqué en France la directive européenne Télévisions sans frontières (TVSF) de 1989. Aujourd’hui, le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), l’Autorité de la concurrence et, bien sûr, les chaînes demandent au gouvernement d’agir vite : l’attentisme réglementaire serait en train de tuer lentement le paysage audiovisuel français en rendant possible une concurrence déloyale car exempte des contraintes qui s’appliquent actuellement aux éditeurs de chaînes. Et cet attentisme est d’autant plus dénoncé que l’héritière de la directive TVSF, la directive Services de médias audiovisuels (SMA), a été récemment révisée, imposant à chacun des pays de l’Union européenne des règles nouvelles qui intègrent dans le champ de la régulation les services de sVoD transnationaux (voir La rem n°49, p.13).
Renforcer les chaînes en clair, repenser la relation entre chaînes et producteurs
Sous la présidence de François Hollande, une grande réforme de l’audiovisuel a été annoncée et sans cesse repoussée. Il ne reste de ce quinquennat que la loi du 15 novembre 2013 qui redonne au CSA, plutôt qu’au président de la République, le pouvoir de nommer les présidents des groupes de l’audiovisuel public. Avec l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir, la réforme de l’audiovisuel a de nouveau été mise à l’ordre du jour. Le 4 juin 2018, la ministre de la culture, Françoise Nyssen, lançait officiellement le projet de réforme, depuis sans cesse repoussé, son examen étant désormais prévu au plus tôt fin 2019, probablement début 2020, la directive SMA devant être transposée au plus tard en septembre 2020. Et, plus le temps passe, plus des voix inquiètes appellent à une refonte en profondeur de la loi sur l’audiovisuel de 1986.
LE NERF DE LA GUERRE ENTRE LES CHAÎNES ET NETFLIX, À SAVOIR LES OBLIGATIONS DE PRODUCTION INDÉPENDANTE ASSOCIÉES AUX QUOTAS HÉRITÉS DE L’APPLICATION EN FRANCE DE LA DIRECTIVE TVSF
Le CSA a fait connaître ses propositions en premier, contraint par l’arrivée à échéance du mandat de son président, Olivier Schrameck. Le 11 septembre 2018, il rendait publiques vingt propositions pour « refonder la régulation audiovisuelle », rappelant au passage que la loi de 1986 avait été modifiée plus de 80 fois en une trentaine d’années. L’analyse du CSA part du constat de la concurrence renforcée entre les acteurs régulés, à savoir le marché de la télévision, et les acteurs venus de l’internet, qu’il s’agisse des services de sVoD ou des plateformes comme Google et Facebook qui concurrencent indirectement les chaînes en captant une partie des dépenses des annonceurs. Le CSA propose un élargissement de ses prérogatives aux acteurs de l’internet. Son analyse débouche sur un appel à la simplification de la régulation audiovisuelle, avec la possibilité de regrouper l’ensemble des textes dans un code unique de la communication. Il recommande en outre un assouplissement de la réglementation. Il faut donner aux chaînes et aux acteurs français de l’audiovisuel les moyens de mieux résister à la concurrence des pure players, quitte à remettre en question l’inspiration du système français de régulation des médias, lequel a cherché à préserver chacun des médias en interdisant la concurrence intermédias. Sauf que cette approche, conçue à partir d’une lecture nationale des marchés des médias et de la communication, est désormais rendue caduque par l’émergence d’acteurs transnationaux.
Le CSA propose ainsi de supprimer les jours interdits de cinéma à la télévision, ce qui est une demande récurrente des chaînes. Il s’agissait historiquement de protéger les salles de la concurrence de la télévision. Or, Netflix est à l’évidence le nouveau concurrent des salles, par ses succès d’audience, mais aussi parce qu’il refuse de respecter la chronologie des médias afin de ne pas laisser à d’autres, les salles en premier, les moyens d’exploiter les films qu’il finance pour alimenter son catalogue. Quand Netflix propose un catalogue de films à la demande et à toute heure, interdire à TF1 ou à M6 de miser sur le cinéma un mercredi soir semble en effet pénalisant. Mais ce que les chaînes gagneraient pour mieux résister à la concurrence de la sVoD peut aussi se lire comme une mesure en défaveur des salles.
Le CSA propose également de réfléchir aux dispositifs anti-concentration que la loi de 1986 a instaurés en France, notamment le dispositif dit du « 2 sur 3 ». Ces dispositifs interdisent l’émergence de très grands groupes de médias. Or, l’effet de taille sur le marché des droits comme sur le marché publicitaire joue de plus en plus à mesure que les achats de droits s’internationalisent (Netflix achète dès qu’il le peut des droits dans le monde) et que le marché de la publicité, notamment sur internet, s’adresse de plus en plus à des continents entiers.
Le CSA vise également le nerf de la guerre entre les chaînes et Netflix, à savoir les obligations de production indépendante associées aux quotas hérités de l’application en France de la directive TVSF. Le dispositif des quotas porte sur la diffusion de programmes français et européens, mais également sur le financement de la production audiovisuelle et cinématographique, obligeant les chaînes à réinvestir une partie de leur chiffre d’affaires. Or, cet investissement contraint est assorti d’une condition supplémentaire, à savoir l’obligation de recourir majoritairement à des producteurs indépendants, le pourcentage de chiffre d’affaires à investir comme le niveau de production indépendante variant selon les chaînes. Concrètement, Canal+ est le grand argentier du cinéma français (voir La rem n°24, p.69). L’accord entre Canal+ et le cinéma français a été renouvelé en novembre 2018. Canal+ doit consacrer 12,5 % de son chiffre d’affaires annuel au financement de la production cinématographique européenne, dont au moins 9,5 % pour le cinéma français. De leur côté, France Télévisions, TF1 et M6 sont les grands financiers de la production audiovisuelle française. Si France Télévisions a des engagements renforcés, les chaînes privées doivent consacrer au moins 15 % de leur chiffre d’affaires à la production audiovisuelle, dont 10,5 % au moins pour les œuvres patrimoniales. Le pourcentage de chiffre d’affaires peut être descendu à 12,5 % si le financement porte exclusivement sur des œuvres patrimoniales. Enfin, que ce soit pour le cinéma avec Canal+ ou pour la production audiovisuelle avec TF1, M6 et France Télévisions, la part de production indépendante couvre à peu près les deux tiers des dépenses obligatoires. Concrètement, cela revient à dire que pour deux tiers des dépenses consenties, les chaînes ne peuvent pas espérer contrôler les droits des films et programmes audiovisuels qu’elles financent : toute politique d’exclusivité est exclue, quand Netflix, à l’inverse, a construit toute son offre sur sa capacité à proposer un catalogue de séries dites « originales », à savoir introuvables ailleurs.
Le dispositif a toutefois ses vertus. Il permet aux producteurs de s’émanciper un tant soit peu des desiderata des chaînes. Les préachats de droits par les chaînes sont en effet complétés par des recettes tirées de l’exploitation ultérieure des droits, ce qui doit inciter le producteur à s’émanciper, au moins en partie, des injonctions du seul premier diffuseur. Ici, une plus grande créativité est postulée. La seconde vertu est cardinale et concerne la circulation des œuvres et leur accessibilité pour le public : les producteurs ont intérêt à commercialiser des droits de diffusion quand les chaînes auraient tendance à ne plus programmer les anciennes productions si elles en conservaient les droits. Or, la disponibilité des œuvres en ligne au sein des catalogues rend cet argument plus fragile aujourd’hui. Accorder aux chaînes plus de droits sur les programmes qu’elles financent leur permettrait également de disposer en ligne d’un meilleur contrôle de la circulation des œuvres. Cela leur permettrait d’avantager leurs propres services en ligne plutôt que ceux des concurrents, à l’instar du projet Salto en France (voir La rem n°49, p.52) qui, du fait de l’obligation de production indépendante, ne dispose pas d’un véritable catalogue bien qu’il fédère les principales chaînes françaises en clair.
LES CHAÎNES NE PEUVENT PAS ESPÉRER CONTRÔLER LES DROITS DES FILMS ET PROGRAMMES AUDIOVISUELS QU’ELLES FINANCENT
Les propositions du CSA visent également le marché publicitaire. Ici, Netflix n’est plus la cause des maux qui affectent le marché audiovisuel français. Google et Facebook prennent le relais parce qu’ils proposent en ligne une offre vidéo et qu’ils la financent à grand renfort de publicité, les deux acteurs captant l’essentiel de la croissance du marché publicitaire sur internet (voir La rem n°42-43, p.92). Or, le marché publicitaire en ligne, peu ou pas régulé, permet un hyper-ciblage qui détourne les annonceurs des formats historiques et pénalise donc le marché de la publicité à la télévision. Pour le CSA, il faut donner aux chaînes les moyens de proposer une offre publicitaire compétitive par rapport à celle des plateformes. À cette fin, le CSA suggère d’étudier la possibilité d’une autorisation de la publicité segmentée à la télévision. Cette dernière permettrait aux chaînes de cibler le message publicitaire, et a minima de le géolocaliser, ce que font déjà les acteurs de l’internet. Mais, en arrivant sur le marché de la publicité locale, les chaînes s’imposeraient comme un nouveau concurrent des radios et de la PQR (presse quotidienne régionale). L’ouverture de ce marché jusqu’ici captif constituerait un risque pour les autres médias, sauf à considérer que la concurrence des plateformes rend caduques toutes les protections jusqu’ici imaginées sur le marché publicitaire.
La même logique anime le CSA quand il pose la question des secteurs interdits de publicité télévisée : le cinéma, l’édition et la promotion dans la distribution. Pour les deux premiers secteurs, l’interdiction de publicité télévisée devait permettre de protéger les petits producteurs, incapables de mobiliser les budgets qu’impose une campagne publicitaire à la télévision, face au rouleau compresseur des géants mondiaux du cinéma comme de l’édition littéraire. Pour la promotion dans la distribution, l’argument est d’abord économique car il s’agit de l’un des postes les plus importants de dépenses des distributeurs dans la publicité locale, notamment à la radio. Mais le CSA, qui n’a pas de véritables prérogatives économiques, ne peut au mieux que proposer d’ouvrir le débat.
L’affaire est autrement plus sérieuse quand c’est l’Autorité de la concurrence qui se prononce sur les marchés des médias. Entre-temps, l’obstacle politique aura par ailleurs été levé. Publié le 4 octobre 2018, le rapport des parlementaires Aurore Bergé et Pierre-Yves Bournazel sur la « Mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’heure numérique » propose d’expérimenter durant dix-huit mois la publicité géolocalisée et segmentée et la publicité pour le cinéma à la télévision. La promotion dans la distribution ne fait pas, en revanche, partie des propositions. Ce n’est pas le point de vue de l’Autorité de la concurrence qui, dans un avis du 21 février 2019, appelle à franchir le pas de la dérégulation de toute urgence.
Pour la présidente de l’Autorité de la concurrence, Isabelle de Silva, « nous sommes face à une disruption au moins aussi forte que celle qu’a pu connaître le secteur des taxis avec l’arrivée d’Uber ou le secteur hôtelier avec l’irruption d’Airbnb ». À l’heure de Netflix, une réforme urgente de l’audiovisuel s’imposerait donc qui devrait en partie passer par décret afin de la mettre en œuvre le plus rapidement possible, la nouvelle loi arrivant dans un second temps. Le constat est sans appel : les chaînes françaises sont désormais victimes d’un effet de ciseau parce qu’elles sont confrontées d’une part à la hausse des coûts des programmes et, d’autre part, à la baisse de leurs recettes, qu’il s’agisse de publicité ou d’abonnements. L’Autorité de la concurrence préconise en conséquence une « libération des obligations pesant exclusivement sur les opérateurs historiques tant en matière de publicité que de programmes ». Pour ce faire, le décret du 27 mars 1992 sur la publicité et le décret du 2 juillet 2010 sur la contribution au financement de la production audiovisuelle et cinématographique devraient être modifiés de toute urgence.
DIFFICILE DE DISTINGUER, À TERME, REPLAY ET VIDÉO À LA DEMANDE, CE QUI IMPOSE DE REPENSER LA NATURE DE LA CONTRACTUALISATION ENTRE LES PRODUCTEURS ET LES ÉDITEURS
En ce qui concerne la publicité, l’Autorité de la concurrence concentre l’attention sur le périmètre du marché pertinent pour penser la régulation. Jusqu’ici distingués, le marché de la publicité à la télévision et le marché de la publicité en ligne se caractériseraient désormais par leur « convergence croissante ». Dès lors, les contraintes propres à la seule publicité télévisuelle deviennent pénalisantes pour les chaînes, d’où la recommandation de revenir sur les secteurs interdits de publicité à la télévision comme d’autoriser la publicité dite segmentée et adressée à la télévision. L’ensemble de ces mesures devrait entraîner des recettes publicitaires supplémentaires comprises entre 150 et 400 millions d’euros sur trois ans pour les secteurs interdits, et de 200 millions d’euros pour la publicité segmentée. Si les marchés publicitaires convergent, alors il faut en effet que les chaînes aient les mêmes outils que les acteurs de l’internet pour valoriser leurs audiences auprès des annonceurs. L’Autorité de la concurrence écarte par ailleurs l’argument d’un siphonnage possible des recettes publicitaires de la presse locale et des radios en cas d’assouplissement de la réglementation. Ces médias sont aussi concurrencés par l’internet, et l’objectif est bien de donner aux médias historiques les moyens de résister face aux offres publicitaires en ligne. Cette libéralisation devrait donc conduire à renforcer la part de marché publicitaire de la télévision en suscitant des dépenses nouvelles des annonceurs.
Le deuxième pan de recommandations concerne les relations entre les éditeurs et les producteurs. L’Autorité de la concurrence rappelle que le financement de la production audiovisuelle et cinématographique dépend en partie de la bonne santé des chaînes, leurs obligations de contribution à la production étant indexées sur leur chiffre d’affaires. Or l’Autorité considère que le principe de la production indépendante tel qu’il est actuellement défini fragilise les éditeurs en ne leur garantissant que des droits de diffusion limités dans le temps, ce qui exclut notamment l’exploitation en ligne des œuvres sous forme de catalogue. Si l’Autorité de la concurrence ne revient pas sur le principe d’indépendance, elle considère en revanche qu’il sera de plus en plus difficile de distinguer, à terme, replay et vidéo à la demande, ce qui impose de repenser la nature de la contractualisation entre les producteurs et les éditeurs. De la même manière que les droits pour le replay sont désormais associés aux droits de diffusion sur le service linéaire, l’Autorité de la concurrence propose d’étendre la possibilité pour les éditeurs de chaînes de négocier aussi avec les producteurs l’association des droits à la demande avec les droits linéaires, condition sine qua non de la constitution d’une offre exclusive en ligne comme le prévoit par exemple le projet Salto (voir La rem n°49, p.52). L’Autorité propose enfin un alignement de la réglementation française sur les standards européens, ce qui passerait à terme par un relèvement progressif du seuil de production dépendante et par la qualification purement capitalistique de l’indépendance, supposant d’exclure de l’indépendance le critère éditorial. Enfin, l’Autorité de la concurrence recommande une mutualisation des obligations entre cinéma et audiovisuel au sein des groupes afin qu’ils puissent flécher massivement leurs investissements sur certains types de programmes, l’Autorité envisageant clairement un fléchage des obligations de financement du cinéma par les chaînes en clair vers le financement de séries haut de gamme. À l’évidence, la logique économique se heurte ici à des objectifs politiques distincts, ce qu’atteste par ailleurs la réforme du financement de l’aide à la production audiovisuelle par le CNC.
LA RÉGULATION DES MARCHÉS EST INEFFICACE CAR ELLE N’ANTICIPE PAS ASSEZ LES BOULEVERSEMENTS
Enfin, prenant en considération l’existence d’une concurrence mondialisée venant des services de sVoD, l’Autorité de la concurrence se prononce elle aussi pour un assouplissement des conditions de programmation des chaînes, avec notamment la suppression des « jours interdits » de cinéma à la télévision, et elle ouvre le débat sur un assouplissement du dispositif anticoncentration en France.
Entre enjeux économiques et culturels, quelles priorités ?
Si l’analyse des marchés de la production et de la télévision est sans appel de la part de l’Autorité de la concurrence, il reste que les dispositifs associés aux quotas, aux secteurs interdits de publicité, aux « jours interdits » sont aussi des dispositifs qui relèvent de la politique culturelle. En préservant les recettes publicitaires des médias locaux, c’est le pluralisme de l’information qui est soutenu. Avec les jours interdits de cinéma à la télévision, c’est l’existence d’un réseau dense de salles qui est défendue avec, en cascade, la possibilité d’une exposition correcte de la création cinématographique. Le même objectif de diversité culturelle justifie l’existence des quotas et du principe d’indépendance afin de faciliter la circulation et donc l’exposition des œuvres. L’équilibre à trouver entre enjeux de politique culturelle et régulation optimale des marchés est donc toujours difficile.
Parfois, la régulation des marchés est inefficace car elle n’anticipe pas assez les bouleversements auxquels les acteurs régulés seront pourtant soumis. Le signal d’alarme lancé par l’Autorité de la concurrence va de ce point de vue à contre-courant de son conservatisme d’autrefois quand elle avait refusé en 2012 au Groupe Canal+ de conserver l’exclusivité des séries qu’il finance pour ses services de vidéo en ligne (voir La rem n°24, p.69). Ces injonctions ont eu pour effet, selon Maxime Saada, président du directoire, de « rayer de la carte » le service de sVoD du groupe, CanalPlay, totalement dépassé par Netflix. Depuis, l’Autorité a assoupli ses injonctions (voir La rem n°44, p.5), redonnant ainsi à Canal+ les moyens de ses ambitions dans la sVoD. Outre ses services en ligne structurés dans MyCanal (voir La rem n°49, p.52), le groupe a inauguré, le 11 mars 2019, son nouveau service de sVoD baptisé Canal+ Séries. Si ce service n’est pas considéré comme concurrent de Netflix, l’offre alternative du Groupe Canal+ restant sa chaîne éponyme avec sa programmation thématique, montre qu’il s’agit bien d’un nouveau service de sVoD qui joue la carte de la production française. Le Groupe Canal+ investit en effet 80 millions d’euros chaque année dans les séries et dispose d’un catalogue important de créations originales qui vont être basculées progressivement sur Canal+ Séries, le service proposant entre 80 et 90 % d’exclusivités, principalement des séries françaises et européennes même s’il accueillera aussi les séries de ShowTime, FX et Warner. Avec un prix d’entrée à 6,99 euros par mois, le service est moins cher que Netflix et doit pousser ses utilisateurs à opter ensuite pour les offres enrichies de Canal+.
De ce point de vue, l’allègement des injonctions permet dans ce cas l’émergence d’une offre où la part la plus attirante du catalogue n’est pas d’abord américaine, ce qui est le cas de Netflix, même si ce dernier devra européaniser en partie son catalogue, une fois la directive SMA transposée en France. Cet allégement renforce également l’intérêt pour Canal+ d’investir de plus en plus dans les séries parce qu’il sait qu’il pourra désormais les exploiter sur la totalité de ses services, ce qui soutient là encore le financement de la production nationale de séries. Enfin, le lancement de Canal+ Séries devrait potentiellement améliorer la rentabilité du groupe : les séries étant financées d’abord pour Canal+ et exploitées sur ses différents services, elles seront en grande partie amorties quand elles basculeront sur Canal+ Séries, même si Canal+ Séries devra aussi acheter ses propres séries exclusives.
C’est le même pari qu’a fait le Centre national de la production cinématographique (CNC) en misant sur l’alliance possible entre les nouveaux marchés et le soutien à la créativité. En approuvant, le 29 novembre 2018, un plan d’économies de 30 millions d’euros sur les aides à la production audiovisuelle, le conseil d’administration du CNC a entériné les choix politiques de l’institution. Prenant acte de l’augmentation continue du volume de production des séries en France (plus 16 % en quatre ans), alors que les taxes qui financent le CNC ont un rendement stable, le CNC a décidé d’économiser principalement sur les feuilletons quotidiens pour renforcer à l’inverse son soutien aux séries « très qualitatives à vocation internationale ». Il s’agit ici de favoriser les producteurs qui misent sur l’exportation de leurs séries et s’inscrivent dans une perspective internationale, seule à même de permettre l’amortissement des projets les plus ambitieux, comme le fait Netflix. Le CNC rappelle toutefois que ce fléchage passera par des aides sélectives quand les aides automatiques représentent encore 80 % du soutien du CNC à la production audiovisuelle.
LE CRITÈRE DE PRODUCTION INDÉPENDANTE, DANS LE CINÉMA COMME DANS L’AUDIOVISUEL, N’INCITE PAS LES CHAÎNES À FINANCER DES PROJETS À VOCATION INTERNATIONALE
Lancé à l’occasion du festival Séries Mania à Lille le 28 mars 2019, le plan « séries » du CNC confirme cette tendance. Les séries originales qui entrent dans la logique industrielle de production engagée par Netflix, avec la mise à disposition de saisons dans des intervalles très brefs, seront plus aidées que les autres. Un bonus financier sera désormais accordé aux séries respectant les formats retenus à l’échelle internationale (20 et 52 minutes), ainsi qu’aux séries dont la production de la saison 2 sera lancée avant la diffusion de la saison 1, et cela afin de s’aligner sur les rythmes de sorties constatés sur les grands services de sVoD.
L’exemple de Netflix semble inspirer le CNC à plus d’un titre. Alors que la politique de soutien au cinéma n’est pas touchée par les mesures d’économies, un renforcement des aides aux films de genre, à savoir les films d’horreur, les comédies musicales ou encore la science-fiction, a été confirmé, conduisant le CNC à prendre une position éminemment politique sur la question du 7e art en France. Les films de genre font le succès des services de sVoD alors que les chaînes comme les réseaux de salles les ignorent parce qu’ils visent des cibles trop étroites. En les soutenant au titre de l’aide au cinéma, le CNC ouvre la possibilité d’une reconnaissance comme film de cinéma à des productions qui ne sont pas sorties en salle et qui échappent donc à la chronologie des médias. À Cannes, le festival a préféré à l’inverse exclure ces films de sa compétition, justement parce qu’ils ne s’inscrivent pas dans le contexte de valorisation économique imposée par la chronologie des médias (voir La rem n°44, p.38). Le CNC fait donc ici le choix de la créativité contre la régulation nationale du marché. C’est aussi un pari sur la capacité du cinéma français à répondre aux attentes de publics internationaux dans des genres où la production mondialisée est bien représentée.
En effet, la régulation nationale a toujours favorisé en France les productions difficilement exportables : le critère de production indépendante, dans le cinéma comme dans l’audiovisuel, n’incite pas les chaînes à financer des projets à vocation internationale car elles ne sont pas intéressées par la vente des droits à l’étranger (voir La rem n°45, p.74). En limitant son soutien aux feuilletons quotidiens et en favorisant les films de genre, le CNC indique la nécessité pour les producteurs de changer d’horizon et d’étendre leurs ambitions au-delà des frontières hexagonales. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon Unifrance, 40 millions de téléspectateurs ont vu des films français à l’étranger en 2018, deux fois moins qu’en 2017, faute de la superproduction de Luc Besson. C’est très peu, même si le cinéma français est au deuxième rang des exportations mondiales, parce qu’il n’y a pas « de gros concurrents derrière nous » selon Isabelle Giordano, directrice générale d’Unifrance citée par Le Figaro. Cette faible attractivité des films français pour les spectateurs étrangers se retrouve de manière beaucoup plus marquée dans les catalogues des services de sVoD : sur iTunes et Netflix en Europe, les films français ne représentent que 3,5 % des films du catalogue…
Dans ce cas, les effets conjugués du marché et de la régulation pourraient toutefois inverser la tendance, ce que donne à penser le bilan du 2018 du cinéma publié par le CNC. Ce dernier confirme la baisse du financement du cinéma par les chaînes de télévision, laquelle est mécanique car elle est liée au repli du chiffre d’affaires des chaînes sur lequel sont indexées les obligations de financement. Ainsi, le financement du cinéma par les chaînes est passé de 373 millions d’euros en 2012 à 292 millions d’euros en 2018 (-22 %). Pourtant, le cinéma français est toujours financé à hauteur de 1,02 milliard d’euros, un montant stable dans le temps. C’est qu’entre-temps le crédit d’impôt a pris le relais dans le financement des films, cette moins-value fiscale pour l’État favorisant les financements étrangers pour des films tournés en France. Or, en aidant les coproductions internationales, le crédit d’impôt favorise l’internationalisation du cinéma français. Certes, les politiques qui comptent sur le crédit d’impôt pour soutenir la création rencontrent vite leurs limites qui sont celles du dumping fiscal entre États. Au moins méritent-elles d’être mobilisées en sus des circuits classiques de financement de la production par les distributeurs, ce à quoi s’est aussi employé le CNC en élargissant aux plateformes vidéo la taxe sur les hébergeurs de vidéo en ligne (voir La rem n°41, p.18).
Il reste que ces initiatives ne règlent pas structurellement le problème de déséquilibre constaté entre les acteurs régulés et les acteurs non régulés. L’importance d’un arbitrage rapide là où les logiques du marché ne contribuent pas nécessairement à soutenir la politique de diversité devient donc essentiel parce que l’urgence est constatée de manière unanime. En attendant la future loi audiovisuelle, les premiers signaux indiquent que les logiques de marché et la création de filières industrielles pour la production et la diffusion risquent d’être favorisées. C’est ce que propose le rapport du producteur Dominique Boutonnat remis au président de la République qui porte sur l’incitation à l’investissement privé dans le cinéma et l’audiovisuel et vise donc à renforcer le poids des acteurs économiques au détriment des dispositifs de soutien. C’est également ce que semble indiquer la création du fonds d’investissement pour les entreprises culturelles et créatives. Annoncé le 13 mai 2019, le jour où le rapport Boutonnat a été rendu public, ce fonds sera géré par Bercy via Bpifrance et par l’Ifcic. Il ne sera pas géré par le ministère de la culture…
Sources :
- « Le CSA veut changer les règles du jeu », Caroline Sallé, Le Figaro, 12 septembre 2018.
- « Audiovisuel : le CSA plaide pour un assouplissement des règles », Marina Alcaraz, Les Echos, 12 septembre 2018.
- « Le cinéma français doit travailler avec Netflix, Amazon, YouTube », interview d’Isabelle Giordano, DG d’Unifrance, Caroline Sallé, Le Figaro, 21 septembre 2018.
- « Le CNC veut rediriger les aides vers les œuvres créatives et originales », interview de Frédérique Bredin, Présidente du CNC, Marina Alcaraz, Fabienne Schmitt, Les Echos, 24 octobre 2018.
- « Les comédies romantiques, la nouvelle botte secrète de Netflix », Elisa Braun, Le Figaro, 30 octobre 2018.
- « Le CNC veut diversifier la production française », Nicolas Madelaine, Les Echos, 3 décembre 2018.
- « Les chaînes de télévision en pleine tempête boursière », Caroline Sallé, Le Figaro, 22 janvier 2019.
- « Netflix, « cinquième » chaîne en prime time », Marina Alcaraz, Les Echos, 30 janvier 2019.
- « Netflix passe devant Canal+ en France », Nicolas Madelaine, Les Echos, 14 février 2019.
- « Vivendi à la manœuvre sur Universal Music », Caroline Sallé, Enguérand Renault, Le Figaro, 15 février 2019.
- « Les enfants de la télé sont devenus vieux », Caroline Sallé, Le Figaro, 19 février 2019.
- « Loi audiovisuelle : l’Autorité de la concurrence appelle à une réforme ambitieuse et rapide », Caroline Sallé, Le Figaro, 22 février 2019.
- « Télévision : le rapport choc et sans tabou de l’Autorité de la concurrence », Marina Alcaraz, Les Echos, 22 février 2019.
- « Canal+ affûte son arsenal anti-Netflix », Nicolas Madelaine, Fabienne Schmitt, Les Echos, 22 février 2019.
- « Canal+ lance une nouvelle offre 100% séries », Caroline Sallé, Le Figaro, 12 mars 2019.
- « Le cinéma dépend plus de l’argent public », Enguérand Renault, Le Figaro, 20 mars 2019.
- « Orange annonce la production de quatre nouvelles séries », Caroline Sallé, Le Figaro, 22 mars 2019.
- « TF1 et Netflix scellent une alliance inédite », Caroline Sallé, Le Figaro, 27 mars 2019.
- « Le CNC lance un « Plan Séries » pour soutenir la création originale française », communiqué de presse, CNC, 28 mars 2019.
- « Séries françaises : cesser de bricoler pour faire face à Netflix », Nicolas Madelaine, Les Echos, 15 avril 2019.
- « Le cinéma doit faire sa mue en cinq ans pour survivre », Caroline Sallé, Enguérand Renault, Le Figaro, 15 mai 2019.